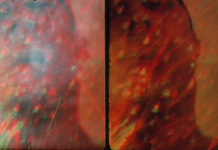Stephen Dwoskin appartient à cette catégorie de cinéastes-artisans qui ont en permanence incommodé la critique française. Durant les vingt premières années de sa carrière (1960-1980), cet Anglo-américain, né à New York en 1939 et émigré en Grande-Bretagne en 1964, fut essentiellement défendu par les tenants du cinéma d’avant-garde. Il reçut un prix au festival spécialisé de Knokke-le-Zoute en 1967 pour les quatre courts métrages présentés : Chinese Checkers (1963), Alone (1963-64), Naissant (1964), Soliloquy (1964-67).
Le cinéma expérimental, non narratif, indispose (c’est encore le cas aujourd’hui) les cinéphiles et critiques français qui n’ont pas d’instruments théoriques pour l’appréhender. Dwoskin sort du « ghetto » avec son moyen métrage Shadows from Light (1983), consacré au photographe Bill Brandt, et présenté dans une semaine des Cahiers du cinéma. La chose fut rendue possible par la reconnaissance, en tant qu’auteurs singuliers (la rupture avec la transparence bazinienne est enfin consommée), d’individus aussi hors normes que Johan Van der Keuken ou Manoel de Oliveira : l’auteur de Dyn Amo – qui est passé au long métrage, puis à l’autobiographie filmée, avec Behindert (1974) – rentre bientôt dans cette famille. Désormais, chacun de ses films montré en festival (surtout Rotterdam, plaque tournante de ce type de démarches) aura droit à des échos favorables dans la presse française.
Ce plasticien de formation, participant actif dès 1960 au New American Cinema aux côtés de Ron Rice, Jonas Mekas…, cofondateur en 1966 de la London Film-Makers’ Coop, ne sera jamais un cinéaste expérimental orthodoxe. Il refuse le radicalisme ascétique de ses collègues anglais Peter Gidal ou Malcolm Le Grice et s’attache toujours à saisir la vérité intérieure des sujets (en général féminins) que traque sa caméra. Sujets humains bannis ou chosifiés par le courant structurel qui s’empare de l’avant-garde à la fin des années 1960. Depuis le milieu des années 1990, Dwoskin est à nouveau revendiqué par les critiques et cinéastes proches ou issus des avant-gardes. En France même, le retour de la figure et des corps humains se retrouve, en ces années 2000, comme matière esthétique et plastique dans la pratique de cinéastes expérimentaux aussi divers que Stéphane Marti, Anne-Sophie Brabant et Pierre Gerbaux, Stéphane du Mesnildot, etc.
Tour à tour avant-gardiste ou « auteur-artisan » à la Oliveira (ou Hanoun, un grand oublié à qui justice n’a pas encore été vraiment rendue), Stephen Dwoskin est aussi, à sa manière, un documentariste qui a longuement étudié les réactions des gens filmés face à l’agression de la caméra – cf., entre autres, Trixi (1970), mais aussi son propre cas de handicapé autofilmé (il a contracté la poliomyélite à l’âge de neuf ans) : Behindert ou Trying to Kiss the Moon (1994). Il a également réalisé des documentaires plus classiques comme Shadows from Light, Ballet Black (1986) ou Face of Our Fear (1992).
Les premiers courts métrages de l’auteur : Alone, Moment (1969) sont assez proches de ceux réalisés par Andy Warhol à ses débuts (Eat, 1963; Couch, 1964). Mais là où le promoteur du pop art laisse toute liberté à ses acteurs, se contentant d’enregistrer leurs faits et gestes, Dwoskin les traque, tente de révéler, sous l’apparence des masques, les fêlures cachées.
Dans Alone, la caméra filme une fille allongée sur un matelas. Consciente de la présence de l’objectif, elle se tourne, se retourne, s’ennuie, est gênée; la position de ses doigts suggère à la fin qu’elle va se livrer à un plaisir solitaire. Moment est à la fois plus radical (on a un plan fixe, proche en cela du cinéma structurel américain qui fait de la durée, de l’effet de boucle, etc., la matière même des films) et plus explicite : on lit la montée du désir sur le visage d’une femme qui se masturbe hors champ. Ce double phénomène de voyeurisme (l’auteur, qui est l’œil du spectateur, scrute ses sujets qui, à leur tour, le regardent et, par contre-coup, nous mettent face à notre propre statut de scoptophiles) sera la marque de tout le cinéma de Dwoskin.
Quelques constantes esthético-thématiques, mises au point par l’auteur dans ses premiers courts métrages, se retrouveront entremêlées dans quasiment tous ses moyens et longs métrages. Il y a d’abord, dans le couple de films évoqués plus haut (on croise cette binarité, la « douce » et la « dure », dans les films tournés à l’époque par Dwoskin), la volonté de percer les apparences grâce à un regard d’entomologiste sur ses sujets-cobayes. Ensuite (parallèlement en fait), le cinéaste sexualise sa caméra. Take me (1968), Trixi (1970) ou Lost Dreams (2003) en offrent de pertinents échantillons. Dans le premier, la fille n’est plus immobile; elle passe et repasse devant l’objectif, elle le regarde, puis finit par se déshabiller. Avec Trixi, la caméra devient active (c’est la face « dure » de Take me), elle se rapproche, s’éloigne de la fille, la cadre, la recadre… pendant qu’une voix off appelle à satiété (Dwoskin utilise dans ses oeuvres la musique répétitive de Gavin Bryars) le nom de la jeune femme : « Trixi, Trixi »… Lost Dreams est une ode, faite aussi bien de plans courts que d’autres plus insistants et lyriques, à une multitude de jeunes femmes qui peuplent les fantasmes du cinéaste.
La troisième dimension que le cinéaste introduit dans ses films est celle du jeu : activité ludique dont les partenaires sont en général des femmes. L’archétype du genre est Chinese Checkers où deux d’entre elles jouent à un jeu de société, puis leurs doigts passent du damier à leurs visages. Ce cérémonial est renforcé par l’apparition, à chaque contre-champ, de maquillages épais sur leurs figures. Cette surcharge de crèmes peut revêtir l’ensemble d’un corps (comme dans Take me) et se rapprocher de l’happening. Dirty (1965-71), qui est la version « hard » de Chinese Checkers, montre un couple de femmes dénudées en train de se caresser. Dwoskin a laissé tous les défauts de la pellicule (flous, saletés, sous et surexposition) afin d’accroître l’aspect physique, opaque, de son film. Toutefois, et cela même dans ses longs métrages, l’auteur s’arrête aux préludes et ne filme jamais de scènes d’amour physique explicites. Dans son premier long métrage, Times for (1970), Dwoskin entremêle tous ces paramètres en une somptueuse fête du regard.
Parmi ses courts métrages, Me, Myself and I (1968) tient une place particulière. On y voit un couple homme-femme s’épier l’un l’autre dans l’intimité (toilette, bain, vie quotidienne) ; chacun étant à tour de rôle sujet et objet, regard de la caméra et regard caméra. Ce film est un peu la maquette de Behindert dans lequel Dwoskin montre sa relation avec Carola Regnier : sujet de désir et sujet désirant, privés de la possibilité physique de s’exprimer à travers le coït, vont cependant traduire leur attirance par des codes d’une infinie richesse. En 2003, revenant, avec Dear Frances, à son regard scrutateur et impressionniste des débuts, le cinéaste esquisse un poignant témoignage de et sur son amie Frances Turner qui vient de décéder.
Dwoskin, en fait, ne réalisera jamais de longs métrages bien huilés lorsque ses films dépasseront l’heure voire les deux heures (Dyn Amo, 1972; Central Bazaar, 1975). On aura affaire, comme chez Chris Marker ou Johan Van der Keuken, à des ensembles filmiques formés de morceaux hétérogènes : longs plans séquences voyeuristes, montage rapide, réalités intimes ou plus générales. Qu’il recompose une pièce de Frank Wedekind (Tod und Teufel, 1973, avec Carola Regnier), ou qu’il mette en espace un texte de Bataille (La solution imaginaire, 1988), on note toujours cette appétence chez Dwoskin pour le fragment, pour le regard qui s’attarde longuement sur une femme qui se déshabille, pour le cérémonial.
Les premiers films du réalisateur nous documentent sur la génération de la contre-culture : les réactions des sujets dans les courts métrages des années 1960 et 1970 sont différentes de celles des films plus récents. Pour les protagonistes contemporains, la caméra est devenue un instrument quasi inoffensif, neutre; les actrices de La solution imaginaire (Further and Particular) font comme si elle n’existait pas. Tous ses films nous renseignent sur Dwoskin lui-même, sur sa situation d’artiste et de handicapé.
Les spectateurs qui se sont familiarisés avec les courts métrages de l’auteur trouveront une continuité avec ses moyens métrages documentaires (Shadows from Light, Face of our Fear) et son dernier long métrage autobiographique (Trying to Kiss the Moon).
Pour Shadows from Light, oeuvre consacrée au photographe Bill Brandt, Dwoskin a élaboré une scénographie proche de celle conçue par Raoul Ruiz dans L’hypothèse du tableau volé (1978) : une jeune femme dévêtue nous fait visiter un appartement où sont exposées les photos (portraits et nus surtout) de l’artiste. Ici, pas de commentaire didactique continu, mais des citations de Crevel, Susan Sontag, de Chirico et Brandt lui-même. Ces dernières sont à la fois anecdotiques (la vie dans toute sa simplicité n’est-elle pas le sujet constant des films de Dwoskin, cinéaste plus physique que cérébral ?) et très éclairantes. Lorsque Brandt a vu Citizen Kane de Welles, il a voulu retrouver ce même type de perspectives. Puis l’artiste décrit la genèse d’une photo dont il est fier : il a dû faire venir le peintre Francis Bacon à un endroit précis au moment où le jour était sur le point de disparaître. La caméra de Dwoskin caresse les photos comme elle le faisait avec les corps de femmes des premiers courts métrages, cherchant à tisser entre elles de subtiles correspondances.
Dwoskin n’est pas l’homme des théories ni des explications, il se contente d’être le chantre du personnel, du privé. Pourtant, il a éprouvé le besoin, en 1992, de consacrer un moyen métrage à l’image des handicapés dans nos sociétés : Face of our Fear. Il mélange les témoignages des sujets sur leurs difficultés quotidiennes et brosse, à travers des extraits de Notre-Dame de Paris (Dieterle, 1939), Freaks (Browning, 1932) ou Elephant Man (Lynch, 1980), une géographie de l’inconscient collectif qui diabolise moralement le handicap physique pour justifier ses réflexes de rejet : le handicapé a souvent, dans les pièces de cette iconographie, un mauvais fonds moral, une maladie, un comportement suspect…
Le caractère militant que l’on trouve dans Face of our Fear a disparu de Trying to Kiss the Moon. Ce film se présente comme un journal filmé à la Jonas Mekas. Il est composé d’une mosaïque d’éléments aux statuts diégétiques complètement différents. Il y a d’abord les home movies de Dwoskin père qui nous permettent de voir le petit Stephen avant sa maladie, courir, jouer avec les autres enfants. Trying to Kiss the Moon est un peu la version claire, optimiste, de Family Viewing d’Atom Egoyan (1987) ou du Voyeur de Michael Powell (1960) : les images de Dwoskin senior ont aidé à structurer la personnalité du jeune Stephen, à lui donner le goût du film personnel. Les extraits des propres bandes du cinéaste, en montage asynchronique, se superposent aux images en 8 mm où s’ébat l’enfant. Nul apitoiement dans cette œuvre : le gamin, l’homme, l’artiste, l’érotomane, le cinéaste sont une même personne aux milles facettes. Dwoskin consacre, avec Dad (2003), un portrait impressionniste à ce père décédé en 1976. La sœur du cinéaste dit de cette courte bande que « c’est une peinture en mouvement ».
Version actualisée d’un texte paru dans la revue Bref n° 25 – 1995 et reproduit dans le catalogue de la 13ème édition du Festival Côté Court de Pantin – juin 2004.