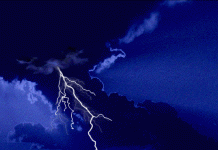Keja Ho Kramer : Ces deux derniers mois, nous avons travaillé sur notre film, I’ll be your eyes, You’ll be mine, nous avons eu ces discussions en particulier sur le mode de fabrication et l’une d’elles portait principalement sur le vocabulaire que nous utilisions… Je pourrais te demander comment tu en es venu à expliquer ton travail et quels sont les mots que tu utilises pour le faire.
Stephen Dwoskin : Oui, c’est en quelque sorte de la fabrication d’images par improvisation. C’est un travail d’assemblage d’éléments accumulés, processus qu’utilisent habituellement les peintres ou les compositeurs, au cours duquel on ne sait pas précisément l’emplacement de telle ou telle pièce, tout en ayant une idée de là où on va. Dans ce procédé – qui utilise ou collectionne les images – il n’y a pas de structure d’ensemble conçue au préalable, on place ces images dans une sorte de « flux de conscience » comme si on les déposait sur la palette (la fenêtre de montage), la manipulation des images étant une façon de penser la séquence. Donc l’image qu’on place en premier déclenche en quelque sorte l’image suivante. Il n’y a pas vraiment de règle quant à la façon de faire, c’est un processus instinctif qui consiste à relier les choses par l’élaboration d’une réflexion sur ce qu’on essaye de dire et comment ces images vont contribuer à cette réflexion. Puis le lien entre ces différentes images commence à se faire, comme une sorte de narration sous-jacente, et c’est tout à fait comme la peinture dans un sens. On pose les couleurs de base, ou les formes, et on commence à les manipuler, par addition ou soustraction. On construit à partir des premiers éléments placés, images, couleurs ou autres, venus impulsivement. Et, en les travaillant, on module les divers éléments – par exemple, les différentes couleurs –, jusqu’à ce que cela prenne forme.
K. Ho K. : Qu’est-ce que la vidéo t’a apporté dans ce processus ?
S. D. : Ce que la vidéo apporte… Ne prends pas de photos pendant que je parle, ça m’empêche de penser… Je pense que c’est plus l’ordinateur que la vidéo. L’ordinateur apporte une palette très souple qui permet de contrôler totalement tous les éléments et, sur le plan économique, d’avoir beaucoup plus d’éléments pour beaucoup moins cher. Cela veut dire que tu peux aller filmer quand tu veux, ou faire les images qui te manquent, sans avoir besoin d’une grosse production. Si tu as tout à coup besoin d’un interrupteur ou d’une table ou de tout autre composant d’une pièce de ta palette, la vidéo te le permet, un peu comme un Polaroïd, tu peux créer ce que tu veux instantanément et l’intégrer dans le film, tu as donc cette souplesse. Mais c’est grâce à l’ordinateur que tu peux tout mettre devant tes yeux, comme un canevas. Tu n’as besoin de personne d’autre ni d’autres techniques, pas besoin d’aller au labo ni ailleurs, tu as tout devant toi. Cela ressemble beaucoup à la palette des peintres sur laquelle tu peux vider autant de tubes de peinture que tu veux ou utiliser les pinceaux à ta convenance. Cela veut dire aussi qu’avec la fenêtre de montage et ta façon de monter – prises et séquences – tu peux bouger les éléments facilement, avec une grande souplesse et essayer plusieurs montages sans avoir à sortir, dérouler et ranger ces grandes bobines de pellicule sur de grosses tables de montage. Le processus ressemble plus à la pensée et le visionnage est plus spontané, plus rapide et plus global… tu peux travailler sans devoir t’interrompre pour trouver le scotch de raccord ou autre chose. D’une certaine façon, c’est plus compact. Je ne crois pas que ce soit la vidéo, je crois que c’est vraiment le montage sur ordinateur qui a fait la différence car on peut aussi bien transférer ses rushes sur l’ordinateur et obtenir la même souplesse théorique.
K. Ho K. : Quand tu travaillais sur les lettres vidéo avec Robert, vous travailliez tous les deux en Hi-8, penses-tu qu’elles auraient été différentes si vous aviez évolué vers le montage virtuel ?
S. D. : Pour les lettres vidéo, la règle était très spécifique : pas de montage !
Cela avait plus à voir avec la vidéo au sens où nous pouvions réaliser les journaux ou les lettres de façon très basique. Nous pouvions parler seuls et faire tout nous-mêmes dans la mesure du possible. Nous n’avions besoin de personne pour tenir la caméra, pas besoin d’envoyer les rushes au labo, donc c’était très direct. Cela ressemblait plus à de l’écriture du fait que cela n’impliquait personne d’autre. Le fait d’écarter le montage rapprochait ces lettres d’un simple courrier – on ne monte pas vraiment ses lettres quand on écrit à des amis. L’idée était simplement de faire tout ce qu’on pouvait avec la caméra.
K. Ho K. : Avez-vous respecté cette règle ou vous est-il arrivé de tricher ?
S. D. : Je l’ai respectée. Robert aussi, jusqu’à un certain point. Je pense que le problème, après le premier échange de lettres, a été le son. Nous avons tous les deux – sans savoir que l’autre le faisait – commencé à détourner la règle initiale en enregistrant le son séparément. On se servait du son caméra pendant qu’on filmait, parce que le problème, dès les premières lettres, était que tout ce qu’on filmait devenait notre sujet de discussion. Ce qu’on regardait ou la façon de le faire nous détournait de nos pensées, donc nous avons commencé à enregistrer nos paroles sur des magnétos, moi tout du moins… Robert a dit que lui aussi, à cause de soucis techniques avec les entrées micro de la caméra dus à des problèmes d’impédance des entrées Sony. En fait, dans sa dernière lettre, Robert a préenregistré sa voix décrivant son appartement à Paris, puis il a filmé séparément la maison de campagne en enregistrant cette bande son au tournage. La piste son a été faite à un endroit et les images à un autre.
K. Ho K. : Ces lettres vidéo… est-ce qu’elles sont venues d’une sorte de révolte contre une façon de réaliser les films vers laquelle vous vous tourniez tous deux à l’époque ?
S. D. : Je ne parlerais pas de révolte. Je dirais plutôt que c’était par ennui ou en réaction contre cet espèce de formalisme dans lequel nous tombions pour faire des films. Devoir écrire des scénarios, faire tout ce travail de production pour trouver de l’argent et tout ça. L’idée des lettres était une façon vraiment spontanée de travailler sans avoir toute cette préparation, ces dossiers à remplir et toutes ces formalités. Dans un sens, c’était une tentative de revenir à un processus basique de réalisation de films.
K. Ho K. : Est-ce que vous communiquiez en dehors de ces lettres ?
S. D. : Oui, de façon très obtuse. On s’envoyait des e-mails et on faisait des commentaires, mais rien de détaillé. Les lettres ont plus ou moins commencé au moment où nous nous interrogions sur notre place par rapport au fait de vivre en Europe. Robert commençait à se demander s’il allait prendre un passeport français. En fait c’est quand le gouvernement américain a permis la double nationalité que la question a commencé à se poser, à savoir, pour moi, la nationalité britannique, et pour Robert, la nationalité française. C’était la question de notre relation en tant qu’Américains vivant en Europe, je crois plus pour Robert, la question du retour, ce qui se passe si on change de nationalité, d’allégeance et, plus généralement, notre position dans le contexte européen. Les Européens ne nous ont jamais vraiment acceptés comme européens et l’idée de retourner aux Etats-Unis faisait un peu peur – qu’est ce que tout cela veut dire ? C’était une question, nous ne connaissions pas la réponse, ce qui explique en partie la raison pour laquelle ce dialogue a commencé.
K. Ho K. : Finalement, tu es devenu britannique ?
S. D. : Non.
K. Ho K. : Avez-vous tiré des conclusions particulières de vos discussions ?
S. D. : Non. Les premières lettres évoquaient ce sujet. Robert a commencé quand il était à Berlin avec le DAAD (Office allemand d’échanges universitaires). Je ne sais pas bien où j’en étais alors, songeant à rentrer, mais je n’avais pas beaucoup de latitude… Quelle était la question ?
K. Ho K. : Si vous en êtes arrivés à des conclusions ?
S. D. : Non, mais je crois que c’était aussi pour construire notre relation, entre Robert et moi. Bien que nous nous connaissions depuis longtemps, nous n’avions jamais beaucoup parlé, finalement c’était une façon d’établir le dialogue entre nous. En tant qu’Américains, cinéastes de la même génération, du même âge et tout !
K. Ho K. : Mais vous faites des films assez différents…
S. D. : Pas vraiment, le style est différent, mais le ressort est le même.
K. Ho K. : Peux-tu expliquer ?
S. D. : Dans les deux cas, c’est une façon de chercher à traiter de nos idées personnelles ou de notre tentative d’examiner le monde qui nous concerne l’un et l’autre, une façon d’exprimer cette relation entre nous et ces choses que nous voyons et que nous voulons faire découvrir à tout le monde. Comme Route One qui est une recherche de Robert sur sa relation à l’Amérique, sous bien des aspects. Monter et descendre cette route, ce que nous avons fait chacun séparément, quand nous avions 20 ans. Certes, les films sont différents, mais ils proviennent d’une même façon d’être au monde, à la recherche de quelque chose, en se servant du film pour documenter cette recherche et peut-être prendre une décision là-dessus à travers les films. D’un point de vue stylistique, ils sont différents – Robert penchait plutôt vers le verbal et l’espace extérieur, moi plus vers le visuel et les lieux clos, mais nous expérimentions tous deux la façon d’écrire tout cela – une forme de journalisme en quelque sorte – comment chercher au travers des questionnements… et la question du film en général. On ne répondait jamais à ces questions, mais on essayait de voir, avec les divers éléments du film, s’il y avait une ébauche de réponse. Dans ce sens, la réalisation du film répond à une motivation semblable, c’est comme rechercher une question restée sans réponse, par un processus d’essai d’externalisation de cette question au travers du film.
K. Ho K. : Peux-tu imaginer le dialogue que tu aurais avec Robert s’il était encore dans les parages ?
S. D. : Oui, je pense que cela aurait été plus personnel. Je crois que la question « Où sommes-nous ? » aurait beaucoup changé et serait devenue : « Où sommes-nous allés ? » Nous allions nous remettre aux lettres vidéo, nous en avions parlé deux mois avant sa mort. Nous allions recommencer dès qu’il aurait fini son dernier film, nous en avions discuté deux ou trois fois par e-mail et nous nous étions vus à Dunkerque quelques mois auparavant. Nous aurions sans doute recommencé après le film… nous étions prêts à le faire… je ne sais pas, c’est difficile de dire ce qui serait arrivé. Je pense que les lettres auraient été plus construites, parce que, d’une certaine façon, au début, les lettres nous permettaient de revenir aux bases, comment travailler de façon singulière ; techniquement aussi, les choses auraient changé, parce que le Hi-8 n’était pas vraiment satisfaisant. Maintenant, avec la DV, la réalisation aurait été probablement plus intéressante, ou différente certainement.
K. Ho K. : Donc le fait de finir ce film te met dans un sentiment de rétrospection, introspection, rétrospection à propos de…
S. D. : … de quoi ?
K. Ho K. : De souvenirs, de retour en arrière…
S. D. : En fait, cela ne m’a pas renvoyé vers mes souvenirs parce qu’il parle plus de toi, en fait, de toi et Robert. Cela n’a pas ranimé mes souvenirs de Robert, comme c’est ton cas. Cela m’a relié différemment à lui comme ami, me l’a fait voir différemment et mieux. J’ai appris sur lui des choses que je ne savais pas, je t’ai vu, toi, t’intéresser à ton père.
K. Ho K. : Ce que tu as vraiment fait ou pas fait quand tu as tourné Dad, parce que c’est un film aussi très particulier…
S. D. : Dad est différent, je pense ! La relation que j’avais avec les images de mon père, ou avec les images de lui, était différente, parce que je n’avais pas la voix. Ta relation à Robert est immédiate, le mien est mort il y a 27 ans. La réalisation de mon film Dad réfléchissait des souvenirs de lui respectueux et rêveurs ; le type d’expressions qu’il avait et ses gestes et la façon dont il faisait les choses. C’est comme un poème, un poème chorégraphié d’images dont je me souviens de mon père car ces images ont été captées. J’ai ressenti beaucoup plus de respect pour lui en les regardant. Le film est un fragment d’amour et de respect pour mon père, peut-être pour le ressusciter d’une certaine façon, parce que je n’avais jamais vraiment beaucoup pensé à lui jusqu’à ce que je commence à approcher son âge, tu vois… Cela m’a donné envie de mieux le connaître ou d’avoir une chance de lui parler un peu plus, mais maintenant c’est trop tard, trop lointain, il y a trop longtemps !
Je crois que ce que tu as dû vivre avec ton film, I’ll be your eyes, you’ll be mine, est très différent de ce que j’ai vécu avec Dad. Toi, c’est plus immédiat, malgré les six années passées, tu as hérité de quelque chose, tu as un héritage que je n’ai pas. Tu as hérité d’un coffre aux trésors, d’archives, tu as reçu beaucoup, moi, je n’ai hérité que de quelques bouts de pellicule et de beaucoup de souvenirs incomplets. Toi, tu as reçu beaucoup de matériau, beaucoup plus, trop, cela fait une grande différence d’avoir beaucoup de quelque chose ou très peu de quelque chose à partir duquel travailler. Et, bien sûr, tu avais une relation avec ton père bien différente de la mienne.
K. Ho K. : Qu’est-ce que tu veux dire ?
S. D. : Eh bien, tu es une fille et la façon dont tu parles de Robert comme Papa, c’est un truc de père et fille… et tu as travaillé avec lui, tu représentais une sorte d’extension insaisissable de lui-même, ce qui t’ennuyait et te ravissait dans le même temps. Je n’ai jamais travaillé avec mon père, je n’ai pas eu ce lien. Mon père était comme un fantôme et mon film Dad est une tentative de ressusciter son image en déposant le film sur sa tombe, à la manière des Russes.
K. Ho K. : Alors, à quoi va ressembler ton prochain film, après Oblivion ?
S. D. : Je ne sais pas exactement. J’ai quelques idées, mais trouver les gens et l’argent me semble hors de portée. J’aurais aimé avoir une meilleure idée ; j’ai envie de travailler un peu plus avec d’autres gens actuellement…
K. Ho K. : Cela t’a-t-il surpris de réaliser Oblivion ?
S. D. : Surpris ? Qu’est-ce que tu veux dire par là ?
K. Ho K. : À quoi il ressemble, après Visitors, et cette méthode de travail… ? Je ne connais pas assez bien ta filmographie, mais combien de films as-tu réalisés selon le procédé dont nous parlions au début ?
S. D. : Aucun, je ne crois pas qu’Oblivion représente pour moi… dans ce cas… une percée, parce que ça a été un travail à petite échelle, comme Dad, comme Visitors, et je l’ai inscrit dans un cadre plus large, un film plus important, autrement dit un travail de film de long métrage, pour appuyer l’idée que cette méthode de travail ressemble à celle qui conduit de la nouvelle au roman.
J’avais déjà réalisé des films longs auparavant, mais ils étaient plus… plus écrits, ils avaient plus de repères concrets à suivre au cours du travail, je crois que Trying to Kiss the Moon a été ma première tentative de rassembler un film dans un tableau, si tu veux, mais en film, donc c’est plus du collage/montage.
Mais Oblivion relève plus de la peinture de par son caractère tactile, et l’esthétique de la peinture entre dans le cadre en quelque sorte. J’ai été surpris qu’il atteigne cette intensité sans tomber en morceaux. J’aimerais continuer à travailler comme ça sur d’autres idées, d’autres histoires ou récits, je suppose que mon problème, c’est que je ne sais pas si j’ai l’énergie pour les mener à bien, ce n’est pas l’absence d’idées, c’est l’absence de force pour le faire. Oblivion m’a épuisé, d’une certaine façon, émotionnellement… parce que de Another Time à Visitors… faire des plans de plus en plus serrés dans un espace intérieur… on ne peut pas s’approcher plus, en fait. Je dois plutôt en sortir au lieu d’aller plus loin encore et il n’y a pas beaucoup de place pour bouger. Mais c’est aussi un état d’esprit, c’est ça la difficulté avec les films personnels. Ils sont une manifestation de nos positions et de nos sentiments, et si on se sent suffoquer – c’est très difficile de faire un film après Oblivion –… on se sent de plus en plus étouffer, sans pour autant mourir. Donc, hormis un changement de circonstances, je ne sais pas vraiment ce qui va suivre.
K. Ho K. : Penses-tu que Robert était dans le même état après son dernier film, étiez-vous en contact après Cités de la Plaine ?
S. D. : Je crois qu’il en était arrivé à ce point. Je crois qu’il était un peu usé par cette quête, trouver son chemin, d’une façon abstraite, ne sachant plus comment manier le matériau sans se répéter ? Sans savoir jusqu’où aller ! Il faut beaucoup d’énergie et de motivation pour faire cela, parce que faire des films, c’est un peu une drogue, et si on fait une overdose, c’est assez difficile. On peut s’y perdre, comme une défonce, et puis se démobiliser, tu n’es pas d’accord ? Je ne sais pas où en était Robert dans sa vie privée, tu le sais probablement mieux que moi.
Je pense qu’il n’y a pas d’autre vie que le film dans lequel on est plongé. Réaliser un film, c’est la vie !
K. Ho K. : Exactement, donc il n’habitait pas à la maison, il tournait tous les jours.
S. D. : Mais cela a aussi à voir avec comment on se sent avec soi-même à ce moment-là.
Pour que la balle continue de rebondir… tu sais, c’est parfois facile de renoncer. Je pense que faire des films pour un grand nombre de gens, c’est vraiment difficile, si tu perds ta motivation l’espace d’un instant, tout peut s’effondrer, c’est très lourd ou très intense, et cette intensité peut être épuisante, très…
K. Ho K. : Cela me faisait rire de tourner, I’ll be your eyes, You’ll be mine, dans ces situations où je tirais le trépied sur une bicyclette parce qu’il était trop lourd à porter, et toutes ces caméras sur mon dos, aller au milieu d’un champ pour enfiler ce costume vert, placer la caméra et n’avoir personne derrière, marcher de droite et de gauche, et dans ces moments où l’on travaille dans une telle solitude, on n’a plus que sa propre motivation et soi-même pour continuer…
S. D. : Oui, c’est la même…
K. Ho K. : … constatation… Mais même quand on travaille tous les deux tout seuls, qu’on a l’impression que le monde n’existe pas, qu’il se réduit juste à ces images qu’on a assemblées, je suppose qu’on peut devenir fou au bout d’un moment.
S. D. : Oui, comme Boris, ou Tonino, ou tant d’entre nous… c’est vraiment de l’ordre de la folie, au sens large du terme.
K. Ho K. : Il semble que Robert recréait cet espace quand il se réfugiait à la campagne pour monter tout seul, il pré-montait ses films en vidéo avant de les amener dans la salle de montage pour travailler avec un monteur. Cela lui permettait d’avoir cette tension et cette intensité, et je me demande vraiment… Comme j’ai grandi avec cette énergie autour de moi, cela me semble naturel et le contraire serait plus déstabilisant, mais je me demande si Robert aurait changé de méthode s’il s’était mis au montage virtuel, car il ne travaillait qu’en analogique.
S. D. : Ce serait probablement devenu plus intense, c’est difficile à dire, en fait, tu le sais peut-être mieux que moi, je n’ai jamais été avec lui quand il travaillait, je le voyais surtout en société.
Je pense que d’avoir réalisé ce film avec toi a été une expérience pour moi aussi. Cela a été difficile, j’ai dû me retenir beaucoup plus qu’à l’habitude, car c’était plus ton espace à toi, ta recherche que la mienne. Moi, j’ai essayé de voir comment te permettre d’y aller plus avant et ne pas m’imposer dedans, de t’ouvrir le chemin.
K. Ho K. : Merci.
S. D. : Parce que c’est un film sur toi et ta relation avec Robert, et avec les autres. J’ai fait un peu le « chef de la police » et tu étais le détective. Tu devais me faire un rapport pour voir si les preuves que tu avais trouvées étaient légitimes, si elles tiendraient devant un tribunal.
K. Ho K. : Oui, en quelque sorte, mais je crois que c’était aussi une transmission assez précise ; sur une façon de travailler, je crois que je commençais à l’aborder quand je suis venue monter chez toi mon film sur San Paulo, mais, cette fois-ci, c’était précisément quelque chose que je voulais vraiment apprendre et mieux appréhender, car je pense que la façon dont Robert faisait les films – je crois que je suis un peu entre vous deux – était l’étape suivante que je voulais atteindre. Ce que je voulais vraiment avec ce film, c’était comprendre un certain type de liberté, de le vivre et voir comment cela marche. Je pense que Robert était beaucoup plus structuré dans un certain sens.
S. D. : Éric disait que c’est un autre type de structure, j’ai une structure qui peut paraître physiquement plus lâche mais qui est guidée par un point de vue très affirmé et je m’assure des éléments – aussi obtus puissent-ils paraître au premier abord –, je m’assure que la structure tient bien dans l’idée, sans perdre de vue cette idée, sans vaciller, ni modifier l’idée de départ qui permet, dans mon cas, de rassembler des morceaux d’images, apparemment prises au hasard, et de les faire tenir ensemble ; alors que Robert travaillait beaucoup plus à partir d’une structure… architecturale, au cours de son travail, il s’assurait que les éléments suivaient sa pensée plutôt que d’utiliser le matériau pour créer la pensée. Je pense que ce sont des façons différentes de structurer son idée… on peut aussi penser la structure comme une discipline pour travailler comme j’ai travaillé. La façon dont tu as travaillé sur ce film exige une discipline, une continuité de la pensée ; si tu perds cette continuité, tu perds la structure du film, donc il faut essayer de maintenir la continuité de la pensée plutôt que de se référer à un diagramme extérieur… si tu vois ce que je veux dire…
K. Ho K. : Oui, comme je l’ai expérimenté, je vois bien…
S. D. : J’aime bien cette façon de travailler car le montage est une partie du tournage. Normalement, ce sont deux activités séparées, mais avec cette méthode c’est presque comme si le tournage et le montage s’imbriquaient l’un dans l’autre dans un processus singulier… qui rappelle encore une fois le travail du peintre, où il y a deux choses à faire en même temps, réaliser le tableau et le structurer, puis avoir la capacité de le modifier et de tourner autour, continuer à le manipuler comme un bloc d’argile, jusqu’à ce qu’il trouve sa forme, découvrant au fur et à mesure, incorporant les matériaux qu’on trouve ou lui répondant, instaurant un dialogue avec l’œuvre, avec le film. Au cours de la réalisation du film, ce dialogue devient effectivement une partie du film que les autres commencent alors à ressentir et à comprendre, il acquiert ainsi sa propre vie.
Il n’y a que très peu de présupposé, car c’est un processus de découverte, presque comme de découvrir des accidents et de laisser ces accidents s’intégrer à ton vocabulaire et ne pas dire : « Bon, je ne peux pas me servir de ça, parce que ce n’est pas ce que j’avais prévu », mais « Je peux l’utiliser parce que, désormais, il apporte une contribution à mon idée ».
Londres, samedi 11 février 2006
Traduit de l’anglais par Marie-Sylvie Rivière
Texte initialement publié dans le n°17 de la Collection Théâtres au cinéma : Robert Kramer.