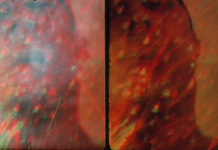L’Américain Frederick Wiseman et le Néerlandais Johan van der Keuken, compagnons de route fidèles de ces dix ans de festival, incarnent parfaitement les deux écoles du documentaire moderne : l’analyse méthodologique des institutions, héritée d’une pratique approfondie des sciences humaines, pour le premier; le montage et le collage, en affinité avec les arts modernes, pour le second. Les deux hommes ont néanmoins un point commun : ces éternels poseurs de questions, ces prospecteurs invétérés sont des emmerdeurs démocrates. Tous les documentaristes actuels sont obligés de se situer par rapport à eux (Depardon, entre autres, doit beaucoup a Wiseman). La rencontre entre les deux hommes, organisée par Jean Rouch et Chantal Gatineau, s’imposait.
Libération : En réalisant Titicut Follies, que vous avez tourné dans une prison destinée aux déments criminels, aviez-vous déjà, Frederick Wiseman, le projet de vous spécialiser dans le traitement des institutions ?
Frederick Wiseman : Dans les années 1960, le portrait d’artistes (Jane Fonda ou Bob Dylan) ou de politiciens était à la mode. Ça ne me disait rien. Je voulais que la vedette de mes films soit une communauté. Après Titicut Follies, en 1967, j’ai souhaité continuer dans la même voie : appréhender un certain mode de vie américain tel qu’il se dévoile à travers le fonctionnement des institutions. J’ai besoin de règlements intérieurs et de lieux clos pour capter ce qui m’intéresse dans la mentalité de mes compatriotes.
Libération : De prime abord, Johan van der Keuken, votre démarche est à l’opposé de celle de Wiseman.
Johan van der Keuken : Je vous vois venir. Vous voulez jouer l’unité contre l’hétérogène. OK, je travaille dans l’hétérogène. Mon approche du « réel » est différente de celle de Wiseman. Mais je suis sûr que les finalités que nous poursuivons sont plus ou moins identiques. Le « réel » est impossible à médiatiser à l’état brut. Tous mes efforts visent à créer des moments privilégiés où on a l’impression de comprendre.
Pour moi, l’unité est plutôt thématique et tourne autour du phénomène de la perception. Si j’ai réalisé à mes débuts des films comme Herman Slobbe (1964) – sur les enfants aveugles –, c’est en raison de mon intérêt pour ce phénomène. Le manque donne du relief à l’objet du manque : confronté à la cécité, on comprend mieux ce que représente la vision ! Mais, en même temps, on ne peut pas vraiment imaginer ce qui se passe dans la tête de celui qui ne voit pas. C’est donc cette place de l’autre qui est un peu le pivot central de mes films. Dès Herman Slobbe, l’enfant aveugle (1966), je fais intervenir des réalités politiques : la guerre du Viêt-Nam, le passé nazi… Dans mes premiers courts métrages, il y a un motif central, un individu menacé dans son intégrité. Plus tard, cette menace s’étend et les films éclatent en plusieurs motifs. J’aime beaucoup ce genre de mosaïques (sociétés urbaines, rurales, tiers-mondistes) qui donnent cependant une impression d’unité momentanée.
Libération : Cet aspect « mosaïque » demeure toujours visible chez vous (comme chez Chris Marker), c’est votre signature. Alors que, chez Wiseman, quelle que soit la nature des institutions prises comme cobayes (la police dans Law and Order, l’ANPE dans Welfare, la base aérienne dans Missile), on suit toujours une piste qui va du général au particulier.
Frederick Wiseman : Évidemment, car ce sont toujours les mêmes questions qui m’intéressent : les rapports citoyens/pouvoirs. Pour que tout cela se dévoile, on doit placer l’institution dans un cadre. C’est comme au tennis : quand je joue, je préfère jouer avec un filet. II n’y a des limites physiques, des règlements destinés aux gens qui vivent en institution – et que je n’ai pas envie de transgresser. Si je cherche à illustrer toutes les facettes d’un problème, le film devient trop diffus à mon goût.
Libération : Certains organismes, comme la prison de Titicut Follies ou le centre de recherche sur le comportement des chimpanzés de Primate, se sont néanmoins sentis agressés par vos films.
Frederick Wiseman : Non. Ce n’est pas comme cela que ça s’est passé. Quand les responsables des institutions concernées ont vu les films pour la première fois, ils ont été enchantés. En toute innocence, ils ne pensaient pas qu’il pouvait y avoir des choses contestables dans leurs établissements. Ce n’est que lorsque les journalistes ont écrit que la vie était atroce dans cette prison ou que la vivisection pratiquée sur les singes était abominable, que ces responsables se sont retournés contre moi. Ne pouvant nier que toutes les choses que j’avais montrées dans Titicut étaient exactes, ils ont attaqué le film en l’accusant de violer un territoire privé.
Libération : Ce qui semble vous unir, c’est que vous n’avez pas d’à priori sur ce que vous allez filmer.
Johan van der Keuken Oui, dans un certain sens. Bien que, chez moi, il y ait une dimension que j’appellerai « socialiste » qui diffère, de celle de Fred. J’ai fait des films d’intervention comme les Palestiniens (1975). C’est un film qui date aujourd’hui, car la situation a beaucoup changé. Je vois maintenant les limites de ce genre d’entreprise. C’est comme le problème de l’hétérogénéité qu’on n’arrive jamais à dominer; mais on persévère. C’est de ça que sont faits mes films.
Libération : Que pensez-vous des films de Wiseman ?
Johan van der Keuken : Ils me paraissent intéressants dans l’ensemble. J’ai été frappé, dans Welfare, par des moments où quelqu’un s’exprime, se met en scène et finit par s’assumer comme acteur dans le film. Ce qui m’intrigue toujours chez Fred, c’est quand il prétend n’avoir pas d’idée préconçue sur ce qu’il va filmer. Dans Meat (1976), on sent très bien qu’il connaît le marché de la viande, car il y a une étude pointue du processus de fabrication. Ce qui permet de savoir, à chaque étape, où mettre la caméra.
Libération : Avez-vous subi des influences cinématographiques ?
Frederick Wiseman : Non. J’ai simplement compris tout ce qu’on pouvait faire en voyant certains travaux de Leacock, dans les années 1960.
Johan van der Keuken : Je dois préciser que, pour moi, il n’y a pas de cloisonnement entre fiction et documentaire. Je mets Hitchcock et Leacock au même niveau. J’ai été influencé par Hitchcock, et ce n’est pas un canular. Marnie m’a beaucoup intéressé à cause de ce va-et-vient constant entre ce qui se passe dans la tête des protagonistes et le monde extérieur. Cet échange entre deux degrés de réalités différentes est travaillé cinématographiquement : par un choix d’éclairages, de grosseurs de plans, bref, des moyens tout à fait artificiels. Cela m’a beaucoup guidé dans ma démarche documentaire. Comme Leacock, je tourne des choses très directes, mais j’y introduis une notion de durée, ce qui rend l’ensemble poétique. Cette poésie illustre ma conception des rapports entre l’intériorité et l’extériorité des personnages. Souvent, je recule les limites du cinéma documentaire jusqu’à l’expérimental.
Propos recueillis par Raphaël Bassan
Publié dans Libération du 4 mars 1988 p.39.
PS 2023 : C’était une véritable gageure que de réunir ces deux fortes personnalités qui s’opposent sur plusieurs plans. Le texte est souvent cité mais il est inaccessible car Libération n’a informatisé ses contenus que plus tard d’où mon souhait de le republier sur cet excellent support.