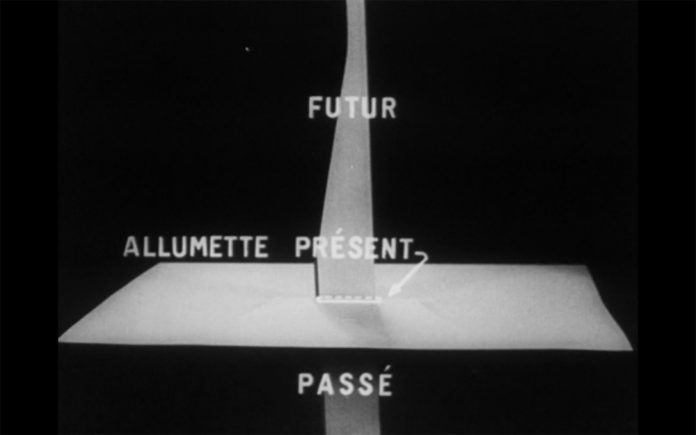
Je travaille parfois auprès de personnes avec qui je pense avoir trouvé un langage. Mais il ne s’agit pas d’un langage au sens propre – celui de la langue française usée ici – et il faut à chaque nouvelle situation faire l’effort de la compréhension, qui prouve que ce langage commun, unique à chaque duo, ou trio, ou groupe de travail, n’est en aucun cas une évidence. J’ai la chance d’avoir avec certaines personnes, à bien des endroits, un « langage » qui n’est pas de parler. Même si celui-ci ne s’écrit sûrement pas, c’est bien lui qui est le moteur et l’indice d’une affinité. Affinité que je souhaite ne voir jamais cesser de s’affiner. Puisque le mot affinité vient d’être posé, je l’élis définitivement, ne souhaitant pas parler de langage, qu’il soit parlé ou non.
Ne rien dire, parfois, sur un tournage ou dans la préparation d’un tournage, ou encore au montage, peut enclencher de la pensée. Et penser à deux ou à plusieurs, cela s’appelle de l’accord. Cela arrive à tout un chacun dans la vie, et surtout en amour. Mais dans le champ du travail, je pense que cette évidence silencieuse arrive trop rarement pour ne pas devoir saisir l’opportunité de la prolonger, voire de l’extraire pour se donner la tâche de la disséquer.
Tout cela n’est certainement pas clair, car il reste encore à tendre vers la clarté, et ce chemin est vital ; et avant de la trouver, j’ai beaucoup de questions – de langage – à poser à mes camarades. Ce sont des questions que je me pose aussi à moi-même, mais j’ai bien trop honte de me les poser seul. J’ai honte même du fonctionnement des questions. J’ai honte non pas de leur origine, qui est celle du doute, mais de la direction déjà toute tracée, inéluctable, des mots interrogatifs. Il faudrait inventer un autre mot que le pourquoi : un mot qui ne cherche pas le bout du tunnel de la réponse, mais qui en englobant la multitude centrifuge d’un monde inconnu, fore les esprits vers leur tréfonds.
Peut-être ce projet de silence est-il envie trop égoïste de ma part : la simple idée de voir ces liens créés avec les autres se liquéfier m’effraie ; mais je pense que dans la crainte nous créons pleinement, et plus que tout, nous nous partageons. Ce partage sépare en nous le désir créateur « horizontal », de l’esprit de compétition inévitable. Cet esprit de compétition s’élabore dans la pleine puissance du je, qui donne bien souvent de brillants personnages. Le désir créateur en commun, lui, accepte l’ignorance, il pousse à se regarder les yeux dans les yeux, à se confronter – se poster front contre front ; nous poussons à la fois notre être propre, dans tout son entier et qui forme ce qu’on appelle individu, vers l’autre individu face à nous, prêts à sacrifier la liberté de notre je pour le remaniement têtu d’un vocabulaire sans sujet, nécessaire à mon avis pour engendrer un film, ou n’importe quoi qui se crée. Là est le parti pris et la définition du silence recherché.
D’où la nécessité de bannir le je, dès lors.
Le je est auteur. L’auteur est devenu institution depuis belle lurette. Ne peut être destitué que ce qui a été institué.
La bonne pensée est comme trop convaincue que le statut de l’auteur le tient rivé, fixé sur une œuvre, et vice versa. Mais le statut est bien le contraire de la statue, qui meurt éternellement de sa condition d’être fixe. Le statut que l’on acquiert, il se transmet, se gagne ; on peut donc le redonner aussi vite qu’il nous a été donné. Ce n’est pas là une chose très difficile à parer.
Mais projetant nos égos dans un monde où les écrans ne réfractent que d’autres égos, il est ardu de nous effacer devant le monde tel qu’il se donne à voir. Tout opère comme si les auteurs s’étaient engouffrés dans ce tel, comme si le voir était simplement affaire de sembler. L’auteur, ce n’est pas moi-même, ni nous-mêmes ; c’est les autres-pas-mêmes, c’est toujours à d’autres nous, en nous, de l’exprimer. Et de lui retirer sa propension à faire semblant.
Les démocrates ont réussi la pirouette géniale de créer une « altérité » accueillant chaque je dans un système hiérarchique faisant de l’humain un semblable qui peut se dire à la fois frère de son commandant qui le soumet, comme de son sbire qu’il frappe. L’étiquetage faussement égalitaire des humains, comme de leurs œuvres, a terminé le processus de destruction de la lutte des classes, en proclamant le tous égaux, le je semblable.
Pour contrer cela, éthiquer – contre l’étiqueté – d’emblée, ces choses auxquelles on aspire, qui nous aspirent. C’est-à-dire, penser en large les circonstances créées, ou disons produites, ne pas les fermer, comme il convient de ne pas laisser fermées les portes de son atelier quand l’on travaille.
À tout prix, briser la chain of command, oublier les rôles, les briser et ne laisser aucune chance à leurs défenseurs, défaire leurs dogmes, être prêt à tout ce qui est nécessaire pour déborder l’œuvre effectuée, effective, faite, à un niveau au-delà, ou en deça, bref tout ce qui est autre part que le cadre social-là dans lequel le je s’engoue. Les cadres fixes devant laisser place aux mi-lieux, d’où l’on ne finira pas de marcher.
Déconstruire l’existence et la possibilité même de la hiérarchie, et par conséquent de l’égalité. Ce qu’il reste est à étendre ce nous, tissé d’impulsions inégales mais liées, assez lâches pour ne pas lâcher, solidaires.
Tout cela, comme beaucoup de choses, commence à l’école.
Voir, penser ou faire un film ne s’étudie pas, cela se voit, se pense et se fait avec la rigueur de la patience, cela se sent dans la nature, dans le tournage, dans le temps qui prélude ou qui le suit. Le travail d’un film ne peut pas être suivi, par dessus l’épaule, par de bons pédagogues passagers, somme toute bien intentionnés. Un bon intervenant, il intervient, dit un bon mot, définitif, et s’en va. Et l’élève se retrouve là, avec autour de lui une chapelle de commentaires qui ne l’amèneront jamais à la raison d’être à l’école, qui est de la fuir. La forme carcérale de l’éducation française, de l’université jusqu’aux grandes écoles, s’appuie sur l’ignorance de son élève. Elle ne fait que l’enfermer entre les murs de la dite connaissance, de la capacité, du su et du compris. Il reste à tout oublier et relire d’un œil vierge l’adage de l’enfant Ernesto : apprendre seulement ce que l’on sait déjà. Adage qui désigne l’éthique d’un « re-voir le monde ». L’inventer.
Ce que certains idéalistes appellent trop naïvement « l’école de la vie », c’est-à-dire tout lieu hors d’une école institutionnalisée, nous manque. Elle semble inexistante pour l’enfant-que-nous-sommes. Même si ce n’est pas la forme ici recherchée, il paraît curieux qu’il n’existe pas de rapport maître/apprenti hors-les-murs dans le milieu dit du cinéma.
Par exemple, on demande à un étudiant en cinéma d’apprendre à être auteur, et si possible auteur d’œuvres, en un temps réduit, assis derrière son ordinateur. Là où il ne devrait y avoir que du faire à œuvrer, toujours et sans délai, il semble impossible de faire œuvre sans qu’on ne demande à l’élève : qu’est-ce que tu (je) as voulu dire ? Impossible donc de faire, puisqu’il faut d’abord dire, dans le cadre d’écoles qui ne font qu’affaires avec le cinéma, où l’on demande à la fois de se faire sujet de création – ce qui suppose a priori un minimum de temps, de maturation – à la fois d’être efficace. Les producteurs attendent des cinéastes la même chose, puisque les institutions dont ils espèrent l’aide financière sont les premiers à préférer le dire au faire.
L’école dira que tout cela, ce n’est pas de sa faute. Que de toute manière, elle ne défend aucune politique, ni idéologie. Ne voulant pas donner d’idéologie, l’école en donne une, celle de la non-idéologie, du « je m’en lave les mains » – de quelle crasse se les lave-t-elle, les mains : il faudrait y répondre plus précisément. L’idéologie étant nécessairement ce qui forge les murs, on voit mal comment puissent naître des fenêtres et des portes où l’air du monde puissent s’infiltrer. Un camarade nous a parlé du radeau qui réussit à flotter coûte que coûte, car les planches liées de cordes lâches maintiennent des interstices, de l’air, à l’inverse d’une coque complètement fermée ; il s’agit donc de tenir toujours ouvertes, ces brèches, et le travail est de réussir à ne jamais laisser advenir ce qui les colmate.
À l’origine, la pédagogie du cinéma s’entremêlait déjà avec sa critique. L’apprentissage du cinéma et sa formulation critique étaient les revers d’une même médaille : que l’on repense aux cinéastes et critiques, ou cinéastes-critiques, tous nés d’un apprentissage d’une éthique du regard et non d’abord d’un faire ; s’il faut exceptionnellement convoquer des « auteurs », citons Renoir qui apprend de son père, en même temps que de Stroheim et Chaplin ; les premiers Cahiers naissent de Bazin, la pensée de Daney particulièrement naît d’un film (Rio Bravo) et d’un article (De l’abjection) ; que dire de Godard, des nombreux cinéastes portugais, japonais et russes. Il y a dans Persévérance une formule de Daney qui pourrait définir l’acte de pensée critique du non-apprentissage ici recherché : rendu au monde qui va.
Mais cet entremêlement n’a pas duré. Tant pis, et tant mieux. Faisons avec.
La brèche semble avoir été recolmatée par l’imagerie qui est pourtant le sujet de la bataille quotidienne de la presse : la critique de cinéma ne questionne plus la télévision, ni le sport, ou encore l’anthropologie, on fait comme si Internet était un média de plus qui nous permettrait simplement de consommer les images un peu différemment. On ne parle pas du monde d’aujourd’hui, tant qu’il n’a pas été passé à la moulinette des films dits actuels.
Auparavant, la critique était créatrice de dialogue permanent entre création et théorie. Aujourd’hui, elle ne regarde plus le cinéma et le mouvement de plus en plus confus des images d’un point de vue éthique, mais comme une petite affaire, personnelle cette fois, entre le critique et l’auteur dont il traite, ou qu’il trait comme une vache jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à en tirer. Est en cause la politique culturelle actuelle, uniforme, et l’emprise des festivals sur les films, carrefours du marché de l’auteur ; des cinéastes y ont acquis un statut, une stature d’auteur indégondable qui les pourrissent sans aucun doute. Et ce carrefour se retourne sur lui-même et se restreint jusque dans ce petit monde dont nous faisons partie, en étant consanguinement coupable d’y appartenir. Coupable aussi la proximité qui constitue nos rapports, la concentration de la capitale parisienne non pas effervescente, mais dégénérescente dans sa multitude.
C’est encore une des raisons du problème : les gens n’habitent pas le cinéma, ils le traversent en faisant beaucoup de bruit sans regarder le monde à travers ses fenêtres. Là où il pourrait y avoir brassage, échange, il y a normalisation, consanguinité. Nous nous sommes mis à la mode de Paris, à son impérialisme culturel, à la recherche de reconnaissance. On parle du désir qu’ont les auteurs à faire des films. Qu’en est-il du désir du monde ? Les œuvres créées et à créer sont-ils advenues d’avoir été désirées par leurs auteurs ? Don Quichotte et Moby Dick ont-ils seulement accouchés de leurs auteurs ?
Les corps de métier, aussi, sont viciés dès le début : c’est le problème d’un apprentissage concret du cinéma dans des institutions (La Fémis, par exemple, affiliée au Ministère de la Culture), où l’on répète des formes sans en inventer à aucun moment – inventer, ne veut pas dire créer de toutes pièces, rappelons que cela signifie : découvrir quelque chose de perdu, qui existait déjà – , où l’on ne va jamais remettre en cause les parcours de production d’un film, de la hiérarchie d’équipe (peut-il ne pas y en avoir ?), du nombre même des membres de l’équipe (combien de personnes faut-il pour faire un film ? une ? cent ? tout est possible mais on feint de l’oublier), alors que tout cela participe à la création de chaque film, d’une œuvre, son essence propre.
Si nous sommes sans ressources, ou quasiment, comment allons-nous monter le film ? Des réponses simples, trop évidentes même : si on a besoin d’ordinateurs, on s’en fait prêter un, ou deux. Si on a besoin de disques durs, volons-les là où ils sont. Si tout cela forme un parc matériel, comme on dit, assez conséquent, reste à trouver le lieu où tout pourra être utilisé et réutilisé par d’autres gens qui auront amené avec eux leurs armes.
Mais le matériel n’est pas une priorité. Nous passons trop de temps précieux à tergiverser sur le matériel. La question urgente est plutôt : où irons-nous, où vivre le travail ? Cette question en enfouit très vite d’autres : le lieu de création des films doit-il être dissocié du lieu de diffusion ? Le lieu lui-même a-t-il les capacités de se mouvoir, le cinéma étant art de motion ? Où pouvons-nous bâtir les ateliers qui permettent, provoquent, critiquent, projettent, substituent ?
L’idée de l’artisanat cinématographique, de l’artisanat tout court, n’est pas celle de la technique bien faite, sous-traitée, mis au profit, à la botte du film, et isolée d’un secteur artistifié, où la pensée nagerait au-dessus de la matière qu’elle manipule. Il nous revient le travail de reprendre cette position stratégique : l’artisanat cinématographique est celui de l’œil. Il vient de ce voir qui est le moteur de la pensée critique que l’on a exclue de tout enseignement aujourd’hui. À sa place, on vend l’idée erronée et conventionnée de l’auteur intouchable. Mais être cinéaste et étudiant n’est pas incompatible en soi, bien au contraire, cela devrait toujours être intimement lié. Monter des structures collectives, créer en groupe, cela ne s’apprend pas, heureusement, mais il est évident que l’institution rejette en bloc la possibilité du collectif. Ce qui est visiblement incompatible dans les écoles, c’est l’idée qu’est devenu l’auteur avec la forme d’étude encadrant par ses murs les « désirs » de plusieurs individualités. Car les films à la première personne (du singulier) que les institutions de la Culture attendent, les écoles les veulent aussi. La rigueur du pluriel manque, et le pluriel est pourtant de l’artisan et de son œil.
On pourrait en ce sens enseigner, non pas une méthode, mais une manière d’ouvrir la possibilité d’être homme ou femme à la caméra, cinéaste volant. Voler dans le sens que filmer se fait en marchant, son œil étant dans ses jambes plus que dans ses mains. Cet outil est si simple, si précaire, que l’atelier et le lieu recherchés en deviennent d’autant plus à portée de main.
Pour sortir doublement de l’enseignement embourgeoisé des universités (leur fausse monumentalité démocratique), des « grandes » écoles (leur système d’éducation dans l’ignorance et le séparatisme non assumé), il faudrait aujourd’hui inventer une école sans aucun matériel, et idéalement sans aucun mur, où les professeurs seraient les élèves et les élèves les professeurs. Ce qui n’est vraiment pas difficile à faire, puisque que les outils sont l’œil et l’oreille – et encore… Ce qui est difficile, c’est de faire comprendre deux choses : que la technique et l’éthique du film sont une seule et même chose (seules quelques lettres ont été inversées entre les deux mots, comme si l’un d’eux avait été secoué volontairement), qu’il faut se mettre à voir, entendre, ensemble, cinéastes et techniciens, en échangeant sans cesse les rôles ; et que la technique n’est pas impossible à concevoir sans outil. D’outils j’entends aussi bien moyens que matières, puisque tout un film se fait apparemment avec. Et le maniement renouvelé des outils, le travail d’équipe, même si l’équipe se réduit à une personne, ou se propage dans un collectif de centaines d’yeux, s’apprendrait sans avoir à apprendre.
La force des outils demeure dans leur puissance à ne pas être de langage. Les outils ne sont pas « innés », ou à apprendre. Ils sont simplement à aller chercher. Et aller les chercher, c’est marcher longuement dans le désert et voir, simplement voir, faire confiance aux mirages, aux images qui ne sont pas de nous mais qui nous prennent en leur sein, redéfinissent à chaque clignement d’œil notre rapport au monde. L’outil à aller chercher, c’est l’œil au bout de la jambe. Il n’y a même pas besoin de caméra pour voir. Il faut pour cela, c’est simple, perforer les déserts indomptés qui se dressent autour de nous, mais dont nous sommes encore aveugles.
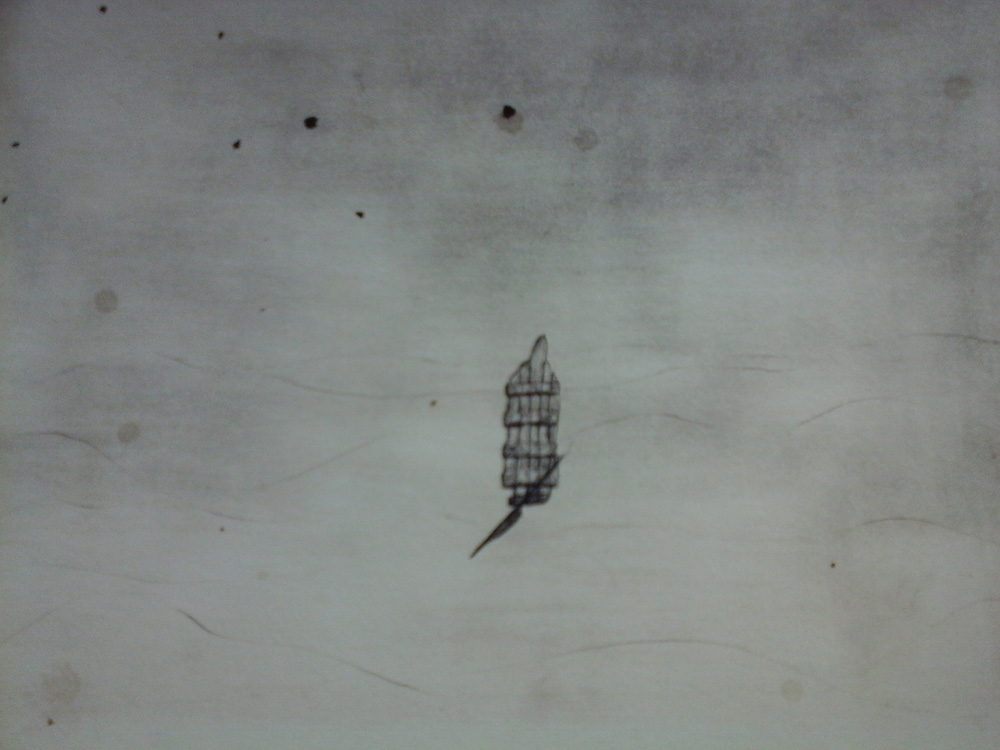
Contact : maxime.martinot@gmail.com






