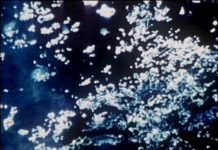Notre première rencontre date de 2002, quand Martine Rousset venait à Lyon présenter deux de ses films. Quelques années plus tard je préparais un mémoire sur la constitution du champ du cinéma hors industrie en France, sur la manière dont ses acteurs ont contribué à le constituer. Martine Rousset faisant partie de ces acteurs, j’ai voulu lui en parler. Nous nous sommes vues pendant l’été 2006, toute une soirée sous un arbre à Paris. Elle racontait comment au début des années 70 elle et d’autres se sont emparés d’outils de création cinématographiques, puis comment ils se sont organisés pour assurer la création et pérenniser la défense de leurs films. C’est de cet entretien, que nous avons récemment repris ensemble, qu’il s’agit ici. Maura McGuinness
ANNÉES 70, LES COOPÉRATIVES
Martine Rousset : J’ai découvert le cinéma expérimental très tôt. Arrivée à Paris dans école de cinéma, j’ai immédiatement rencontré le Collectif Jeune Cinéma (CJC) et les artisans de la future Coopérative des cinéastes. Mes premiers films datent de 77. Je suis arrivée par hasard à une projection du Collectif, en pleine scission, j’ai vu des films absolument passionnants, j’ai immédiatement accrochée avec Patrice Kirchhofer. Il se posait la question de fonder une nouvelle coopérative. La Coopérative des cinéastes était en rupture avec le cinéma commercial mais aussi en rupture avec le cinéma différent de l’époque. C’était politique et très militant. Je ne sais pas si on parlait de cinéma expérimental, je ne crois pas. On était engagé avec des comparses de cinéma qui tenaient à se fédérer et qui tenaient à être en rupture. Quelque chose donc d’une assez grande radicalité, une radicalité par rapport au langage et par rapport aux institutions. Je ne sais pas si on était super défini par ce qui se théorisait sur le cinéma expérimental, je ne le pense pas.
Je ne sais pas si il y avait une clairvoyance. A ce moment-là il y avait 2 ou 3 groupes importants : la Paris Film Coop – des universitaires dont on ne voulait pas faire partie, et le CJC, absolument foisonnant, et conflictuel. Des dissidents du Collectif, et de nouveaux jeunes cinéastes se sont trouvés et ont fondé la Coopérative des cinéastes, c’était une drôle de période, personne ne travaillait sur le même mode. Il était pas mal question de films de femmes, Vivian Ostrovsky était au charbon et s’occupait de diffusion avec Ciné Femmes International. C’était une époque bouillonnante, pas aussi précise que cela. Un peu le chaudron du diable.
Nous étions à la Coopérative des cinéastes passionnément en rupture avec les institutions. Quand Beaubourg a voulu commencer à monter une collection, nous avons dit que nous ne voulions pas leur vendre nos films, on voulait aller à Chilly Mazarin, on voulait aller en banlieue, on voulait… La coopérative – ce qui est important à ce moment-là – c’est le geste libertaire, qui s’articulait avec ce qui restait des mouvements des années 70. Une militance forte dont l’objet n’était pas forcément que le cinéma, si tu vois ce que je veux dire.
Dans nos travaux cinématographiques, on ne se posait pas la question « est-ce que c’est expérimental ou pas ? ». La Paris Films Coop avait déjà des définitions assez précises de ce que devait être le ciné expérimental, nous, on voulait avant tout être en rupture avec le système de production, avec le langage industriel. On venait tous d’une histoire marginale, et l’on ne se regardait pas tellement le nombril. Les choses se faisaient. On ne se sentait pas investis dans le genre. Du tout. On expérimentait.
On était très actif, on montrait les films, il y avait des petites galeries où on amenait nos trucs. Il y avait peu de festivals, on n’était pas obnubilé par un regard sur notre travail. On était dans la dissension, qu’on voulait nette et précise. Alors, dans les relations qu’on pouvait avoir avec d’autres groupes, avec d’autres, c’était bouillant. Je dirais qu’on était plutôt dans un désir de cinéma libre, quelque chose qui plus tard s’est peut-être resserré. Voilà…
Il y avait plein de trucs. Noguez travaillait d’arrache-pied et portait haut un cinéma du corps. Le travail de Katarina Thomadaki et Maria Klonaris, Teo Hernandez et le groupe Barbès Rochechouart. Claudine Eizykman avait sorti son bouquin, La jouissance cinéma. C’était l’université de Vincennes, on n’était pas très d’accord avec ça. La Paris Film Coop était le groupe dominant, des universitaires très théoriques, on essayait de s’inscrire en faux, de prendre les contre-pieds. On avait besoin d’air, de liberté, de faire ce qu’on avait à faire. On était plus quelque part vers un cinéma pauvre. Cinéma libre et pauvre, voilà. On acceptait mal ce qu’il pouvait y avoir de pression théorique du côté de la Paris Films Coop. Après ça a changé, les choses bougent.
Même si on devait penser qu’ils avaient un manque de réflexion politique, les ponts n’étaient pas tout à fait coupés avec le Collectif Jeune Cinéma. On continuait à se parler. Nous allions à Hyères [1] pour montrer des films. J’y allais de temps en temps. On se connaissait, on s’engueulait sur la place publique, mais les gens allaient dans les mêmes lieux évidemment. J’ai toujours été copine avec Marcel Mazé, il n’y avait pas l’ombre d’un problème, on n’était pas d’accord sur le mode, le mode d’existence de ce cinéma-là, ce qui ne nous empêchait pas de rire et de s’amuser.
Après les choses ont changé. Ça c’est vraiment la fin des années 70, la Coopérative a duré 4/5 ans. Oui, c’était une association. Il y avait là David Wharry qui faisait l’anglais, il y avait Kircho qui moulinait ses films dans sa baignoire, il y avait Gérard Courant qui commençait ses cinématons, il y avait des gens qui n’ont plus fait des films après, il y avait Luc et Gisèle Meichler, il y avait Maurice Lemaître qui passait de temps en temps, avec qui les filles s’engueulaient en le traitant d’affreux petit maître macho, il y avait Francine Arakelian, qui était aussi à la Paris Films Coop, parce que ce n’était pas cloisonné non plus tout ça. Il y a eu de grands débats, des grands désaccords, mais en même temps il y avait, comment dire – la vie, tout le monde se rencontrait sur la place publique. Il y a eu des discussions mémorables, des engueulades absolues. À cette époque on a connu Rose Lowder et Alain Sudre qui ont monté une rencontre à Avignon l’été, où il y avait tout le monde. Eux n’étaient dans aucune coopérative à l’époque. Ce qui se passait était une espèce de persistance des années 70 et une gestation des futures années 80. Notre coopérative a eu une existence très brève. Kircho ne voulait plus faire de films, or il était le moteur de l’association. Il trouvait qu’il n’y avait plus à faire de films dans la période politique où nous nous trouvions.
Il fallait arrêter, début des années 80. La coopérative a éclaté. Il y en a qui ont commencé à faire d’autres trucs, il y en a qui ont arrêté de faire des films, d’autres qui ont continué, qui filment toujours, peu importe.
IMPOSSIBILITÉ D’UNE ACTION COMMUNE, LIGHT CONE
MR : Il y avait eu de grandes questions : celle de la diffusion dans les lieux les plus marginaux possibles en refus de ce qui s’annonçait du côté de l’institutionnalisation des choses. Il y avait eu le grand projet de faire un atelier. Kircho disait « il faut qu’on fasse un atelier ». On était très pote avec la London Films Coop, amis avec Steve Farrer, Lis Rhodes, toute cette bande-là, on allait à Londres tout le temps A cette époque, monter des ateliers était quasi impossible en France – les machines coûtaient un fric gigantesque. Ç’avait été un but ça. D’autres accentuaient beaucoup la réflexion théorique, et étaient très préoccupés par la diffusion. Eizykman ne voulait pas d’atelier, le Collectif s’en foutait. Et non, on n’a pas pu le monter, on n’avait pas le fric. Maintenant les machines te tombent toutes crues, à l’époque ça coûtait un blé terrible. Un des buts ç’avait été ça.
Puis il y eut ce grand colloque [2], où ça s’est très mal passé, c’est là que les choses ont un peu capoté après. Oui, je pense…. Ça a mis un coup dans le moral, personne n’avait les mêmes objectifs, donc chacun se repliait un petit peu. Le Collectif a arrêté et puis Yann Beauvais a monté Light Cone. Pas mal de gens de la Coopérative ont basculé vers ce que Yann et Miles voulaient monter. Voilà.
Yann était aussi en rupture avec la Paris Films Coop. Il voulait faire autre chose. Miles McKane, qui lui venait d’ailleurs, aussi. Il y a un certain nombre de gens qui se sont trouvé en accord avec eux assez vite, Vivian Ostrovsky de Ciné Femmes International, s’est mis à faire des films, s’est trouvée en harmonie avec cette association-là, on est parti sur autre chose. La vision qu’avaient Yann et Miles de ce qui est nommé le cinéma expérimental était large, érudite, faisait une place vaste aux cohérences historiques… et n’était pas bouclée.
Il y a eu des ouvertures vivaces. C’était un boulot de dingue. Un boulot de fou cette association, de fou. Je dirais que pendant dix ans Yann et Miles ont passé 24h sur 24 à travailler sans cesse, sans se payer. En faisant des boulots à droite à gauche, en bossant vraiment comme des fous. Les dates je ne sais pas, mais le début de la vivacité du champ à partir de ce moment là, 84 ou 85, je ne saurais pas dire, c’était la création deLight Cone. Vraiment, la naissance de Light Cone a été très importante. Il y avait une dynamique assez forte qu’on doit aux deux garçons.
À cette période on voyait les films dans tous les lieux alternatifs, parce qu’ils faisaient quand même bien bien leur boulot. Un petit peu à Beaubourg aussi, notre grand refus adolescent s’était quelque peu attiédi. C’est dommage, enfin je regrette encore, mais on ne peut pas se balader en pataugas toute la vie. Et ils ont commencé assez rapidement à montrer des films à l’étranger. Ils savaient qu’il fallait sortir de Paris, en province et à l’étranger. C’était pas mal, ça a fait une entente entre les gens, une force et un désir de poser la vision qu’on pouvait avoir de ce cinéma-là, sans pour autant l’ancrer.
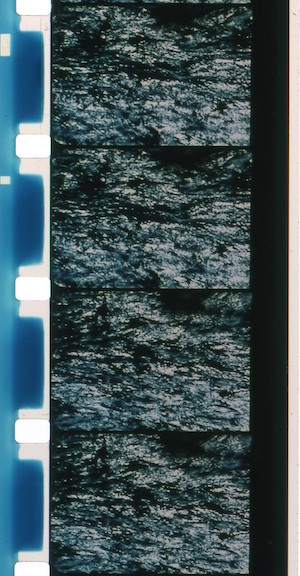
ANNÉES 80, ART CONTEMPORAIN
Il est faux de penser que les années 80 était affreuses. L’histoire c’est l’histoire. On peut dire tout ce qu’on veut sur les oeuvres, on les aime, on les aime pas, mais on ne peut pas nier un travail. Je veux dire qu’à partir des années 80, il y a toute une cinématographie qui se développe dans la dynamique de Light Cone. Vivian Ostrovsky travaille, Cécile Fontaine, Marcelle Thirache, Frédérique Devaux, Rose Lowder etc. Un travail conséquent qui envisageait tous les plans, le travail du film, la question concrète de la diffusion – où et comment montrer les films, comment arpenter cette liberté de cinéma …
La collection de Light Cone s’est monté avec réflexion, pertinence et ouverture. Le passage des années 80 aux années 90, où soi-disant il ne se passait rien, était très difficile, mais les choses se faisaient. Il faut regarder dans les archives, dans la revue qu’on avait monté – Scratch – ça a duré 4 ou 5 ans. Un vrai travail.
Cette collection s’est développé en s’interrogeant sur le lien que ces cinématographies pouvaient nouer avec les autres arts contemporains ou pas, d’ici ou d’ailleurs. Ça, c’était une question qui faisait débat, les pours, les contres : on peut maintenant dire non – oui – peut-être, mais un boulot a été fait. Ce n’était pas réduire ou rabattre, mais questionner ces cinématographies et leurs accointances. Cette réflexion était un moteur important. On parlait beaucoup de peinture, de musique. Il n’y avait pas encore trop de choses en vidéo. C’était plus tard… la vidéo et le cinéma. Là, c’était qu’est-ce qu’on a à voir avec la peinture, les démarches de plasticiens, la musique contemporaine ? Yann aimait beaucoup la musique, et les deux garçons avait une érudition assez précise dans ces domaines. La grande qualité de ce travail-là a été de ne pas se refermer sur un strict théorique, d’essayer de rayonner, à l’horizontale, de s’articuler dans le rayonnement, pas de se replier sur des savoirs, faire des allers-venues vers d’autres pratiques contemporaines. C’était pas mal.
VIDÉO et CINÉMA
Il y a eu pendant pas mal de temps quand même le cinéma, le cinématographique. La vidéo s’est annoncée immédiatement comme une autre paire de manches, l’écart était considérable, puis les différenciations se sont posées, au fur et à mesure, avec des douleurs, des tiraillements, des désaccords, mais ça se brassait en toute amitié et en toute engueulade. Est-ce que la différence entre le cinéma et la vidéo se joue sur de simples questions de support ou bien de langage ? Les deux mon capitaine ! Voilà. Il y avait ce désir-là de différenciation, et en même temps celui de ne pas – comment dire – de dire la vidéo c’est ça, le cinéma c’est ça, ça bougera jamais, façon secte. On interrogeait aussi où est-ce que ça se rencontre. On n’avait peut-être pas grande chose à voir avec l’art vidéo tel qu’il se pratique, je crois que maintenant non plus, mais il y a des gens qui bossaient en vidéo, et qui étaient en pleine cohérence avec certains travaux de la collection de Light Cone, et dont le travail s’articulait en partie avec certaines démarches historiques cinématographiques. Ça continue de brasser, c’est compliqué, et c’est bien que ça le reste.
Il y a deux jours j’ai vu un truc magnifique d’un mec, un jeune belge qui s’appelle Xavier Christiaens, qui est allé au bord de la mer d’Aral, qui a fait un film absolument magnifique, La chamelle blanche, très originel, qui a des filiations précises avec le cinématographique, on pense à Vertov. Il a tourné avec sa Mini-DV, monté avec son ordinateur, et ce n’est pas ailleurs. Tout ça reste relativement complexe. Ce n’est pas mal de rester dans quelque chose où il y a en même temps les points de rencontre et des points d’antinomie.
La vidéo s’est institutionnalisée rapidement. Elle est entrée dans les musées, dans le marché de l’art, c’était un nouveau truc, c’était – il y avait une fascination. Au point que tu ne vois plus que ça maintenant. Et le cinéma non. Ou relativement peu, avec beaucoup de réticences, mais parce qu’on était, qu’on venait d’une autre histoire. Les artistes de la vidéo ne venaient pas d’une culture cinématographique ou bien en divergeaient.
Maura McGuiness : En même temps il y avait eu des plasticiens dans les années 70 – Naumann, Acconci, qui travaillaient en pellicule ; la plupart ont adopté la vidéo après, mais déjà ils interrogeaient quelque part, quand même, de leur point de vue de plasticiens, l’image en mouvement, le cadre…
MR : Tout à fait, la matière et le temps, Mais les gens du cinéma dit expérimental, du moins par ici, venaient des cinématographies, du cinéma, c’est une histoire autre. Le projet qu’avait Jean-Michel Bouhours à Beaubourg à l’époque était une collection de cinéma, une collection cinématographique, qui tenait à garder des spécificités de support, de langage, de filiation par rapport à l’art cinématographique. Il y a des films dans les musées, mais il y en a très peu effectivement. Il y a du côté des musées un regard aux yeux remplis de l’art vidéo. Très vite, à part Jean-Michel à Beaubourg et 2-3 lieux comme ci comme ça, aux États-Unis ou en Allemagne, musées et galeries ont fixé l’art vidéo, à qui on donnait la part belle – il était du côté de la contemporaneité quoi : on assujettissait quelque peu des avancées artistiques à des dites avancées technologiques. Puis est arrivé le numérique, le multimédia, et le cinéma a continué à paraître archaïque. C’est peut-être un peu moins le cas aujourd’hui. Mais je ne suis pas très sûre que le cinématographique les intéresse et ils ne savent pas trop s’y diriger, l’arpenter – ce n’est pas leur culture. Les gens des musées sont rarement cinéphiles. Ils ont du mal avec ça, ça paraît un champ mystérieux, opaque, extérieur. Le champ des cinématographies est immense, ils ont une difficulté à le voir. Une petite anecdote : lors de l’expositionMouvement des images à Beaubourg [3], par exemple, pour certains, Bouquets de Rose Lowder, c’est pas mal mais Fischli et Weiss c’est mieux.
On peut comprendre, le cinéma et l’art vidéo ne sont pas du même champ. Puis, montrer Rose sur un écran LCD, je sais pas si c’est juste, s’il ne faudrait pas garder le support archaïque, parce que l’archaïsme y est, c’est archaïque comme la métaphysique est archaïque… ! On est dans des accumulations de strates et les archaïsmes c’est aussi avec ça qu’on fait la modernité. Et c’est vrai que les gens ont du mal à le voir. Bon… le paradoxe est toujours là, l’ambivalence.
Est-ce que ça ne serait pas véritablement aux lieux du cinéma à s’intéresser à cela ? Est-ce qu’on a quelque chose à foutre… Est-ce que le cinématographique peut avoir lieu justement chez les plasticiens, est-ce que c’est quelque chose qu’il faut vraiment désirer, sommes nous des artistes de musée ? Pour ma part, je ne refuserais pas, selon mon humeur, de passer un truc en DVD si on ne peut pas faire autrement, mais je souhaite vraiment que mes films soient vus au cinéma avec un projecteur 16mm, j’y tiens absolument. Comment expliquer ça, je voulais dire – est-ce qu’on n’est pas dans un champ assez spécifique qu’il faudrait garder, sans le fermer, sans vouloir être fétichiste du support, est-ce qu’il ne faudrait pas continuer une réflexion sur les spécificités de ce cinématographique-là ? Ce sont des films de projection pour la plupart, pas des films d’exposition. Je ne parle évidemment pas des installations qui trouveraient peut être mieux leur place dans les musées ou galeries, encore que les installations de cinéastes n’ont rien à voir avec celles des plasticiens. Pour ma part, je ne fais pas d’installations, ce n’est pas mon truc. Pour moi la salle noire, c’est la page blanche. Tout le monde n’est pas dans ce cas. Au-delà de ça, c’est important de réfléchir, de questionner, et c’est ce qu’on essaie de faire au labo entre nous, de brasser l’être et le faire de ces cinématographies-là.

L’EMPREINTE
Je veux dire, le cinéma, l’empreinte argentique, n’est pas du code. Il a trait au mémoriel : l’empreinte d’un pas sur le sable, c’est quoi ? Un type est passé par là qui n’est plus là. Que veut dire l’image-empreinte ? La trace, une image d’absence et de présence. C’est un outil et un art de la physique du temps, le cinéma, 24 images seconde. Regarde, c’est ça, je te le montre, je sors un petit bout de ma poche, c’est ça. Est-ce que ça, ce n’est pas intéressant d’y penser précisément ? Il ne faut pas essayer de raccrocher les wagons, tout ça n’est pas concentrique, comme disait l’autre.. bon ! Que dis je… oui, parmi les plasticiens qui travaillent sur le support cinéma, il y a des gens absolument magnifiques. J’aime beaucoup ce que fait Tacita Dean. Une plasticienne anglaise qui ne travaille qu’avec la pellicule en 16mm et avec des projections en boucleurs, en même temps elle n’est pas une cinéaste expérimentale, mais une plasticienne. Un sculpteur d’un genre particulier. Ce serait très intéressant de parler avec cette artiste, qui voit ce qu’est l’image empreinte du cinéma.
Petite anecdote : rencontrant Mario Merz il y a peu de temps, elle s’est dit « c’est mon père, je vais le filmer » : plans fixes, doc du pauvre où il se passe rien et Mario Merz qui ne dit rien, pas un mot, ça dure une demi heure. Le film est développé, elle dit « ben non, c’est pas mon père, en fait ». Elle travaille dans les musées, les galeries, elle n’a rien à montrer dans une salle de projection de cinéma, parce que ce sont des pièces courtes ancrées, abruptes.
Il ne faut pas refuser les rencontres, surtout ne pas fermer les champs, mais en même temps rester fort dans les spécificités de nos travaux. Je suis comme un poisson dans l’eau au labo avec Mahine, Fouchard, Nico, Stefano, Enrico, toute la bande : aucune question fétichiste jamais, ce qui est en en jeu ce sont simplement des expérimentations de langage et de matérialités. Un art des matérialités des temps. Avant de dire expérimental. La vidéo ce n’est pas ça.
Je crois aussi qu’il y a quelque chose de mystérieux et de bien important très spécifique à l’argentique : à relire Marie-José Mondzain, Image icône économie, le passage où elle parle du négatif, du passage par le négatif, passage par la mort, peut être, ou le monde des fantômes… tout ça nous regarde et a besoin d’exister, d’être considéré. Non pas sans relation, en se mettant dans une chambre noire et en disant les autres sont méchants et nous on a raison. C’est poser les questions sur la table, quitte à ce qu’elles le restent et même le redeviennent via le monde des labos.

LE LABO, LA DIFFUSION
Voilà. Maintenant, les machines arrivent facilement puisqu’elles sont sorties de l’industrie toutes, on est à un moment où les compteurs sont à zéro. On en fait ce qu’on veut des machines, du moment où il y a des gars et des filles qui savent les faire marcher, les réparer… Elles sont libres, envers et contre tout il n’y plus qu’à faire marcher tes petites mains pour ouvrir ta palette, c’est gigantesque ! C’était ce que voulaient faire les vieux, Kirchho, moi, les autres, c’était le projet de la Coopérative qui n’a pas eu le concours financier nécessaire. Tu allais donc au labo chez Neyrac, ou comme Kirchhofer tu moulinais tes trucs dans ta baignoire, mais ça restait très limité. Il faut revoir le travail de Kirchhofer de ces temps-là, s’il veut, parce que ce n’est pas quelqu’un qui aime montrer trop. L’outil est libre, les labos il y en a à Grenoble, à Paris, à Londres, Nantes, avec un grand engouement de jeunes cinéastes, d’artistes, qui ont vraiment envie que ça ait lieu. C’est assez magnifique. Cela durera ce que ça durera parce qu’il faut des sous quand même. Il faut faire tourner les structures. Manger, payer le loyer, faire tourner les machines, il faut beaucoup d’énergie.
Et c’est bien que Light Cone ait aussi des moyens de faire tourner une collection de 3000 films et de payer un petit salaire à des mecs super qui bossent comme des malades, c’est très dur à brasser. Et les labos commencent à avoir un petit peu de blé, c’est un moment très important.
La plupart de mes films sont distribués par Light Cone, j’ai des relations privilégiés avec Light Cone. Il existe aussi maintenant de nouveaux lieux où on peut passer des films. Mon souci n’est pas forcément la diffusion. Les gens se rencontrent – la rencontre du Nova, c’était très bien. Les gens ont plein de projets, se connaissent, montent de nouveaux lieux. Il y a un réseau des labos alternatifs, qui ne sont pas en rupture avec les diffuseurs qui existent. Light Cone est parfaitement ouvert à ce travail là, nombre de films ont été pris en distribution cette année. Le Collectif aussi. Le champ est donc un peu plus vaste. Il y les films qui vont dans des festivals, ou dans les musées puis d’autres pas, c’est pas mal.
MMcG : Et toi tu te débrouilles toi-même pour que tes films soient vus ?
MR : Non je n’ai jamais rien fait, ça m’emmerde. J’aime les montrer une fois deux fois trois fois, y être, sentir comment c’est accueilli, et quand tu rencontres ou la première fois ou la troisième fois la personne – tu rencontres toujours la personne ! – qui en général ne parle jamais dans la salle – c’est toujours sur un coin de trottoir – et qui a parfaitement entendu ce que tu as fait, et qui te le dit, c’est miraculeux et là le film est fini, et je passe au prochain travail.
J’ai laissé un peu faire Light Cone, les programmateurs. Je n’ai pas une volonté immense de montrer, ce n’est pas mon job. Ça doit se bouger tout seul. Je n’ai pas le temps, il y a toujours un chantier devant moi. Il y a des gens qui adorent ça, c’est très bien, qui se battent pour que leur films passent partout. Je ne pense pas faire un cinéma de festival, mes films sont trop longs ou trop abstraits. J’aime les faire, les finir, puis passer à un autre en chantier.
La bouteille à la mer ?
J’aime beaucoup cette image. J’ai quand même connu des festivals ou on s’amusait bien, maintenant ça m’ennuie. Je n’ai pas le temps. Je bosse. C’est le travail à côté qui m’a donné ma liberté, je n’ai jamais demandé de l’argent ou quasiment. J’ai fait deux ou trois demandes, il y a eu quelques ronds, c’est très bien, mais forcé ! J’aime le côté clando, ma génération peut-être.
Que les lieux de diffusion aient besoin d’argent pour tourner c’est une chose. Pour le cinéaste c’est comme il veut. Plein de gens ont besoin d’être entièrement libre, en dehors de toute élaboration de dossier. Tout le monde ne s’est pas précipité à la commission CNC par exemple.
Le laboratoire ouvre un possible de langage et d’économie pauvre : si tu n’as pas envie de t’inclure dans ce que l’institution a créé, avec tes 3 francs 6 sous tu vas au labo. où il n’y a pas besoin de se ruiner. Les labos professionnels sont déments financièrement. Une chose magnifique, que Light Cone a pris tout de suite en distribution, est un film qui a coûté 1000 balles. Le labo permet ça, c’est énorme cette liberté.
Il y a aussi très peu d’accès au matériel de cinéma dans les universités et les écoles d’art.
Les ateliers universitaires étaient mieux aux États-Unis je crois, du moins ce que j’en ai vu. Pendant les années 90, Sandra Davis en Floride avait une tireuse optique etc. En France on ne pratique pas, les professeurs forment les élèves à devenir professeur.
Ce que je vois maintenant c’est la totale institutionnalisation de tout ce qu’il y avait dans les années 70, parce que c’est moins cher la technique, (les gens pas forcément !). Tout le monde a une caméra, un ordinateur. Il y a aussi ce rêve récurrent à chaque fois qu’il y a un « allègement » technique, avec des machines plus petites, ces espèces d’utopie, d’atteindre le moment où ‘chacun peut le faire’. Mais chacun n’a pas forcément ni l’envie ni le goût, et on est toujours rattrapé par la technique.
C’est un piège d’assujettir sa pensée aux évolutions technologiques et de croire que. Quelque part big brother bricole tout ça, et big brother a son langage à nous vendre. Il faut choisir ses outils en fonction de ce que l’on fait et trouver les sentiers sauvages et pauvres, tels pinceaux pour telle toile et on les trouve toujours dans l’élémentaire. Si l’on veut faire une œuvre riche, il faut alors se compromettre jusqu’à l’os et pas venir pleurer.
Faire de la vidéo, ça fait vendre des machines…
Oui ! Et surtout du langage, car c’est une énorme industrie, On peut arriver à des situations très stéréotypées où l’œuvre est le vidéoprojecteur avec sa projection de 8m de base, sa marque renommée, son esthétique publicitaire, où on expose la technologie, un peu chiant.
Pour revenir à Light Cone, qu’ils aillent vers un lien analytique avec les arts était très fructueux, il y a eu un vivier de nouveaux cinéastes. Parce que les films étaient montés et montrés, pas forcément dans des lieux luxueux mais où les cinéastes étaient soutenus. La distribution est importante. Il y a eu des discussions, des confrontations. À la Zonmée [4] il se passait vraiment des trucs. Les films étaient confrontés. Le regard porté sur la cinématographie était vigilant, attentif, argumenté. Ça soutient.
S’il n’y avait pas eu Light Cone il n’y aurait pas eu l’histoire actuelle, il n’y aurait pas eu le labo quelque part. Il ne s’agit bien évidemment pas d’octroyer des paternités délirantes, mais le lien est bien là. J’ai toujours soutenu ce travail-là.
Le cercle de la création, de la distribution, de la diffusion a tenu contre vents et marées plus de 10 ans sans un sou dans une époque pas favorable. C’est un boulot énorme, il faudrait 2-3 salariés de plus pour vraiment protéger la collection, restaurer les films. C’est une des plus belles collections d’Europe, des plus pertinentes. Mais la question du financement reste.

THUNES
Et c’est impossible à tourner avec les locations seules.
Que oui ? Et les subventions sont insuffisantes. On n’est pas sorti de notre pauvreté, mais que peut-on ? On ne peut pas augmenter les coûts de location. J’étais assez pour la double tarification pour les institutions et les petites associations, mais vas trouver la frontière ! En plus les pouvoirs publics vont aider de moins en moins, en adoration devant les événementiels de service, genre Nuit blanche qui coûte des fortunes. La mondialisation capitaliste est là. Je ne sais pas ce qu’on peut faire. Est-ce qu’il n’y aurait pas, en se compromettant un petit peu, les achats d’œuvres par des lieux de l’institution, Beaubourg, et les autres ? Il y a un certain nombre d’œuvres qui pourraient être proposées dans les commissions d’achat à des prix modestes par rapport à des acquisitions à 100 000 euros, où les coopératives pourraient avoir un pourcentage.
Ce ne serait pas une position de galeriste, mais avec quatre ou cinq films par an, ce serait déjà pas mal. Est-ce que ce serait envisageable pour injecter de l’argent en dehors de l’argent public et des locations qui ne font pas vraiment tourner ? Je pose un point d’interrogation.
Cela changerait la relation avec les cinéastes, dont on privilégierait certains ?
Inévitablement. Il y a déjà des droits je crois, qui ont été vendus à Arte. Ou alors il faut essayer de faire tourner les films en salles de ciné. Du pareil au même !
Ce n’est pas tout à fait la même économie. À la télévision on peut avoir 20 000 euros, pas au cinéma. Mais on est en face de la même problématique, qu’est-ce que je mets sur ma bobine ? Il faut que je tire une copie 35mm, ce sera untel puis untel. Je crois que ce cinéma intéresse plus de cinémas qu’on ne pense, mais il n’y a pas forcément les moyens non plus de les démarcher.
Il y a une grande méfiance.
Je pense qu’il y a des cinémas, des centres culturels, des théâtres qui seraient super contents de montrer des choses. Je ne parle pas de marketing, enquête de satisfaction, devancer les goûts des gens. Les Preview de Light Cone pourraient être ouverts au-delà des adhérents. Il y a bien sûr tous les ans des nouveaux, des gens qui arrivent – c’est impressionnant. Mais en même temps il pourrait y avoir d’autres. Dans l’idée d’aller vers le public, est-ce qu’il faut à des moments défendre certains cinéastes plus que d’autres ?
Forcément, ça créerait quelques accidents diplomatiques, je pense. Je ne sais pas s’il le faut – ce pourrait amener des apports financiers, mais en même temps…, je n’ai pas la réponse. Continuons bon an mal an avec ce qu’on a. On verra bien quand on sera pris à la gorge.
Ou avoir plus de spectateurs ?
Mais le public est tellement sollicité, il y a une masse de propositions.
Il faut peut-être revenir à la base du pourquoi c’est important que les gens voient ces films. Les cassettes, ça peut servir, mais…
Ce désir premier ne s’est jamais démenti. Nous sommes pris dans un piège dont il n’est pas facile de se dégager. Pour les 10 ans du labo, il y a une partie installation qui peut être tout à fait conséquente, on essaiera d’avoir 3 francs 6 sous de la DRAC, du CNC, pourquoi pas Agnès B. ? Je ne sais pas.
Le ciné expérimental américain n’aurait pas pu s’établir sans certaines fondations privées. Man Ray n’aurait pas pu travailler sans… Mais il y a le grand écart entre l’alternatif, l’anarcho-libertaire et puis l’institution, c’était comme ça dès le départ.
Et ça continue à l’être, avec de très grandes difficultés à vivre avec simplement…
À moins que tout le monde soit bénévole et ait un boulot ailleurs.
Pour l’instant ça fonctionne jusqu’à la lassitude et l’épuisement et c’est très fragile. Je souhaiterais que le bénévolat puisse vraiment fonctionner. De grands champs s’ouvrent avec vivacité et créativité, et en même temps les possibilités de fonctionner s’amenuisent. Il faut faire comprendre au CNC ce qui se passe, argumenter sur la vivacité de la chose, même si nous ne sommes plus dans l’époque d’un soutien à l’expérimentation. S’il n’y a plus d’oxygène pour la recherche, big brother nous croquera. Mais ce n’est pas désespéré. L’essentiel est que les films se fassent, se font par le biais des labos. Arpenter le cinéma, ça se fait. Il en sort des choses vraiment intéressantes et les films se font en dépit de tout. On est dans la situation de tout le monde, comment faire pour survivre ?
EPILOGUE, 2016
MMcG : Que penses-tu du terme « cinéma expérimental » ?
MR : Le terme « cinéma expérimental » ne convient pas et n’a jamais convenu. Il n’a aucun sens : tout art expérimente, sinon il n’est pas un art. Ce qui se rapprocherait serait quelque chose comme un arte povera du cinéma. C’est une notion qui pose et qui ouvre plus clairement.
On a pu aussi utiliser le mot underground, désignant ce qui peut se faire en dehors des circuits « officiels », « traditionnels », « commerciaux » du cinéma. Est-ce que ce côté clandestin est une partie intégrante de la condition du cinéma dit ’expérimental’ ?
Ça l’a été sans aucun doute dans les années 70 et 80 pour des questions éminemment politiques, et ça le reste actuellement pour certains artistes qui ont besoin d’ombre comme d’autres ont besoin de lumière, ce qui en soi est aussi politique mais en une strate plus profonde. Cela regarde le fait que l’on n’est pas dans quelque chose, que l’on peut être aux aguets, à l’écoute de l’invisible, et que pour ça il y faut de la solitude et de l’écart. Voilà pour la partie artistes au travail, dirais-je. Pour ce qui est de leur présence dans les réseaux officiels, idem : ceux de l’ombre ne s’y sentent pas trop bien, ça crame…
Tu parles quelques fois de l’importance des collectifs et de Light Cone pour que des femmes fassent du cinéma. Pourquoi aurai-ce été plus facile par ce biais ?
Parce que ces cinéastes venaient des mouvements féministes à l’époque de la coopérative. Je pense à Musidora, à psych et po, au MLF et certaines aimaient cette vie là, de partage, et puis le langage libre qui circulaient en ces travaux leur ouvraient immédiatement des champs déréglés et anarchiques où elles trouvaient leurs places. On était déjà dans un do it yourself qui convenait très bien aux filles… Cela a continué plus tard à Light Cone, avec un regard très attentif de Yann et Miles sur le travail des femmes en ces cinématographies.
Qu’entends-tu dire par « la salle noire, c’est la page blanche » ?
Pour moi, la nature d’empreinte de l’image argentique en fait une image inscriptive (qui est un mot qui n’existe pas mais je m’en fous), scripturale. Un film c’est un écrit, en 16mm tout particulièrement, qui a la stabilité de la page. Je ne dis pas un texte n’est-ce pas, mais un écrit. Quelque chose qui est à lire dans un autre langage – comment l’entendre ? Je me souviens d’un livre d’un écrivain discret, Gérard Macé, qui s’appelle Le dernier des Egyptiens, qui raconte que Champollion déchiffra la Pierre de Rosette parce qu’enfant il avait appris à lire tout seul.
Pour toi, le cinéma est archaïque, comme la métaphysique ?
Oui, il l’est, en ses racines profondes. L’image de cinéma est une empreinte avant toute autre considération, une image mémorielle qui parle d’absence et de présence. Elle est liée indéfectiblement à ces mains positives et négatives premières. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas aussi quelque chose de moderne. La modernité ça advient avec des racines et des filiations : s’il n’y en a pas, ça s’appelle de la publicité.
Tu disais lors de ton passage à Lyon que tu commençais à avoir assez de familiarité avec les outils numériques pour pouvoir les forcer à faire autre chose. Ça passe par où ? Par la physique ou par l’informatique ?
Non, pas forcer. On ne force pas un outil on l’écoute. Je parlerais d’une physique de la prise de vue numérique via des petites caméras lambdas, Avec un matériel tout ce qu’il y a d’élémentaire. Les découvertes que je fais ne sont pas généralisables, c’est sûr. L’outil peut toujours plus et autrement que ce à quoi l’assigne son fabricant industriel, il peut se libérer et se faire aveugle à sa feuille de route, allant par-delà les codes, en deçà et au-delà des champs autorisés de l’exposition, des réglages convenus, du mode d’emploi. Par les simples lumières imprévues du réel, la statuaire sans langage de l’image numérique se brouille, se fait rumeur des temps ; les codes déraillent, continuant à compter l’incomptable, déréglés, brisés, et là où le compte n’y est plus, la lumière prend corps, affleure. Advient alors une image-écho, une image-rumeur, une image d’outre-temps semblant revenir à sa provenance : tourbillonnent les atomes de ce qui fut ou qui sera… Ainsi mené dans ses possibles, cet outil peut être juste pour un travail de film comme l’est tel pinceau pour telle toile. Il ne s’agit pas de le déjouer – ce serait bavardage – mais de le poser vers ce qu’il sait de la lumière, de lui faire confiance comme à un comparse au delà de son assujettissement, au-delà de l’ingénierie qui petitement le conçoit, en ignorant en toute étape de ce qui relève de l’effet. Je dis bien en ignorant… alors lorsque la lumière gagne sur le code, il va seul où l’image argentique est aveugle, par-delà la mémoire en un mouvement contraire. Lui seul peut donner image d’absence et d’exil.
Le cinéma différent peut le rester

Article paru dans Libération, le 8 Mars 1977
Notes
[1] Hyères : Festival de cinéma qui de 1971 à 1983 a programmé des films ’différents’ en lien avec le CJC.
[2] Colloque organisé sous l’égide du CNC les 9 et 10 septembre 1978 à Lyon, avec les différents collectifs en activité à l’époque, pour tenter de mettre en place un système de soutien pour le cinéma hors industrie. Voir : http://www.derives.tv/Les-rapports-…
[3] Exposition Mouvement des images : accrochage de la collection permanente à Beabourg en 2006 autour des influences du cinéma sur les arts plastiques.
[4] Zonmée était un lieu de diffusion culturel qui se trouvait à Montreuil.