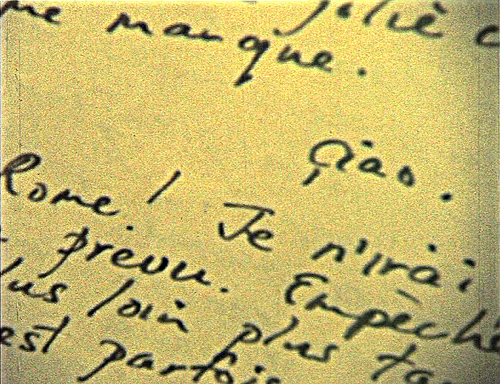
Jean-Claude Rousseau à Paris. Le premier entretien date du 9
novembre 2003. L’assemblage de ces entretiens est organisé
sous la forme d’un cheminement qui comporte 3 moments
distincts : l’image, la réalisation, le film.
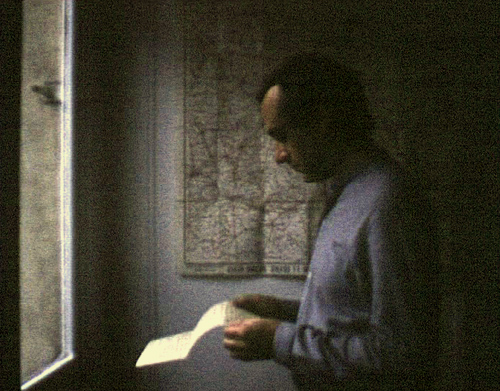
L’IMAGE
Vous savez, ça tient à rien un cadre.
C’est le problème avec ce matériel vidéo car on ne peut pas se fier aux
limites de l’image comme on la voit sur le petit écran de la caméra.
Vous voyez comme elle existe cette ceinture pendue à la poignée du
placard.
Donc il y a des choses possibles. Il y a aussi la ligne claire verticale du
bord du placard et la ligne sombre horizontale où borde la couverture
du lit. Ces deux lignes font un carré…
Être saisi par les lignes. Être dans certaines dispositions, et d’abord
une sorte d’abandon, qui font que l’on voit ce qu’on ne verrait pas
autrement, qui font que la vision est possible.
J’aime le mot vision car il a cette ambiguïté : vision dans le sens de
perception visuelle et vision dans le sens où on est saisi par ce qu’on
voit, « avoir des visions ».
Devant une oeuvre d’art, si on la voit vraiment, c’est toujours une
« vision ».
Il y a saisissement et l’oeuvre d’art se contemple.
La beauté ne se voit que dans la contemplation, jamais dans
l’observation. Elle ne s’observe pas. Elle ne se détaille pas. Elle
disparaît aux yeux de qui croit la saisir par le détail.
Ça veut peut-être aussi dire que l’oeuvre d’art est partout, car elle
ne dépend que de la forme du regard.
Devant la beauté, si une volonté s’exprime, si le regard est volontaire,
ce n’est qu’une fuite pour échapper au saisissement.
On peut donc dire qu’elle apparaît malgré soi.
Être dans des dispositions où la beauté se révèle, où l’art se fait,
ce n’est pas du tout confortable et donc ce n’est évidemment pas
un choix, c’est plutôt quelque chose qui se subit. On y est plus ou
moins disposé, peut-être selon sa nature.
On est plus ou moins disposé à s’ouvrir à cela, à souffrir cela, en
tout cas à courir le risque d’une disparition. Parce que ce saisissement
c’est cela : le risque d’une sorte de disparition, d’un évanouissement.
C’est l’idée, trop imagée, de celui qui se tient devant un tableau et
le saisissement est si fort qu’il s’effondre, devant.
On ne peut pas choisir cela ou alors c’est tricher ou c’est pervers.
De toute façon faire ce choix, en avoir la volonté, n’aboutirait à
rien. Mais on peut être dans un état, dans des dispositions, un état
de sensibilité ou même de nature, qui fait qu’on a cette vulnérabilité
en quelque sorte.
Il y aura une trace de ce saisissement si on a avec soi la caméra.
La question peut être de savoir quand le saisissement s’opère et
quand se produit cette vision.
Si c’est seulement en regardant dans l’oeilleton ou si c’est avant
même de mettre la caméra sur son pied et donc avant de regarder
dans l’oeilleton, la caméra ne servant plus qu’à vérifier la vision.
Il y a cette question et je n’ai pas vraiment de réponse. Ce que
je peux dire, en rapport à cela, c’est que chercher ne sert pas à
grand-chose. C’est plutôt trouver et être, d’une manière inattendue,
saisi par ce qui se trouve, ce qui se présente, au sens où surgit une
présence d’une force que le reste n’a pas.
Ça ne me semble pas vraiment compatible avec un calendrier serré
de tournage.
Il n’y a pas, comme le mot le signifie bien, de cadre sans limites,
sans bords. Il n’y a pas de relation entre les lignes et donc de justesse
du cadre, s’il n’y a pas les limites.
Peu importe la dimension, ce qui compte, ce sont les rapports, les
relations, les correspondances qui s’établissent dans les limites du
cadre.
Rien ne tiendrait s’il n’y avait pas le cadre.
Le cadre est juste quand il fait passage, quand il y a ouverture,
c’est-à-dire quand le regard ne s’arrête plus sur ce qui est montré
mais qu’il traverse. Le passage, c’est voir au-delà de la représentation, en
profondeur, au-delà de ce qui est montré. Cette profondeur est réelle.
La perspective dans un tableau ou sur l’écran est bien évidemment
illusoire, mais la profondeur ne peut-être que réelle et elle ne
peut venir que de la réalité de ce qui est vu, c’est-à-dire une relation
entre des lignes.
Là encore on repense aux notes de Robert Bresson : « Penser à la
fin, penser avant tout à la fin. La fin c’est l’écran qui n’est qu’une
surface. »
La réalité, c’est bien la relation qui existe entre les lignes sur cette
surface plane. Ça c’est la réalité. Et s’il y a des relations justes,
on peut dire alors qu’il y a image. Elle ne tient pas par ce qu’elle
montre, qui n’est jamais qu’une re-présentation, mais par le rapport
juste des lignes. La présence est alors véritable et la profondeur est
réelle.
Il me semble que parmi les obstacles à la profondeur, ce qui
l’empêche peut-être le plus, c’est la perspective. Parce qu’elle est
l’illusion de la profondeur.
Si on regarde un tableau de Vermeer, il y a en rapport à cela, quelque
chose d’extraordinaire et de tout à fait saisissant. Il y a bien le respect
des lois de la perspective, et pourtant un tableau de Vermeer n’a
rien à voir avec un tableau de Pieter de Hooch qui, tout autant,
respecte la perspective et qui a peint à peu près les mêmes choses,
c’est-à-dire principalement des intérieurs.
Alors qu’est-ce qui fait la différence entre un tableau de Pieter de
Hooch et un tableau de Vermeer ? C’est justement la profondeur.
La chose extraordinaire, chez Vermeer, c’est que les lignes qui font
la profondeur se confondent avec les lignes qui font la perspective.
Donc il y a bien le motif, mais il devient transparent et le regard ne
s’y arrête pas, va bien au-delà.

Tandis que dans un tableau de Pieter de Hooch, qui n’est cependant
pas un peintre négligeable, c’est tout autre chose. On bute sur la
représentation quand dans Vermeer c’est la présence.
Dans un tableau de Vermeer, il y a bien les lignes qui font la
représentation et l’illusion de la perspective, mais ces lignes sont
justes indépendamment du motif.
Dire qu’elles sont justes, ce n’est pas dire qu’elles sont justement
placées pour faire illusion et pour donner à voir telle ou telle chose
dans tel ou tel lieu. Elles existent par elles-mêmes dans cette mise à
plat, dans une relation tout à fait indépendante de la représentation.
On pense au nombre d’or et les Anciens (les Grecs pas les Romains)
ont eu cette révélation. C’était leur géométrie.
En tout cas, ce qui m’avait bien plu, découvrant l’oeuvre de Vermeer,
c’est de voir que deux tableaux, de dimensions différentes et ne
représentant pas du tout la même chose, avaient le même rapport
de lignes, les mêmes relations entre les lignes. À ce niveau-là, je
ne crois pas à autre chose qu’à l’intuition. Il n’y a pas de savoir, ou
si c’est l’application d’un savoir, c’est laborieux et c’est peut-être
ainsi que certaines oeuvres se sont faites au moment du passage à la
perspective sous la Renaissance, l’application de règles.
Mais chez Vermeer, ce n’est pas l’application de règles qui assure
l’oeuvre. Sans qu’il y ait de règles applicables, le tableau ou le film
se résout de la même manière en retrouvant, par sa propre exigence
et dans son mystère, les mêmes rapports.
Le désir de l’image…
Il existait depuis longtemps, bien avant que je fasse des films.
Ça a commencé par un scénario racontant son histoire et
l’empêchement de sa réalisation. Au bout de cet empêchement, il y
a eu finalement des images.
Quand est-ce que ça m’a pris ? J’avais 19, 20 ans ou un peu avant.
C’était, dans l’écriture du scénario, le désir de l’image. Et je
pourrais peut-être maintenant le dire autrement, ce qui pour moi
signifie la même chose : c’était le désir de l’icône. Et donc cette
succession de plans, ou de moments du scénario, c’était des images,
mais ce n’était que des images mentales évidemment, et il n’y a pas
d’images qui puissent se faire dans la reproduction d’images mentales.
L’image n’est pas prévisible. On ne peut pas prévoir l’image.
Le mot veut bien dire ce qu’il dit : pré-voir c’est-à-dire voir avant,
or on ne peut pas voir l’image avant qu’elle se présente.
Donc tout ce qui est de l’ordre de l’imagination ou de l’image mentale,
ça n’approche aucunement de l’image.
C’est ce que certains semblent croire pourtant avec cette manière
de faire des films, qui est toujours celle d’aujourd’hui, à partir d’un
scénario.
Ensuite, ayant pré-vu l’image, ayant cette image mentale, on la
cherche et on cherche l’adéquation la plus parfaite entre ce qu’on a
eu à l’esprit pendant quelque temps et qu’on a peut-être décrit sur
le papier et puis ce qui va être enregistré par la caméra.
Ça ne tient pas.
Ça ne sera jamais dans ce cas, au mieux, si on y arrive par cette
recherche, que la représentation de cette image mentale. C’est-à-dire
rien de plus que ce qu’on a pu imaginer.
Et donc ça, c’est limité à la représentation, ce n’est pas la présence.
L’image, elle nous dépasse, elle est au-dessus de nous et au-delà de
tout ce qu’on peut imaginer. C’est pour ça qu’on peut seulement la
trouver. On ne peut pas aller à la recherche d’une image, on ne peut
pas la prévoir. Je ne sais pas ce qu’il faut dire… Disons qu’elle est
plus forte, plus haute que tout ce qui peut nous venir à l’esprit.
On peut l’attendre par contre. Donc on est saisi par l’image. C’est
ça l’idée d’un saisissement : on ne saisit pas l’image, c’est l’image
qui nous saisit. On ne peut pas saisir les images et c’est pourtant
ce qu’on croit faire couramment. On les saisit en général, presque
toujours, pour dire, pour leur faire dire quelque chose. Mais il est
bien clair que l’image n’a rien à dire.
On devrait comprendre cela très vite, en étant étudiant de cinéma,
quand on apprend les effets sur une image de ce qui la précède, de
ce qui la suit, et comment elle s’en trouve constamment modifiée.
Donc, en elle-même, elle n’a effectivement rien à dire.
Et on lui fait dire quelque chose, ou on croit pouvoir lui faire dire
quelque chose, par un effet de montage, par ce qui précède, par ce
qui suit. Elle est saisie comme ça, elle est liée, elle est reliée, on la
raccorde. Mais justement l’image ne peut pas être liée. Elle ne supporte
pas d’être réduite à un signe d’écriture.
C’est l’idée que l’image se retire quand on croit la saisir. Dans ce
cas, ce qu’on voit n’est plus une image.


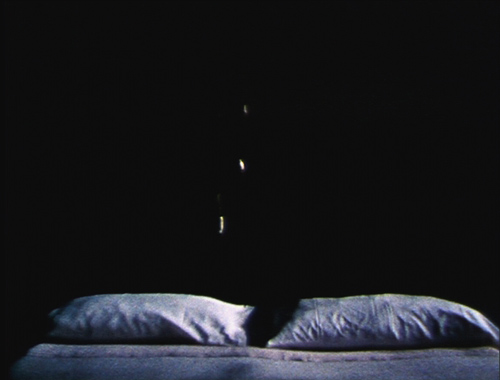



La vision…
C’est peut-être l’oubli de soi, c’est se retirer jusqu’à ce qu’on puisse
voir de cette manière-là. Parce que ce qui peut empêcher la vision,
c’est soi-même.
On ne voit pas l’image sans se perdre. En cela, l’image est toujours
une figure de la passion. On s’y abandonne, et si ce risque est couru
c’est qu’on ne peut l’empêcher. On est dans les conditions où le
risque existe, par nature, sans l’avoir choisi.
Ce n’est pas pour autant intéressant de connaître la vie de celui qui
est traversé par ces choses. Je ne dis pas celui qui fait ces choses,
mais celui par qui elles passent. C’est-à-dire qui a malgré lui cette
transparence.
Simone Weil dit des choses très fortes en rapport à cela. Il faut oser
son vocabulaire et parler de grâce.
Et justement, la grâce, il n’y a pas de règle pour son surgissement.
Donc il y a là un mystère, un mystère qui ne se manifeste pas forcément
dans les premiers temps de la création. Les premiers tableaux de
Vermeer sont plutôt du côté du Caravage. Ce ne sont pas plus des
Vermeer dans ce que Vermeer donne ensuite à voir que le sont les
deux premiers films de Bresson par rapport à son oeuvre et dont lui-même
ne voulait plus entendre parler.
Ça ne veut pas dire que ce soit des mauvais films. Les Dames du
bois de Boulogne, est un film remarquable, mais il y a une rupture
qui s’opère après.
Il y a rupture et il y a un risque qui jusque-là n’était pas couru. Pas
seulement le risque de tomber mais le risque du vide.
Cette rupture, c’est être transporté dans le vide.
La vision est toujours imméritée, il n’y a pas d’entraînement et de
discipline qui l’assurent.
C’est bien dans le désordre apparent que tout d’un coup se voit,
dans un saisissement, l’ordre réel des choses.
On peut tendre le regard, on peut tenir le regard mais il n’y a pas de
méthode, il n’y a pas de règle. Ce qui fait qu’il n’y a pas de mérite
et que ces choses-là échappent au jugement, en tout cas au jugement
moral.
Lorsque ça ce voit, lorsqu’on voit, lorsqu’on a cette vision, on n’est
plus dans un état de raison et c’est un peu l’idée que pour voir, il
faut être aveugle. Il faut que s’éteigne dans notre esprit tout ce qui
permet une perception raisonnée.
Les évidences de nos schémas mentaux et l’interprétation nous
empêchent de voir. Nous gardons pourtant le manque de ce qui
reste ainsi caché.
Lorsque l’art se produit, c’est toujours une ouverture à ce qui est
derrière, à ce qui sans l’art ne se verrait pas.
Et c’est en cela que le tableau ou le film est une fenêtre.
Un cadre temporel.
Il y a le cadre pictural et le cadre dans la durée.
La justesse se vérifie aussi au niveau du cadre temporel.
Le noir, dans le film La Vallée close, ça veut dire avoir interrompu
la prise, comme si, à un moment, il n’était plus possible de garder
les yeux ouverts.
Je ne peux pas dire que cela réponde à quelque chose de raisonné
ou de réfléchi, c’est l’impression qu’il fallait alors interrompre la
prise.
La durée de mon regard a une limite. Cette limite fait la durée de la
prise. Je ne vois plus… J’éteins la caméra.
Après avoir déclenché la caméra, je reste à coté, je reviens vérifier
le cadre et me satisfaire de ce que je vois à nouveau dans l’oeilleton
et voir aussi comment la lumière a changé et modifié les lignes.
Un cadre juste peut l’être en effet d’une manière très brève. Si c’est
à l’extérieur que se fait la prise, la lumière change vite et parfois si
vite que le temps de mettre la caméra sur son pied, elle a pu changer
les lignes qui ne présenteront plus l’intérêt que j’y voyais.
Comment est-on saisi par les oeuvres qu’on voit ?
Le premier à connaître ce saisissement est celui par qui ça passe, le
cinéaste, le peintre.
C’est ce saisissement même qui se fixe sur la toile. Et une fois
fixé, le même saisissement peut se produire pour ceux qui passent
devant, si peu qu’ils s’arrêtent et qu’ils soient dans des dispositions
qui leur permettent de voir, ce qui n’est pas toujours le cas.
Je ne crois pas à l’écriture cinématographique et je pense que le
cinéma, puisqu’il s’agit d’images est un art.
L’écriture, c’est saisir, c’est opérer des liaisons qui traduisent une
affirmation, et le plus souvent, sinon toujours, une affirmation de
soi. Alors que l’art c’est l’opposé de cela, c’est l’abandon devant
l’insaisissable et c’est, plutôt que l’affirmation de soi, le risque de
disparaître. « À chaque coup de pinceau, je risque ma vie » dira
Cézanne. Le coup de pinceau, ce n’est pas l’usage d’un stylo pour
dire. Et c’est justement être saisi et non pas saisir.
Or ce qui est tellement contradictoire dans ce qui s’écrit sur
le cinéma, c’est que même ceux qui par ailleurs parleraient
d’art cinématographique n’ont pas une appréciation critique qui
s’accorde à cela et ils parlent d’autres choses que d’un art quand ils
commentent et jugent les films.
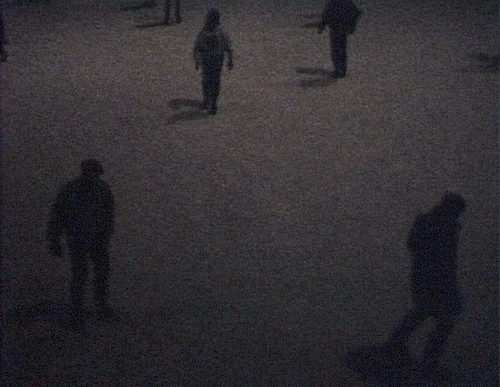



La RÉALISATION
L’idée ne fait pas matière…
Le son dans les films que j’ai réalisé en super 8 n’a jamais été
enregistré au moment de la prise de vue. Il a rencontré l’image
après, par hasard, accidentellement ou par l’effet d’une d’intuition.
Parfois, longtemps après, il a révélé l’image dans telle prise qui me
paraissait jusque-là ratée et que j’aurais pu jeter.
Là c’est l’idée qu’il n’y a pas en soi de bonne ou de mauvaise
prise. Une image réussie et une image ratée, ça n’existe pas en soi
et ça ne peut être que par rapport à une idée qu’on a et qu’on veut
réaliser. Donc ce n’est que parce que ça ne s’accorde pas à ce
qu’on a imaginé que c’est jugé mauvais. Comme je suis convaincu
que ce n’est pas de ce qu’on imagine avant que peut venir le film,
en soi il n’y a pas d’image mauvaise ou bonne. C’est le film qui le
dira. L’image sera justifiée selon la loi propre du film ou elle sera
rejetée.
Il y a bien des prises de vue que je pouvais considérer comme ratées
(par exemple sous-exposées ou bougées) qui ont fait ce qu’il y a de
mieux dans le film, révélées souvent par la rencontre d’un son qui
s’y est accordé.
Comme il n’y a pas l’intention de dire quoi que ce soit, ce n’est
pas sur le dire que le son va rencontrer l’image. Donc il rencontre
d’abord l’image comme un matériau, en dehors du sens et en fonction
de ce qui se passe de plus concret dans la prise.
Il peut y avoir comme ça des rencontres parfaitement justes, d’un
synchronisme parfait.
Ce rapprochement, il se crée d’abord en ayant un son dans les
oreilles, passant par les écouteurs, et en voyant à la visionneuse
défiler telle bobine. Et donc je m’aperçois qu’il y a un ajustement
qui se fait, mais ce n’est pas en rapport au sens, ce n’est pas en
rapport à ce que ça peut signifier et vouloir dire. Ce n’est pas cela
qui d’abord m’intéresse. Quand je dis que ça n’a pas d’intérêt pour
moi, ce n’est pas exactement ça. C’est formidable si en plus il y a
le sens, mais en plus seulement, comme quelque chose d’offert audelà
même de cette simple rencontre du son et de l’image.
D’abord mon attention se fixe sur une plage sonore qui rencontre
de façon assez juste la prise de vue. Je dis assez juste et donc ce
n’est pas satisfaisant. Mais à partir de là, je décale un peu d’un côté
ou de l’autre et je me rends compte de ce que ça modifie à tel moment.
Je cherche à ce qu’il y ait suffisamment de points de contacts
parfaitement synchrones du son et de l’image. Synchrones, par la
façon dont l’élément sonore touche à certains endroits, à certains
moments, l’image. Quand ça se produit, ça peut se caler d’une
manière si précise que l’on ne peut plus y toucher.
Donc ça fait un bloc et il est possible que ce bloc trouve sa place
sur l’orbite du film, c’est à dire qu’il s’y tienne, qu’il consente à
rester là sans être lié, sans qu’il y ait raccord.
S’il s’accorde sans qu’il y ait raccord, s’il s’accorde à l’ensemble,
s’il peut établir des relations sur l’ensemble, là il tient en place tout
seul et il fait partie du film.
Pour ce qui est de la parole au téléphone dans La Vallée close, elle
a rencontré l’image, finalement retenue, selon un critère principalement
sonore.
C’est-à-dire comme un matériau sonore : la tonalité, le rythme, le
souffle ; et puis il y a aussi le sens, mais ça c’est pas la première
chose qui fait que le son et l’image vont se plaire. S’il y a une rencontre
qui est vraiment inséparable, et si on ne peut plus dissocier
l’élément sonore de l’élément pictural, ce n’est pas au niveau du
sens évidemment, c’est au niveau matériel. Et c’est ce qui fait ces
étincelles justement ou ces fulgurances comme certains disent.
Quand le son touche l’image ça fait une étincelle et ce qui se passe
est indépendant de l’idée qu’on pouvait avoir et des intentions qu’on
garde à l’esprit. Tout ça ne peut être qu’accidentel, le résultat d’une
rencontre heureuse mais imprévue, répondant à un désir et non à une
volonté.
Mais quand cela se produit, de manière tout à fait inattendue,
évidemment on ne peut plus y toucher et c’est sûr que c’est bien le
son précis qu’il fallait pour cette prise-là. Donc ça, ça reste.
C’est un élément de plus qui va trouver sa place dans ce que je devine du
film, sur l’orbite du film qui commence à se voir.
Ce qui m’intéresse dans la parole, c’est le souffle, la respiration,
l’intonation. La matière sonore est plus importante dans le
rapprochement des éléments que ce qui est dit, qui n’est jamais
qu’une idée. Il n’y a pas d’art sans matière et l’idée ne fait pas
matière. On ne peut pas faire reposer un film sur des idées. Les
idées viendront du film mais il ne peut pas s’appuyer dessus. C’est
encore la différence entre art et écriture.
Dans la plupart des films, les éléments sont outrageusement saisis
pour faire sens. Mais si on les laisse libres, si on n’a pas cette
brutalité qui consiste à les lier et à les mettre dans des positions,
dans des relations pour dire quelque chose, pour exprimer l’idée,
ils vont librement à leur place. Ils établissent des relations
naturelles et ont un positionnement juste. On peut alors parler de
beauté parce que les éléments se plaisent là où ils sont.
Il y a quelque chose qui préserve du raccord, qui donne une certaine
garantie que le plan garde son caractère élémentaire, ce sont les prises
dans l’axe.
Dans l’axe ça veut dire que la caméra regarde droit devant, de
manière frontale, et elle ne va pas chercher à voir au-delà. Cela
présente aussi l’avantage d’imposer l’ellipse, de la produire sans la
chercher car il y a des choses qu’on ne peut pas montrer.
Cela veut dire que s’il y a des oiseaux dans un arbre, le plan qui
consisterait à diriger la caméra vers les branches où sont les oiseaux
à 5 mètres du sol est impossible. Par contre on peut les entendre.
L’ellipse se fait alors d’elle-même.
La prise dans l’axe permet d’éviter ainsi tout ce qui consiste à chercher
et à chercher pour montrer. Si la caméra s’orientait vers le sommet
de l’arbre pour montrer les oiseaux, ce n’est jamais que montrer et
ça c’est une très mauvaise raison de faire un plan.
Le plan n’est pas fait pour montrer, c’est plutôt le contraire. Ce sont
les lignes qui imposent le cadre et les lignes, plutôt que de montrer,
elles font la disparition parce qu’alors on ne voit plus qu’elles.
Montrer moins pour donner plus à voir et dégager les lignes qui
font la profondeur.
Une question de relations sur l’ensemble…
Si la caméra n’est pas posée sur pied, comme cela s’est produit
lors de quelques prises du film Les Antiquités de Rome, c’est parce
que ce n’est pas toujours possible, pas permis. Dans le Panthéon à
Rome, que les Romains appellent aujourd’hui la Rotonde, il n’est
pas permis de poser un appareil photographique ou une caméra
sur un pied. Donc j’étais obligé de la tenir pour filmer l’ouverture
circulaire au milieu du dôme. Ouverture, c’est-à-dire que s’il pleut,
l’eau tombe à l’intérieur du Panthéon. En tenant la caméra dirigée
vers le haut, il y a peu de stabilité et évidemment ça bouge. C’est
l’opposé de ce que je voulais. Et pourtant, s’il n’y avait pas ce plan
tremblé, le film n’existerait pas. Là aussi, la justesse est venue d’un
accident contrariant.
Dans le film La Vallée close, il y a ce qu’on appelle un travelling. Je
suis dans une voiture, je tiens la caméra dans l’axe et on avance. On
quitte la place du village, on poursuit dans une rue qui devient une
route à la sortie du village et on finit sur le lever du soleil. Et tout
cela s’est parfaitement calé avec le son d’une parole qui a justifié
cette prise en mouvement.
Le plan fixe, c’est cependant la condition pour voir les lignes. Si
peu qu’on bouge, ça trouble les lignes et elles réapparaîtront une
fois que la caméra s’arrêtera à nouveau.
Mais ce qui est troublant aussi, troublant dans le sens émotionnel,
c’est lorsqu’il y a deux minutes et demie de tremblement sur un
film par ailleurs composé de plans fixes. Ça vient troubler la
rectitude du film et c’est facteur d’émotion.
C’est toujours une question de relations sur l’ensemble, de dosage
en quelque sorte.
Avec le tournage en vidéo, il n’y a pas ce qui était pour moi une
des choses importantes du super 8, c’est-à-dire cette unité constituée
par les cartouches du film super 8 qui dure 2 minutes 30 en 24
images par seconde. C’était une unité de mesure, un tatami diraient
les Japonais, une sorte de brique pour la construction du film. Une
structure pouvait alors s’établir à partir de cet élément de même
durée. Donc c’est là un changement très important.
Mais j’ai vu dès Lettre à Roberto (il n’y aurait pas eu ce premier
film en numérique si je n’avais pas vu ça), qu’il existe une limite qui
s’impose à la durée d’un plan et ça ressemble bien à un cadre, un
cadre cette fois au niveau temporel. Lettre à Roberto est intéressant
pour cela. La première prise s’est faite dans la chambre en déclenchant
la caméra après avoir vu un cadre. J’ai fait le déplacement qui me
semblait convenir puis je suis revenu à la caméra pour vérifier.
Voilà une particularité de la vidéo, on peut vérifier tout de suite,
c’est dans l’instant.
Tout de suite j’ai donc vu que ça n’allait pas et j’ai fait un autre
déplacement. Ce fut alors la surprise, la deuxième prise me
paraissant juste du début à sa fin en durant 7 minutes.



L’image est ce qu’elle est. Ce qui m’intéresse aux différentes étapes
de la réalisation du film, c’est de retrouver ou de conserver ce qui
a fait que j’ai eu envie de faire la prise. Donc je ne fais pas la prise
avec l’idée qu’ensuite, je vais rendre ça comme il faut en modifiant
l’image. Et aujourd’hui, aussi bien en cinéma qu’en photographie,
on peut éliminer des choses, on trafique l’image. Et là ça n’a plus
aucun sens, pourquoi avoir fait la prise dans ce cas-là ? Le travail,
c’est de conserver et de restituer dans les changements de support
qu’il peut y avoir, précisément ce que j’ai vu au moment du tournage.
C’était justement le problème dans le transfert des films super 8
en 16 mm. Comment être au plus prêt de l’original au niveau de
l’étalonnage ? C’est terrible d’avoir à confronter les étalonneurs
qui connaissent parfaitement leur métier et qui cherchent à le faire
au mieux, c’est à dire à normaliser et donc à faire disparaître tout
ce qui peut faire l’intérêt singulier du film.
On peut détruire un film par l’étalonnage.
La libération des éléments…
J’utilise toujours des textes poétiques car c’est aussi la libération
des éléments, la libération des mots.
La poésie, c’est déjà voir plus que comprendre, c’est déjà voir les
éléments.
Nouveau venu, qui cherche Rome en Rome
Et rien de Rome en Rome n’aperçoit.
Ça se regarde et, en même temps, on en ressent le sens d’une façon
intuitive, sans qu’il y ait besoin de discours. C’est par le positionnement
même des éléments, que sont les mots en poésie, que
cette intuition est rendue possible. En cela, pour Les Antiquités de
Rome, les deux vers du sonnet de Du Bellay donnaient l’orientation
et contenaient déjà le film.
Le film Faibles amusements s’allie à quatre vers de Bérénice de
Racine :
Aussitôt, sans l’attendre et sans être attendue,
Je reviens le chercher, et dans cette entrevue
Dire tout ce qu’ aux coeurs l’ un de l’ autre contents
Inspirent des transports retenus si longtemps.
Écrire ces vers, ce n’est pas affirmer quelque chose. Il s’agit de
poésie pure, on voit les éléments. C’est bien clair, comme le dit
Robert Bresson dans une note, que les objets, ici les mots, donnent
l’impression d’être là parce qu’ils veulent bien y être. Et c’est pour
ça qu’ils chantent.
Quand on entend la poésie, quand on voit les mots, ça libère des
dispositions, ça oriente.
Mais si on l’entend c’est peut-être qu’on est déjà dans cet état où
l’on peut voir les éléments et écouter la musique des sphères.
Ces limites donnent la richesse…
L’idée ne serait pas venue au peintre d’emporter dans la nature son
tableau pour aller peindre sur le motif. Tableau au sens strict, c’est à-
dire des planches de bois bien lourdes. Quand on est passé à la
toile, ça a été différent.
Au cours des époques, il se mêle des changements matériels et des
changements d’ordre social tout aussi concrets. On modifie ainsi la
pratique, on fait ce qui est possible avec ce dont on dispose.
La rampe de lumière qui éclairait la scène du théâtre au 17ème
siècle ne pouvait pas éclairer plus d’une vingtaine de minutes.
Après ce laps de temps, il fallait changer les bougies, et donc ça a
donné les 5 actes de la tragédie classique.
Il faut se méfier des contraintes que l’on se donne car, dans ce cas,
c’est l’expression d’une volonté. Cela exprime des intentions et
donc des prétentions.
Le mieux, c’est évidemment les contraintes réelles, celles que l’on
subit. Il existe assez de limites naturellement, selon les moyens
matériels dont on dispose.
D’une façon tout a fait paradoxale, ces limites donnent la richesse
au petit matériel car elles offrent des choses qui ne se présenteraient
pas avec des moyens techniques plus perfectionnés. En réduisant
la maîtrise, elles favorisent l’imprévu. Un matériel plus riche
aboutirait à quelque chose de plus pauvre.
Pour ces mêmes raisons, j’ai rapporté après l’avoir achetée, une
caméra super 8 Nizo qui avait tous les perfectionnements. Il y avait
trop de possibles. Elle offrait trop la possibilité d’obtenir ce qu’on
voulait.
Je garde toujours l’idée qu’il n’y a pas à aller chercher plus que ce
que permet ou propose le matériel utilisé.
Ma caméra super 8 n’enregistrait pas le son ; la rencontre entre le
son et l’image s’est donc faite après le tournage. Il fallait alors faire
correspondre un son avec les images.
C’est tout à fait différent avec une caméra numérique puisqu’elle
enregistre le son. C’est une différence importante, comme une
exigence supplémentaire. Une adéquation doit se trouver au
moment même du tournage entre le son et l’image. En quelque
sorte malgré le synchronisme qui est donné.
Il n’y a eu aucun travail sonore lors du montage de Lettre à Roberto
et très peu pour Juste avant l’orage.
Sur Faibles amusements, c’est différent. Il y a des choses qui se
jouent au niveau du synchronisme mais pas des choses forcément
voulues. Je veux dire que des accidents heureux peuvent encore se
produire avec le numérique.
Surtout si on n’est pas habile dans l’usage du logiciel de montage,
alors quelque chose peut se passer qui obligera à jongler autrement,
qui suscitera de l’agilité. L’habileté c’est terrible en art.
Picasso était d’une grande habileté, par contre Matisse n’était pas
quelqu’un d’habile. Il y a cette note très courte de Robert Bresson :
« Pas habile, mais agile. »
La forme circulaire…
En utilisant les outils numériques, très facilement on réalise ce que
peut faire le montage et comment on peut détruire les images avec
le raccord.
Lors du montage, il faut laisser assez d’autonomie aux prises pour
qu’elles puissent établir librement des correspondances entre elles,
sans être bloquées, sans faire un bloc avec la prise qui précède ou qui
suit. Ainsi, elles sont libres et peuvent établir une relation ailleurs,
bien loin.
Bien loin, mais cependant sans qu’elles paraissent éloignées, parce
que tout est à égale distance, ou plutôt sans distance, dans l’unité
du film. Dire loin, c’est voir les choses d’une manière linéaire et
donc considérer un début et une fin. Il y a cela et en même temps il
n’y a pas cela. Encore une fois ce qui me vient à l’esprit en parlant
de cette manière, c’est la forme circulaire ou l’orbite et non la ligne
avec un point final.
Le FILM
Le mouvement des atomes est éternel. Lancés à travers le vide,
soit par leur propre poids, soit par le choc des autres atomes,
ils errent, jusqu’à ce que le hasard les rapproche. Il y en a qui
arrivent à se cramponner fortement les uns aux autres; ils
forment les corps les plus durs. D’autres, plus mobiles, laissant
entre eux de plus grands intervalles, constituent les corps moins
denses, l’air et la lumière. Enfin, il y en a qui n’ont pu se faire
admettre dans aucun assemblage: ceux-là s’agitent inutilement
dans l’espace, comme ces grains de poussière qu’éclaire sur sa
route un rayon de soleil pénétrant dans une chambre obscure.
Henri Bergson, in Extraits de Lucrèce, De Rerum Natura.






Ce texte dit à lui seul tout le film La Vallée close, aussi bien dans
son histoire, celle que finalement il raconte, que dans son existence
même, sa réalité matérielle.
C’est ça qui est assez surprenant et évidemment on ne peut qu’en
être ému. Ça s’est découvert sans préméditation. On est face à cela
sans y être arrivé par la volonté. Donc, j’ai vu ça, je suis le premier
à l’avoir vu. Et donc voilà, j’ai compris ces choses seulement le
film fini et au cours des premières projections.
La compréhension ne précède pas le surgissement.
J’ai envie de dire que la structure du film existe dès le début, avant
même que soit posé quoi que ce soit, mais on ne la connaît pas et
elle se révèle progressivement dans l’attention portée aux éléments.
Quelques éléments bien vus suffisent à deviner l’orbite sur laquelle
ils gravitent déjà. Et donc c’est ça, deviner le film.
Il y a bien une pensée, quelque chose qui doit ressembler à une réflexion,
mais la mise en place est incertaine dans un premier temps.
Cueillir des images, cueillir des sons. Ils auront peut-être quelque
chose à se dire et même peut-être vont-ils se plaire et ne plus pouvoir
se quitter.
Mais au départ, c’est reconnaître la matière. C’est la voir et
l’entendre. Donc, une matière picturale, une matière sonore et ces
éléments, s’il y a le désir du film, s’ils sont appelés par le film, vont
s’accorder. Ils vont s’organiser selon la loi du film, car sans que je
connaisse le film il est là cependant. Et donc il n’y a qu’une place
possible pour les éléments lorsqu’ils se découvrent, qu’une place
juste. Mais je ne sais pas, j’y vais à tâtons, en aveugle. Je veux dire
soit le film accepte, soit il refuse. Le film sait, moi je ne sais pas.
On sait qu’il y a un film, que le film est fini, seulement quand tout
s’établit en correspondance, et des correspondances directes, des
lignes claires. Et là, il n’y a rien à ajouter, rien à retrancher. Tout
est justifié.
Le positionnement, pour ne pas dire le montage, le positionnement
des éléments, c’est la loi du film qui l’impose.
Chaque film est un système qui a sa propre loi, comme on parle de
loi en Physique.
Mon cher sujet
Matisse disait qu’il peignait toujours les bouquets du côté où ils
n’avaient pas été préparés.
C’est dans l’oubli des idées, qu’on n’a pas pu s’empêcher d’avoir,
que le film se fait. Dans une sorte d’étourderie. Il y a bien une attention
mais elle ne porte que sur les éléments. Elle est contemplative
puisque les éléments ne peuvent être que contemplés. L’attention
pure, c’est l’oubli. Lâcher prise sur les idées et oublier ainsi ce que
l’on veut. Et donc cette faculté d’abandon, de se laisser saisir, qui
pourrait paraître une faiblesse intellectuelle, c’est ce qui permet
justement le film. C’est sa chance. Le film se fait sans connaître le
sujet.
À quoi bon faire un film si on connaît le sujet ? C’est le manque
du sujet qui appelle le film. La raison du film, c’est précisément la
découverte du sujet. On est dans cette attente. Le regard doit
tenir comme ça. C’est le vrai suspens. Chaque plan est imprévisible
parce qu’on ne part pas du sujet mais qu’on y va.
Projeté vers le sujet comme projeté vers l’autre. Car ce n’est pas
pour soi que le film se fait, je crois qu’il se fait vraiment pour l’autre.
Sans cela, il n’y aurait pas d’énergie et pas de désir, d’ailleurs. Le
désir du film, c’est le désir de l’autre. C’est aussi cela que signifie
le désir du sujet. « Mon cher sujet ».
L’effacement du monde…
Les éléments bougent et s’animent secrètement, et si peu qu’ils
voient le jour, que l’air passe, tout s’évente et disparaît. J’ai à
l’esprit cette séquence du film Fellini Roma où l’on voit des
travaux pour la construction du métro à Rome. Inévitablement,
les ouvriers rencontrent des zones archéologiques et à un moment
ils butent sur une ancienne villa. Il creusent une ouverture dans
le mur et découvrent alors les fresques magnifiques peintes à
l’intérieur. Mais, aussitôt qu’on les voit, elles disparaissent car
l’air qui s’engouffre les efface toutes.
C’est bien l’idée que si peu que l’air passe, que ça prenne jour, ça
se rétracte ou ça se voile et toutes les relations et correspondances
qui auraient pu exister librement entre les éléments sont compromises.
Il y a comme une timidité au monde de l’oeuvre se faisant
et qui exige le secret. Par contre, une fois que les éléments ont pris
place, ils s’y tiennent. Ils se voient sans risque et on ne peut plus les
faire bouger. Mais avant qu’ils arrivent là, ça ne peut être que dans
le secret et dans la préservation du mystère.
Le mystère de la création, c’est précisément cela, c’est le fait que
les éléments se mettent en mouvement et vont d’eux-mêmes où
ils veulent. Donc ce n’est pas parler d’une méthode mais c’est
ressentir une exigence et éprouver en même temps une sorte de
fragilité, de vulnérabilité, comme une situation dangereuse avant
que le film impose sa présence.
Mes films se font en toute indépendance sans rien en dire et sans
avoir de compte à rendre. Autrement, vu la manière dont ils se font,
ce serait tout à fait bloquant.
Je pourrais prendre l’exemple de ce qui s’est fait pendant mon séjour
en Corée, quand j’étais invité au festival de Jeon Ju. Je n’avais pas
l’idée d’y faire un film et je n’avais pas apporté de caméra. Mais
après avoir vu certaines choses, j’ai demandé s’il était possible
qu’on m’en prête une. J’ai eu ainsi une caméra numérique, un pied
et trois cassettes. J’ai fait des prises sans avoir du tout l’idée d’un
film, simplement à cause du cadre qui s’imposait. C’est seulement
après, que deux de ces prises se sont accordées pour faire Juste
avant l’orage.
Il n’y avait donc pas de projet. Le film n’est pas parti d’une idée.
L’idée n’est venue qu’après l’image. C’est ainsi que tous mes films
se font ; sans producteur, puisque le producteur n’accorde de
financement que sur un projet, un scénario qui pour lui est une
sorte de cahier des charges à respecter. Je crois que l’indépendance
est nécessaire à l’art.
Il me semble que la création passe même par une absence au
monde. Or, il y a une exigence de conformité sociale qui accepte
difficilement qu’on se tienne à l’écart, qu’on s’absente. Elle laisse
peu d’échappées et on peut se demander comment elle n’étouffe
pas tout. Mais si peu qu’une aspiration subsiste, elle est vive.
Le cinéma est un art qui n’est ni la peinture ni la musique, mais
qui, comme en peinture ou en musique, peut donner à voir (et à
entendre) les éléments et nous saisir dans la perception de leurs
correspondances.
C’est en cela une nourriture de l’âme, autant qu’un tableau ou
qu’une musique, dont le besoin ne change pas, même si tout est
fait pour l’éteindre ou pour tromper la faim. N’est-ce pas le rôle de
la télévision ? Mais même si on nous bouche la vue, les yeux sont
là, la capacité de regard est là et le besoin de voir se manifeste
occasionnellement.
Voir un film pour moi, ça reste le voir en salle. Il me semble qu’il
subsiste des différences essentielles entre voir un film en salle ou
sur l’écran d’un téléviseur. En salle, on voit le film projeté, on
tourne le dos à la source lumineuse. Tandis que regarder la télévision,
ce n’est jamais que regarder une ampoule. Regarder la télévision,
c’est regarder la source lumineuse. C’est ce qu’il ne faut pas faire.
C’est en quelque sorte ce qui n’est pas permis.
On regarde ce qu’elle éclaire, mais on n’a pas l’impudence de fixer
la lumière. C’est la faute originelle du téléspectateur…
Et puis pour voir la projection, l’obscurité est nécessaire. Il faut
faire le noir… Comme si l’image projetée exigeait l’effacement
du monde.
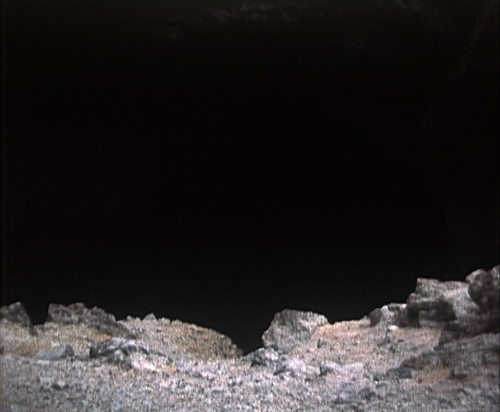
Paris, le 9 novembre 2003, le 25 janvier et le 13 mars 2004






