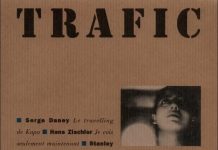Vers la fin du film, un homme enseigne à son fils – un petit garçon – les rudiments de la pêche. La barque glisse sur l’eau calme, la caméra cadre les rives qui sont rocheuses, surplombantes, calmes aussi. Une voix (celle de l’enfant) se fait alors entendre. Elle dit : « Alemanha… » Voix off – mais elle n’affirme pas, n’interroge pas, se hasarde plutôt, rêve tout haut. Puis, sur le même ton : « Espanha… ». Ce que l’image indique en effet c’est l’Espagne toute proche, derrière l’écran des montagnes. Mais la voix qui dit « Espanha » ne parle pas plus fort que l’autre, ne la corrige pas. C’est que l’Allemagne aussi est là, dans l’énonciation de l’enfant. Plus loin dans le film, la rime s’accomplira : lecture d’une lettre qu’envoie un père, d’Allemagne justement, où il a émigré. Ce n’est donc pas l’un ou l’autre, c’est tout à la fois les deux pays, réduits chacun à un mot. Il y a l’Espagne qui est le off de l’image, l’au-delà du regard et l’Allemagne qui est le off du son, l’en-deça de la voix. Une zone de rêve et d’angoisse les sépare et les lie, c’est ce qu’on appelle un « plan ».
L’éloignement est le sujet du film qu’Antonio Reis et Margarida Cordeiro ont fabriqué dans la province de Trás-os-Montes (d’où le film tire son titre) en 1976. Au double sens d’être loin (exil) et de l’acte même d’éloigner (perte de vue, puis oubli). L’éloignement, nous disent peu à peu Reis et Cordeiro, est l’histoire de ce Nordeste du Portugal. C’est la domination distante, incompréhensible et incompréhensive de la Capitale (Lisbonne) sur le Trás-os-Montes. A tel point que les Lois, édictées de la Capitale, ne parviennent pas jusqu’aux paysans et que ceux-ci s’interrogent : existent-elles seulement ? Scène-clé du film où Reis traduit en dialecte un extrait de La muraille de Chine de Kafka, scène-clé en ce qu’on a vu le problème se reposer tragiquement, dans le réel, en 1976. Éloignement qui dé-culture la province, la coupe de son passé celte et païen, en folklorise les miettes de culture populaire sous forme de cartes postales. Éloignement des paysans des champs cultivés et des pâturages, d’abord vers les mines de la région (scène magnifique où Armando, l’enfant à la toupie, visite la mine désaffectée, ruisselante de pluie), puis vers l’Amérique (le père, jamais vu, soudain revenu d’Argentine et aussitôt reparti), enfin vers l’Europe des usines et des chaînes, França, Alemanha.
L’éloignement (ou son opposé : le rapprochement) qui intéresse les auteurs de Tras-os-Montes se produit dans le hic et nunc du présent. Ce n’est pas le dépoussiérage désolé de l’enfoui, la plainte du temps qui passe ou l’exhibition de trésors qui n’en sont pour personne (sinon pour un public nécrophile, à la «Connaissance du Monde»), c’est une opération autrement exigeante : rendre attentif à ce qui dans le plan (zone, je tiens à le rappeler, de rêve et d’angoisse) renvoie à ailleurs et construire ainsi, peu à peu, ce qu’on pourrait appeler « l’état filmique d’une province ». Et pour ce faire, Reis et Cordeiro ne partent surtout pas du fait de l’existence officielle du Trás-os-Montes (celui des cartes de géographie ou de la bureaucratie de Lisbonne) mais du contraire : du creusement, du déchirement de chaque « plan », comme cette rivière déjà citée qui creuse son lit entre l’Espagne et l’Allemagne et qui coule, donc, au Portugal.
L’éloignement n’est pas seulement un thème (sur lequel on peut bavarder, faire montre d’un savoir, bâcler des critiques), c’est aussi la matière du film Trás-os-Montes. La sourde énonciation de chaque plan profère la même question : est-ce qu’il y a des degrés dans le off ? Peut-on être plus (Alemanha) ou moins (Spanha) off ? Autrement dit : quel est le statut – la qualité d’être – de ce qui sort du champ (de ce qu’il exprime et de ce qu’il expulse) ?
On devine que la réponse que nous donnons est celle-ci (d’elle dépend toute une jouissance du cinéma) : dans le off, il n’y a pas de degrés. Quand tu es loin, même si c’est la porte à côté, au cinéma, tu es perdu à jamais. Ainsi pourrait se résumer, d’une formule typiquement obsessionnelle, ce qu’il en est de la dialectique du in et du off dans le cinéma moderne. Et il faudrait ajouter, pour que l’indétermination soit totale : et si tu reviens, qu’est-ce qui me prouve que c’est toujours bien toi ?
La « robe sans couture du réel » dans rêvait Bazin est toujours cisaillée par le cadre, par le montage, par tout ce qui choisit. Mais même rafistolée (raccommodée) d’un contre-champ qui la recoud, elle est habitée par une horreur fondamentale, un malaise : ce que le plan A exhibait et que le plan B a escamoté peut très bien revenir au plan C, mais travesti, sans preuve que ce n’est pas devenue autre chose. Tout ce qui passe par les limbes du off est susceptible de revenir autre. Tout narratifs et représentatifs qu’ils étaient, des gens comme Lang ou Tourneur (continués aujourd’hui par Jacquot ou Biette) ne filmaient que cet autre, ce doute au sein du même, était possible, générateur d’horreur ou de comique (cf. : Buñuel dont c’est le ressort principal). J’ai l’air d’oublier le film de Reis, il n’en est rien. J’en veux pour preuve l’étonnante dernière scène du film où un train troue la nuit, suivi, pourrait-on dire de force par la caméra qui ne le distingue pas toujours bien de l’obscurité et qui ne cesse de le redécouvrir (fort/da), soit sous forme de fumée (pour l’œil), soit sous forme de sifflement (pour l’oreille).
Pour lui, il n’y a pas plus de degrés dans l’éloignement temporel que dans l’éloignement spatial. Pas plus de mémoire récente que de mémoire longue. Tout ce qui n’est pas là est, a priori, également perdu – et donc, c’est là le point important, également à produire. Rupture avec une conception linéaire, gradualiste de la perte (de vue ou de mémoire) au bénéfice d’une conception dynamique, hétérogène, matérielle. Car production, cela veut dire deux choses : on produit une marchandise (par son travail) mais on produit une pièce à conviction (quand il le faut). Cinéma = exhibition + travail. C’est ainsi que, malgré leur érudition Reis et Cordeiro, se comportent sans cesse comme s’ils venaient d’apprendre pour eux-mêmes ce qu’ils allaient communiquer à un spectateur également totalement ignorant. Il faut prendre Reis au sérieux quand il parle, dans l’entretien, de « table rase ». Et il n’est pas sûr que cette attitude ne soit pas, au bout du compte, préférable à celle qui consiste à travailler à partir du savoir ou du supposé-savoir du spectateur, quand ce n’est pas à partir d’une doxa commune (génératrice, comme toute doxa, de paresse repue, particulièrement dévastatrice dans les fictions de gauche). J’inclinerais plutôt à penser qu’il vaut mieux – de quelque côté que l’on soit de la caméra – mettre en pratique l’adage mizoguchien : se laver les yeux entre chaque plan.
Texte initialement paru dans les Cahiers du Cinéma, n°276, p. 42-44, Mai 1977