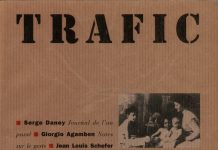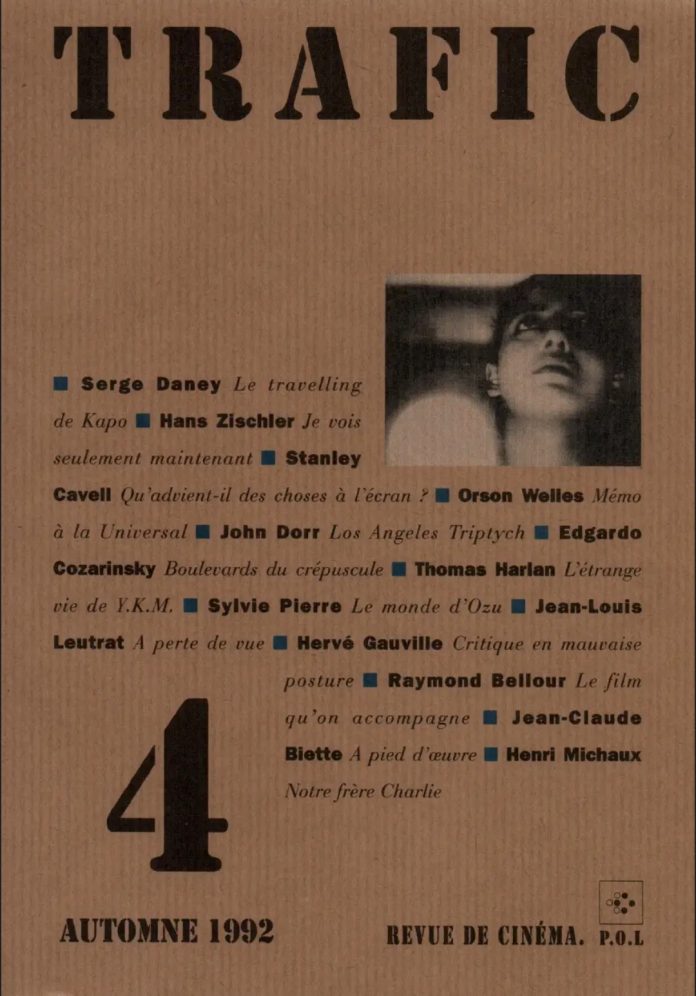
Au nombre des films que je n’ai jamais vus, il n’y a pas seulement Octobre, Le jour se lève ou Bambi, il y a l’obscur Kapo. Film sur les camps de concentration, tourné en 1960 par l’Italien de gauche Gillo Pontecorvo, Kapo ne fit pas date dans l’histoire du cinéma. Suis-je le seul, ne l’ayant jamais vu, à ne l’avoir jamais oublié ? Car je n’ai pas vu Kapo et en même temps je l’ai vu. Je l’ai vu parce que quelqu’un – avec des mots – me l’a montré. Ce film, dont le titre, tel un mot de passe, accompagna ma vie de cinéma, je ne le connais qu’à travers un court texte : la critique qu’en fit Jacques Rivette en juin 1961 dans les Cahiers du cinéma. C’était le numéro 120, l’article s’appelait « De l’abjection », Rivette avait trente-trois ans et moi dix-sept. Je ne devais jamais avoir prononcé le mot « abjection » de ma vie.
Dans son article, Rivette ne racontait pas le film, il se contentait, en une phrase, de décrire un plan. La phrase, qui se grava dans ma mémoire, disait ceci : « Voyez cependant, dans Kapo, le plan où Riva se suicide, en se jetant sur les barbelés électrifiés : l’homme qui décide, à ce moment, de faire un travelling avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant soin d’inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage final, cet homme n’a droit qu’au plus profond mépris. » Ainsi, un simple mouvement de caméra pouvait-il être le mouvement à ne pas faire. Celui qu’il fallait – à l’évidence – être « abject » pour faire. A peine eus-je lu ces lignes que je sus que leur auteur avait absolument raison.
Abrupt et lumineux, le texte de Rivette me permettait de mettre des mots sur ce visage-là de l’abjection. Ma révolte avait trouvé des mots pour se dire. Mais il y avait plus. Il y avait que la révolte s’accompagnait d’un sentiment moins clair et sans doute moins pur : la reconnaissance soulagée d’acquérir ma première certitude de futur critique. Au fil des années, en effet, « le travelling de Kapo » fut mon dogme portatif, l’axiome qui ne se discutait pas, le point-limite de tout débat. Avec quiconque ne ressentirait pas immédiatement l’abjection du « travelling de Kapo », je n’aurais, définitivement, rien à voir, rien à partager.
Ce genre de refus était d’ailleurs dans l’air du temps. Au vu du style rageur et excédé de l’article de Rivette, je sentais que de furieux débats avaient déjà eu lieu et il me paraissait logique que le cinéma soit la caisse de résonance privilégiée de toute polémique. La guerre d’Algérie finissait qui, faute d’avoir été filmée, avait soupçonné par avance toute représentation de l’Histoire. N’importe qui semblait comprendre qu’il puisse y avoir – même et surtout au cinéma – des figures tabou, des facilités criminelles et des montages interdits. La formule célèbre de Godard voyant dans les travellings « une affaire de morale » était à mes yeux un de ces truismes sur lesquels on ne reviendrait pas. Pas moi, en tout cas.
Cet article avait été publié dans les Cahiers du cinéma, trois ans avant la fin de leur période jaune. Eus-je le sentiment qu’il n’aurait pu être publié dans aucune autre revue de cinéma, qu’il appartenait au fonds Cahiers comme moi, plus tard, je leur appartiendrais ? Toujours est-il que j’avais trouvé ma famille, moi qui en avais si peu. Ainsi donc, ce n’était pas seulement par mimétisme snob que j’achetais les Cahiers depuis deux ans et que j’en partageais le commentaire ébahi avec un camarade – Claude D. – du lycée Voltaire. Ainsi, ce n’était pas pure lubie si, au début de chaque mois, j’allais coller mon nez à la vitrine d’une modeste librairie de l’avenue de la République. Il suffisait que, sous la bande jaune, la photo noir et blanc de la couverture des Cahiers ait changé pour que le cœur me batte. Mais je ne voulais pas que ce soit le libraire qui me dise si le numéro était paru ou non. Je voulais le découvrir par moi-même et l’acheter froidement, la voix blanche, comme s’il se fût agi d’un cahier de brouillon. Quant à l’idée de m’abonner, elle ne m’effleura jamais : j’aimais cette attente exaspérée. Que ce soit pour les acheter, puis pour y écrire et enfin pour les fabriquer, je pouvais bien rester à la porte des Cahiers puisque, de toute façon, les Cahiers c’était « chez moi ».
Nous étions une poignée, au lycée Voltaire, à être entrés subrepticement en cinéphilie. Cela peut se dater : 1959. Le mot « cinéphile » était encore guilleret mais déjà avec la connotation maladive et l’aura rance qui le discréditeraient peu à peu. Quant à moi, je dus mépriser d’emblée ceux qui, trop normalement constitués, se gaussaient déjà des « rats de cinémathèque » que nous allions devenir pour quelques années, coupables de vivre le cinéma comme passion et leur vie par procuration. A l’aube des années 60, le ciné-monde était encore un monde enchanté. D’un côté, il possédait tous les charmes d’une contre-culture parallèle. De l’autre, il avait cet avantage d’être déjà constitué, avec une histoire lourde, des valeurs reconnues, les coquilles du Sadoul – cette Bible insuffisante -, une langue de bois et des mythes tenaces, des batailles d’idées et des revues en guerre. Les guerres étaient presque finies et nous arrivions certes un peu tard, mais pas assez pour ne pas nourrir le projet tacite de nous réapproprier toute cette histoire qui n’avait pas encore l’âge du siècle.
Etre cinéphile, c’était simplement ingurgiter, parallèlement à celui du lycée, un autre programme scolaire, calqué sur le premier, avec les Cahiers jaunes comme fil rouge et quelques passeurs « adultes » qui, avec la discrétion des conspirateurs, nous signifiaient qu’il y avait bien là un monde à découvrir et peut-être rien de moins que le monde à habiter. Henri Agel – professeur de lettres au lycée Voltaire- fut un de ces passeurs singuliers. Pour s’éviter autant qu’à nous la corvée des cours de latin, il mettait aux voix le choix suivant : ou passer une heure sur un texte de Tite-Live ou voir des films. La classe, qui votait pour le cinéma, sortait régulièrement pensive et piégée du vétuste ciné-club. Par sadisme et sans doute parce qu’il en possédait les copies, Agel projetait des petits films propres à sérieusement déniaiser les adolescents. C’était Le Sang des bêtes de Franju et surtout, Nuit et Brouillard de Resnais. C’était donc par le cinéma que je sus que la condition humaine et la boucherie industrielle n’étaient pas incompatibles et que le pire venait juste d’avoir lieu.
Je suppose aujourd’hui qu’Agel, pour qui Mal s’écrivait avec une majuscule, aimait guetter sur le visage des adolescents de la classe de seconde B les effets de cette singulière révélation, car c’en était une. Il devait y avoir une part de voyeurisme dans cette façon brutale de transmettre, par le cinéma, ce savoir macabre et imparable dont nous étions la première génération à hériter absolument. Chrétien guère prosélyte, militant plutôt élitaire, Agel montrait, lui aussi. Il avait ce talent. Il montrait parce qu’il le fallait. Et parce que la culture cinématographique au lycée, pour laquelle il militait, passait aussi par ce tri silencieux entre ceux qui n’oublieraient plus Nuit et Brouillard et les autres. Je ne faisais pas partie des « autres ».
Une fois, deux fois, trois fois, selon les caprices d’Agel et les cours de latin sacrifiés, je regardai les célèbres empilements de cadavres, les cheveux, les lunettes et les dents. J’entendis le commentaire désolé de Jean Cayrol dans la voix de Michel Bouquet et la musique de Hanns Eisler qui semblait s’en vouloir d’exister. Etrange baptême des images : comprendre en même temps que les camps étaient vrais et que le film était juste. Et que le cinéma – lui seul ? – était capable de camper aux limites d’une humanité dénaturée. Je sentais que les distances mises par Resnais entre le sujet filmé, le sujet filmant et le sujet spectateur étaient, en 1959 comme en 1955, les seules possibles. Nuit et Brouillard, un « beau » film ? Non, un film juste. C’est Kapo qui voulait être un beau film et qui ne l’était pas. Et c’est moi qui ne ferais jamais bien la différence entre le juste et le beau. D’où l’ennui, pas même « distingué », qui fut toujours le mien devant les belles images.
Capté par le cinéma, je n’avais pas eu besoin – en plus – d’être séduit. Pas besoin non plus qu’on me parle bébé. Enfant, je n’ai vu aucun film de Walt Disney. De même que j’étais directement allé à l’école communale, j’étais fier de m’être vu épargner la maternelle criarde des séances enfantines. Pire : le dessin animé serait toujours pour moi autre chose que le cinéma. Pire encore :le dessin animé serait toujours un peu l’ennemi. Aucune « belle image » a fortiori dessinée, ne me tiendrait quitte de l’émotion – crainte et tremblement – devant les choses enregistrées. Et tout cela qui est si simple et qu’il me fallut des années pour formuler simplement, devait commencer à sortir des limbes devant les images de Resnais et le texte de Rivette. Né en 1944, deux jours avant le débarquement allié, j’avais l’âge de découvrir en même temps mon cinéma et mon histoire. Drôle d’histoire que longtemps je ne crus que partager avec d’autres avant de réaliser – bien tard – que c’était bel et bien la mienne.
Que sait un enfant ? Et cet enfant Serge D. qui voulait tout savoir sauf ce qui le regardait en propre ? Sur quel fond d’absence au monde la présence aux images du monde sera-t-elle plus tard requise ? Je connais peu d’expressions plus belles que celle de Jean Louis Schefer quand, dans L’Homme ordinaire du cinéma, il parle des « films qui ont regardé notre enfance ». Car une chose est d’apprendre à regarder les films « en professionnel » – pour vérifier d’ailleurs que ce sont eux qui nous regardent de moins en moins – et une autre est de vivre avec ceux qui nous ont regardés grandir et qui nous ont vus, otages précoces de notre biographie à venir, déjà empêtrés dans les rets de notre histoire. Psychose, La dolce vità, Le Tombeau hindou, Rio Bravo, Pickpocket, Autopsie d’un meurtre, Le Héros sacrilège ou, justement, Nuit et Brouillard ne sont pas pour moi des films comme les autres. A la question brutale « est-ce que ça te regarde ? » ils me répondent tous oui.
Les corps de Nuit et Brouillard et, deux ans plus tard, ceux des premiers plans d’Hiroshima mon amour sont de ces « choses » qui m’ont regardé plus que je ne les ai vues. Eisenstein a tenté de produire de telles images mais Hitchcock, lui, y est parvenu. Comment – ce n’est qu’un exemple – oublier la première rencontre avec Psychose ? Nous étions entrés en fraude au Paramount Opéra et le film nous terrorisait le plus normalement du monde. Et puis, vers la fin, il y a une scène sur laquelle ma perception glisse, un montage « à la six quatre deux » d’où n’émergent que des accessoires grotesques : une robe de chambre cubiste, une perruque qui tombe, un couteau brandi. A l’effroi vécu en commun succède alors le calme d’une solitude résignée : le cerveau fonctionne comme un appareil de projection bis qui laisserait filer l’image, laissant le film et le monde continuer sans lui. Je n’imagine pas d’amour du cinéma qui ne s’arc-boute sur le présent volé de ce « continuez sans moi »-là.
Cet état, qui ne l’a vécu ? Ces souvenirs-écrans, qui ne les a connus ? Des images non identifiées s’inscrivent sur la rétine, des évènements inconnus ont fatalement lieu, des mots proférés deviennent le chiffre secret d’un impossible savoir sur soi. Ces moments de « pas vu pas pris » sont la scène primitive de l’amateur de cinéma, celle où il n’était pas alors qu’il ne s’agissait que de lui. Au sens où Paulhan parle de la littérature comme d’une expérience du monde « quand nous ne sommes pas là » et Lacan de « ce qui manque à sa place ». Le cinéphile ? Celui qui écarquille en vain les yeux mais qui ne dira à personne qu’il n’a rien pu voir. Celui qui se prépare une vie de « regardeur » professionnel. Histoire de faire son retard, de « se refaire » et de se faire. Le plus lentement possible.
C’est ainsi que ma vie eut son point zéro, seconde naissance vécue comme telle et immédiatement commémorée. La date est connue, et c’est toujours 1959. C’est – coïncidence ? – l’année du célèbre « Tu n’as rien vu à Hiroshima » de Duras. Nous sortons d’Hiroshima mon amour, ma mère et moi, sidérés l’un et l’autre – nous n’étions pas les seuls – parce que nous n’avions jamais pensé que le cinéma était capable de « cela ». Et sur le quai du métro, je réalise enfin que face à la question fastidieuse à laquelle je ne sais plus quoi répondre – « Qu’est-ce que tu vas faire dans la vie ? » – je dispose depuis quelques minutes d’une réponse. « Plus tard », d’une façon ou d’une autre, ce serait le cinéma. Aussi n’ai-je jamais été avare de détails sur cette ciné-naissance à moi-même. Hiroshima, le quai du métro, ma mère, feu le studio des Agriculteurs et ses fauteuils club seront plus d’une fois évoqués comme le décor légendaire de la bonne origine, celle qu’on se choisit.
Resnais est, je le vois bien, le nom qui relie cette scène primitive en deux ans et trois actes. C’est parce que Nuit et Brouillard avait été possible que Kapo naissait périmé et que Rivette pouvait écrire son article. Pourtant, avant d’être le prototype du cinéaste « moderne », Resnais fut pour moi un passeur de plus. S’il révolutionnait, comme on disait alors, le « langage cinématographique », c’est qu’il se contentait de prendre son sujet au sérieux et qu’il avait eu l’intuition, presque la chance, de reconnaître ce sujet au milieu de tous les autres : rien de moins que l’espèce humaine telle qu’elle était sortie des camps nazis et du trauma atomique : abîmée et défigurée. Aussi y eut-il toujours quelque chose d’étrange dans la façon dont je devins par la suite le spectateur un peu ennuyé des « autres » films de Resnais. Il me semblait que ses tentatives de revitaliser un monde, dont lui seul avait enregistré à temps la maladie, étaient vouées à ne produire que du malaise.
Ce n’est donc pas avec Resnais que je ferai le voyage du cinéma « moderne » et son devenir, plutôt avec Rossellini. Pas avec Resnais que les leçons de choses et de morale seront apprises par cœur et déclinées, toujours avec Godard. Pourquoi ? D’abord, parce que Godard et Rossellini ont parlé, écrit, réfléchi à voix haute et que, à l’inverse, l’image de Resnais-statue du Commandeur, transi dans ses anoraks et demandant – à juste titre mais en vain – qu’on le croie quand il déclarait ne pas être un intellectuel, finit par m’agacer. Me suis-je ainsi « vengé » du rôle que deux de ses films avaient joué en « lever de rideau » de ma vie ? Resnais était le cinéaste qui m’avait enlevé à l’enfance ou qui, plutôt, avait fait de moi et pour trois décennies, un enfant sérieux. Et c’était justement celui avec lequel, adulte, je n’échangerais jamais rien. Je me souviens qu’au terme d’un entretien – c’était pour la sortie de La vie est un roman -, je crus bon de lui parler du choc d’Hiroshima mon amour dans ma vie, ce dont il me remercia avec un air pincé et lointain, comme si j’avais dit du bien de son dernier imperméable. Je fus vexé mais j’avais tort : les films « qui ont regardé notre enfance » ne sont pas partageables, même avec leur auteur.
Maintenant que cette histoire est bouclée et que j’ai eu plus que ma part du « rien » qu’il y avait à voir à Hiroshima, je me pose fatalement la question : pouvait-il en être autrement ? Y avait-il, face aux camps, une autre justesse possible que celle de l’anti-spectacle de Nuit et Brouillard ? Une amie évoquait récemment le documentaire de George Stevens, réalisé à la fin de la guerre, enterré, exhumé, puis récemment montré à la télévision française. Premier film qui ait enregistré l’ouverture des camps en couleurs et que ses couleurs mêmes font basculer – sans abjection aucune – dans l’art. Pourquoi ? La différence entre les couleurs et le noir et blanc ? Entre l’Amérique et l’Europe ? Entre Stevens et Resnais ? Ce qui est magnifique dans le film de Stevens, c’est qu’il s’agit encore d’un récit de voyage : la progression au quotidien d’un petit groupe de soldats filmeurs et de cinéastes flâneurs à travers l’Europe détruite, de Saint-Lô rasé à Auschwitz que nul n’a prévu et qui bouleverse l’équipe. Et puis, me dit mon amie, les empilements de cadavres y ont une beauté étrange qui fait penser à la grande peinture de ce siècle. Comme toujours, Sylvie P. avait raison.
Ce que je comprends aujourd’hui, c’est que la beauté du film de Stevens est moins le fait de la justesse de la distance trouvée que de l’innocence du regard porté. La justesse est le fardeau de celui qui vient « après » ; l’innocence, la grâce terrible accordée au premier venu. Au premier qui exécute simplement les gestes du cinéma. Il me faudrait le milieu des années 70 pour reconnaître dans le Salo de Pasolini ou même le Hitler de Syberberg l’autre sens du mot « innocent ». Moins le non-coupable que celui qui, filmant le Mal, ne pense pas à mal. En 1959, j’étais déjà pris, petit juste raidi dans sa découverte, dans le partage de la culpabilité de tous. Mais en 1945, il suffisait peut-être d’être américain et d’assister, comme George Stevens ou le caporal Samuel Fuller à Falkenau, à l’ouverture des vraies portes de la nuit, caméra à la main. Il fallait être américain – c’est-à-dire croire à l’innocence foncière du spectacle – pour faire défiler la population allemande devant les tombes ouvertes, pour lui montrer ce à côté de quoi elle avait vécu, si bien et si mal. Il fallait que ce soit dix ans avant que Resnais ne se mette à sa table de montage et quinze ans avant que Pontecorvo n’y ajoute ce petit mouvement de trop qui nous révolta, Rivette et moi. La nécrophilie était donc le prix de ce « retard » et la doublure érotique du regard « juste », celui de l’Europe coupable, celui de Resnais : et par voie de conséquence, le mien.
Telle fut l’entame de mon histoire. L’espace ouvert par la phrase de Rivette était bien le mien, comme était déjà mienne la famille intellectuelle des Cahiers du cinéma. Mais cet espace était, je devais m’en rendre compte, moins un vaste champ qu’une porte étroite. Avec, du côté noble, cette jouissance de la distance juste et son envers de nécrophilie sublime ou sublimée. Et du côté non noble, la possibilité d’une jouissance tout autre et in-sublimable. C’est Godard qui, me montrant quelques cassettes de « porno concentrationnaire » serrées dans un coin de sa vidéothèque de Rolle, s’étonna un jour qu’à l’encontre de tels films aucun discours n’ait été tenu ni aucune interdiction prononcée. Comme si la bassesse d’intentions de leurs fabricants et la trivialité des fantasmes de leurs consommateurs les « protégeaient » en quelque sorte de la censure et de l’indignation. Preuve que du côté de la sous-culture, perdurait la sourde revendication d’un entrelacement obligatoire entre les bourreaux et les victimes. L’existence de ces films ne m’avait effectivement jamais troublé. J’avais envers eux – comme envers tout cinéma ouvertement pornographique – la tolérance presque polie que l’on porte à l’expression du fantasme lorsque celui-ci est si nu qu’il ne revendique que la triste monotonie de sa nécessaire répétition.
C’est l’autre pornographie – celle, « artistique », de Kapo, comme plus tard celle de Portier de nuit et autres produits « rétro » des années 70 – qui toujours me révolterait. A l’esthétisation consensuelle de l’après-coup, je préférerais le retour obstiné des non-images de Nuit et Brouillard, voire le déferlement pulsionnel d’un quelconque Louve chez les S.S. que je ne verrais pas. Ces films-là avaient au moins l’honnêteté de prendre acte d’une même impossibilité de raconter, d’un même cran d’arrêt dans le déroulé de l’Histoire, quand le récit se fige ou s’emballe à vide. Aussi n’est-ce même pas d’amnésie ou de refoulement qu’il faudrait parler mais de forclusion. Forclusion dont j’apprendrai plus tard la définition lacanienne : retour hallucinatoire dans le réel de ce sur quoi il n’a pas été possible de porter un « jugement de réalité ». Autrement dit : puisque les cinéastes n’ont pas filmé en son temps la politique de Vichy, leur devoir, cinquante ans plus tard, n’est pas de se racheter imaginairement à coups d’Au revoir les enfants mais de tirer le portrait actuel de ce bon peuple de France qui, de 1940 à 1942, rafle du Vel’ d’Hiv comprise, n’a pas bronché. Le cinéma étant l’art du présent, ses remords sont sans intérêt.
C’est pourquoi le spectateur que je fus devant Nuit et Brouillard et le cinéaste qui, avec ce film, tenta de montrer l’irreprésentable, étaient liés par une symétrie complice. Soit c’est le spectateur qui soudain « manque à sa place » et s’arrête alors que le film, lui, continue. Soit c’est le film qui, au lieu de « continuer », se replie sur lui-même et sur une « image » provisoirement définitive qui permette au sujet-spectateur de continuer à croire au cinéma et au sujet-citoyen à vivre sa vie. Arrêt sur le spectateur, arrêt sur l’image : le cinéma est entré dans son âge adulte. La sphère du visible a cessé d’être tout entière disponible : il y a des absences et des trous, des creux nécessaires et des pleins superflus, des images à jamais manquantes et des regards pour toujours défaillants. Spectacle et spectateur cessent de se renvoyer toutes les balles. C’est ainsi qu’ayant choisi le cinéma, réputé « art de l’image en mouvement », je commençai ma vie de cinéphage sous l’égide paradoxale d’un premier arrêt sur l’image.
Cet arrêt me protégea de la stricte nécrophilie et je ne vis aucun des rares films ou documentaires « sur les camps » qui suivirent Kapo. L’affaire pour moi était réglée par Nuit et Brouillard et l’article de Rivette. Je fus longtemps comme les autorités françaises qui, aujourd’hui encore, face à tout fait divers antisémite, diffusent en catastrophe le film de Resnais comme s’il faisait partie d’un arsenal secret qui, à la récurrence du Mal, pourrait indéfiniment opposer ses vertus d’exorcisme. Mais si je n’appliquai pas l’axiome du « travelling de Kapo » aux seuls films que leur sujet exposait à l’abjection, c’est que j’étais tenté de l’appliquer à tous les films. « Il est des choses, avait écrit Rivette, qui doivent être abordées dans la crainte et le tremblement ; la mort en est une, sans doute; et comment, au moment de filmer une chose aussi mystérieuse, ne pas se sentir un imposteur ? » J’étais d’accord.
Et comme rares sont les films où l’on ne meurt pas, peu ou prou, nombreuses étaient les occasions de craindre et de trembler. Certains cinéastes, en effet, n’étaient pas des imposteurs. C’est ainsi que, toujours en 1959, la mort de Miyagi dans Les Contes de la lune vague me cloua, déchiré, sur un siège du studio Bertrand. Car Mizoguchi avait filmé la mort comme une fatalité vague dont on voyait bien qu’elle pouvait et ne pouvait pas ne pas se produire. On se souvient de la scène : dans la campagne japonaise, des voyageurs sont attaqués par des bandits affamés et l’un de ceux-ci transperce Miyagi d’un coup de lance. Mais il le fait presque par inadvertance, en titubant, mû par un reste de violence ou par un réflexe idiot. Cet évènement pose si peu pour la caméra que celle-ci est à deux doigts de « passer à côté » et je suis persuadé que tout spectateur des Contes de la lune vague est alors effleuré par la même idée folle et quasi superstitieuse : si le mouvement de la caméra n’avait pas été aussi lent, l’évènement se serait produit « hors champ » ou – qui sait ? – ne se serait pas produit du tout.
La faute à la caméra ? En dissociant celle-ci des gesticulations des acteurs, Mizoguchi procédait exactement à l’inverse de Kapo. Au lieu du coup d’œil enjoliveur de plus, un regard qui « fait semblant de ne rien voir » qui préférerait n’avoir rien vu et qui, de ce fait, montre l’évènement en train de se produire comme évènement, c’est-à-dire inéluctablement et de biais. Un évènement absurde et nul, absurde comme tout fait divers qui tourne mal et nul comme la guerre, calamité que Mizoguchi n’aima jamais. Un évènement qui ne nous concerne pas assez pour qu’on ne passe pas son chemin, honteux. Car je gage qu’à cet instant précis, tout spectateur des Contes … sait absolument ce qu’il en est de l’absurdité de la guerre. Qu’importe que le spectateur soit occidental, le film japonais et la guerre médiévale : il suffit de passer de l’acte de montrer du doigt à l’art de désigner du regard pour que ce savoir, aussi furtif qu’universel, le seul dont le cinéma soit capable, nous soit donné.
Optant si tôt pour le panoramique des Contes … contre le travelling de Kapo, je fais un choix dont je ne mesurerai la gravité que dix ans plus tard, dans le feu aussi radical que tardif de la politisation post-soixante-huitarde des Cahiers. Car si Pontecorvo, futur auteur de La Bataille d’Alger, est un cinéaste courageux dont je partage en gros les croyances politiques, Mizoguchi ne semble avoir vécu que pour son art et avoir été, politiquement, un opportuniste. Où est la différence, alors ? Dans « la crainte et le tremblement », justement. Mizoguchi a peur de la guerre parce qu’à la différence de son cadet Kurosawa, les petits bonshommes s’entre-tranchant des carotides sur fond de virilité féodale l’accablent. C’est de cette peur, envie de vomir et de fuir, que vient le panoramique hébété. C’est cette peur qui fait de ce moment un moment juste, c’est-à-dire partageable. Pontecorvo, lui, ne tremble ni ne craint : les camps ne le révoltent qu’idéologiquement. C’est pourquoi il s’inscrit « en rab » dans la scène sous les espèces gougnafières d’un travelling joli.
Le cinéma – je m’en rendais compte – oscillait le plus souvent entre ces deux pôles. Et chez des cinéastes autrement consistants que Pontecorvo, je butai plus d’une fois sur cette façon contrebandière – une sorte de pratique sainte-nitouche et généralisée du clin d’œil – de « rajouter » une beauté parasite ou une information complice à des scènes qui n’en pouvaient mais. C’est ainsi que le coup de vent qui rabat, tel un linceul, la blancheur d’un parachute sur un soldat mort du Merrill’s Marauders de Fuller me gêna pendant des années. Moins pourtant que les jupes relevées sur le cadavre d’Anna Magnani, fauchée par une rafale dans un épisode de Rome ville ouverte. Rossellini, lui aussi, frappait « au-dessous de la ceinture » mais d’une façon si nouvelle qu’il faudrait des années pour comprendre vers quel abîme elle nous menait. Où finit l’évènement ? Où est la cruauté ? Où commence l’obscénité et où finit la pornographie ? Je sentais bien qu’il s’agissait là, taraudantes, des questions inhérentes au cinéma d’« après les camps ». Cinéma que je me mis, pour moi seul et parce que j’avais son âge, à appeler « moderne ».
Ce cinéma moderne avait une caractéristique : il était cruel, et nous en avions une autre : nous acceptions cette cruauté. La cruauté était « du bon côté ». C’est elle qui disait non à l’« illustration» académique et qui ruinait le sentimentalisme faux-jeton d’un « humanisme » alors très bavard. La cruauté de Mizoguchi, par exemple, consistait à monter ensemble deux mouvements irréconciliables et à produire un sentiment déchirant de « non-assistance à personne en danger ». Sentiment moderne par excellence, précédant de quinze ans seulement les grands travellings impavides de Week-End. Sentiment archaïque aussi car cette cruauté était aussi vieille que le cinéma lui-même, comme un indice de ce qui était fondamentalement moderne en lui, du dernier plan des Lumières de la ville à L’Inconnu de Browning en passant par la fin de Nana. Comment oublier le lent travelling tremblé que lance le jeune Renoir au-devant de Nana sur son lit, agonisante et vérolée ? Comment a-t-on fait – s’insurgeaient les rats de cinémathèque que nous étions devenus – pour voir en Renoir un chantre de la vie béate, alors qu’il fut l’un des rares cinéastes capable, dès ses débuts, d’achever un personnage à coups de travelling ?
En fait, la cruauté était dans la logique de mon parcours du combattant Cahiers. André Bazin, qui en avait déjà fait la théorie, l’avait trouvée si étroitement liée à l’essence du cinéma qu’il en avait presque fait « sa chose », Bazin, ce saint laïc, aimait Louisiana Story parce qu’on y voyait un oiseau mangé par un crocodile en temps réel et en un seul plan : preuve par le cinéma et montage interdit. Choisir les Cahiers, c’était choisir le réalisme et, comme je finirais par le découvrir, un certain mépris pour l’imagination. Au « Tu veux regarder ? Eh bien, vois cela » de Lacan répondait par avance un « Cela a été enregistré ? Eh bien, je dois regarder ». Même et surtout quand « cela » était pénible, intolérable, ou carrément invisible.
Car ce réalisme était biface. Si c’est par le réalisme que les modernes montraient un monde rescapé, c’est par un tout autre réalisme – plutôt une « réalistique » – que les propagandes filmées des années 40 avaient collaboré au mensonge et préfiguré la mort. C’est pourquoi il était juste, malgré tout, d’appeler le premier des deux, né en Italie, « néo ». Impossible d’aimer « l’art du siècle » sans voir cet art travaillant à la folie du siècle et travaillé par elle. Contrairement au théâtre – crise et cure collectives -, le cinéma – information et deuil personnels – avait intimement à voir avec l’horreur dont il se relevait à peine. J’héritais d’un convalescent coupable, d’un enfant vieilli, d’une hypothèse ténue. Nous vieillirions ensemble, mais pas éternellement.
Héritier consciencieux, ciné-fils modèle, avec « le travelling de Kapo » comme grigri protecteur, je ne laissai pas filer les années sans une sourde appréhension : et si le grigri perdait son efficace ? Je me souviens, chargé de cours exploité de Censier-Paris-III, avoir photocopié le texte de Rivette, l’avoir distribué à mes élèves et leur avoir demandé leur sentiment. C’était une époque encore « rouge » où quelques élèves essayaient de grappiller à travers leurs enseignants un peu de la radicalité politique de 68. Il me sembla que, par égard pour moi, les plus motivés d’entre eux consentaient à voir dans « De l’abjection » un document historique intéressant mais déjà daté. Je ne leur en tins pas rigueur et si d’aventure je répétais l’expérience avec des étudiants d’aujourd’hui, je ne m’inquiéterais pas de savoir si c’est sur le travelling qu’ils butent, mais j’aurais à cœur de savoir s’il existe pour eux un indice quelconque d’abjection. Pour tout dire, j’aurais peur qu’il n’y en ait pas. Signe que non seulement les travellings n’ont plus rien à voir avec la morale, mais que le cinéma est trop affaibli pour héberger une telle question.
C’est que, trente ans après les projections répétées de Nuit et Brouillard au lycée Voltaire, les camps de concentration – qui m’avaient servi de scène primitive – ont cessé d’être figés dans le respect sacré où les maintenaient Resnais, Cayrol et beaucoup d’autres. Rendue aux historiens et aux curieux, la question des camps épouse désormais leurs travaux, leurs divergences et leurs folies. Le désir forclos qui revient « de façon hallucinatoire dans le réel » est évidemment celui qui n’aurait jamais dû revenir. Désir qu’il n’y ait pas eu de chambres à gaz, pas de solution finale et, à la limite, pas de camps : révisionnisme, faurissonnisme, négationnisme, sinistres et derniers -ismes. Ce n’est pas seulement du « travelling de Kapo » qu’un étudiant de cinéma hériterait aujourd’hui mais d’une transmission mal assurée, d’un tabou mal levé, bref d’un nouveau tour de piste dans l’histoire nulle de la tribalisation du même et de la phobie de l’autre. L’arrêt sur l’image a cessé d’opérer, la banalité du mal peut en animer de nouvelles, électroniques.
De la France récente, il sourd désormais assez de symptômes pour que, faisant retour sur ce qui lui a été donné de vivre comme Histoire, quelqu’un de ma génération ait à prendre conscience du paysage dans lequel il a grandi. Paysage tragique et, en même temps, confortable. Deux rêves politiques – l’américain et le communiste – balisés par Yalta. Derrière nous : un point de non-retour moral symbolisé par Auschwitz et le concept nouveau de « crime contre l’humanité ». Devant nous : cet impensable presque rassurant qu’est l’apocalypse nucléaire. Cela, qui vient de finir, a duré plus de quarante ans. J’appartiens en fait à la première génération pour qui racisme et anti-sémitisme étaient définitivement tombés dans les « poubelles de l’histoire ». La première – et la seule ? La seule, en tout cas, qui ne cria si facilement au loup du fascisme – « le fascismeu-ne-pass’ra-pas ! » – que parce qu’il semblait chose du passé, nulle et, une fois pour toutes, advenue. Erreur, bien sûr. Erreur qui n’empêcha pas de bien vivre ses « trente glorieuses », mais comme entre guillemets. Naïveté, bien sûr, et naïveté aussi de faire comme si, dans le champ dit esthétique, la nécrophilie élégante de Resnais tiendrait éternellement « à distance » toute intrusion indélicate.
« Pas de poésie après Auschwitz », déclara Adorno, puis il revint sur cette formule demeurée célèbre. « Pas de fiction après Resnais » aurais-je pu dire en écho, avant d’abandonner, moi aussi, cette idée un brin excessive. « Protégés » par l’onde de choc produite par la découverte des camps, avons-nous donc cru que l’humanité avait basculé – une seule fois, mais on ne l’y reprendrait plus – dans le non-humain ? Avons-nous vraiment fait le pari que, pour une fois, « le pire serait sûr » ? Avons-nous à ce point espéré que ce qu’on n’appelait pas encore la Shoah était l’évènement historique unique « grâce » auquel l’humanité entière « sortait » de l’histoire pour la surplomber un instant et y reconnaître, évitable, le pire visage de son possible destin ? Il semble que oui.
Mais si « unique » et « entier » étaient encore de trop et si l’humanité n’héritait pas de la Shoah comme de la métaphore de ce dont elle fut et reste capable, l’extermination des Juifs resterait une histoire juive, puis – par ordre décroissant de culpabilité, par métonymie – une histoire très allemande, pas mal française, arabe seulement par ricochet, très peu danoise et presque pas bulgare. C’est à la possibilité de la métaphore que répondait, au cinéma, l’impératif « moderne » de prononcer l’arrêt sur l’image et l’embargo sur la fiction. Histoire d’apprendre à raconter autrement une autre histoire dont l’ « espèce humaine » serait le seul personnage et la première anti-star. Histoire d’accoucher d’un autre cinéma, un cinéma « qui saurait » que rendre trop tôt l’évènement à la fiction, c’est lui ôter son unicité, parce que la fiction est cette liberté qui émiette et qui s’ouvre, par avance, à l’infini de la variante et à la séduction du mentir-vrai.
En 1989, me promenant pour Libération à Phnom Penh et dans la campagne cambodgienne, j’entrevis à quoi « ressemblait» un génocide – et même un auto-génocide – resté sans images et presque sans traces. La preuve que le cinéma n’était plus intimement lié à l’histoire des hommes, fût-ce sur son versant d’inhumanité, je la voyais ironiquement dans le fait qu’à la différence des bourreaux nazis qui avaient filmé leurs victimes, les Khmers rouges n’avaient laissé derrière eux que des photos et des charniers. Or, c’est dans la mesure où un autre génocide, comme le cambodgien, restait à la fois sans images et impuni que, par un effet de contagion rétroactif, la Shoah elle-même était rendue au règne du relatif. Retour de la métaphore bloquée à la métonymie active, de l’arrêt sur l’image à la viralité analogique. Cela est allé très vite : dès 1990, la « révolution roumaine » inculpait des tueurs indiscutables sous des chefs aussi frivoles que « détention illégale d’armes à feu et génocide ». Tout était donc à refaire? Oui, tout, mais cette fois-ci, c’est sans le cinéma. D’où le deuil.
Car nous avons, c’est indubitable, cru au cinéma. C’est-à-dire que nous avons tout fait pour ne pas y croire. C’est toute l’histoire des Cahiers post-68 et de leur impossible rejet du bazinisme. Bien sûr qu’il n’était pas question de « dormir dans le plan lit » ou de désoler Barthes en confondant le réel et le représenté. Nous étions évidemment trop savants pour ne pas inscrire la place du spectateur dans la concaténation signifiante ou pour ne pas repérer l’idéologie tenace sous la fausse neutralité de la technique. Nous étions même courageux, Pascal B. et moi, lorsque face à un amphithéâtre bondé de gauchistes rigolards, nous hurlions d’une voix brisée qu’un film ne « se voyait pas », qu’un film « se lisait ». Louables efforts pour être du côté des non-dupes. Louables et, pour ce qui est de moi, vains. Vient toujours le moment où il faut, malgré tout, payer son dû à la caisse de la croyance candide et oser croire à ce qu’on voit.
Certes, on n’est pas obligé de croire ce qu’on voit – c’est même dangereux – mais on n’est pas obligé non plus de tenir au cinéma. Il faut bien qu’il y ait du risque et de la vertu – bref, de la valeur – au fait de montrer quelque chose à quelqu’un capable de regarder ce quelque chose-là. A quoi cela servirait-il d’apprendre à « lire » le visuel et à « décoder » les messages si ne demeurait, minimale, la plus indéracinable des convictions : que voir est quand même supérieur à ne pas voir. Et que ce qui n’est pas vu « à temps » ne le sera plus jamais vraiment. Le cinéma est l’art du présent. Et si la nostalgie ne lui sied guère, c’est que la mélancolie est sa doublure instantanée.
Je me souviens de la véhémence avec laquelle je tins ce discours pour la première et la dernière fois. C’était à Téhéran, dans une école de cinéma. Face aux journalistes invités, Khemaïs K. et moi, il y avait des travées de garçons aux barbes naissantes et des travées de sacs noirs – sans doute des filles. Les garçons à gauche et les filles à droite, selon l’apartheid en vigueur là-bas. Les questions les plus intéressantes – celles des filles – nous parvenaient sous forme de petits papiers furtifs. Et c’est en les voyant si attentives et si stupidement voilées que je me laissai aller à une colère sans objet qui les visait moins, elles, que tous les gens de pouvoir pour qui le visible était d’abord ce qui devait être lu, c’est-à-dire soupçonné de trahison et réduit à l’aide d’un tchador ou d’une police des signes. Enhardi par l’étrangeté du moment et du lieu, je me livrai à un prêche en faveur du visuel pour un public voilé qui opinait du chef.
Colère tardive. Colère terminale. Car l’ère du soupçon est bel et bien finie. On ne soupçonne que là où une certaine idée de la vérité est en jeu. Plus rien de tel aujourd’hui, sinon chez les intégristes et les bigots, ceux qui cherchent des noises au Christ de Scorsese et à la Marie de Godard. Les images ne sont plus du côté de la vérité dialectique du « voir » et du « montrer », elles sont entièrement passées du côté de la promotion, de la publicité, c’est-à-dire du pouvoir. Il est donc trop tard pour ne pas commencer à travailler à ce qui reste, à savoir la légende posthume et dorée de ce que fut le cinéma. De ce qu’il fut et de ce qu’il aurait pu être. « Notre travail sera de montrer comment les individus, réunis en peuples dans le noir, faisaient brûler leur imaginaire pour réchauffer leur réel – c’était le cinéma muet. Et comment ils ont fini par laisser la flamme s’éteindre au rythme des conquêtes sociales, se contentant de l’entretenir à petit feu – et c’est le parlant, et la télévision dans un coin de la pièce. » Lorsqu’il se fixe ce programme -c’était hier, en 1989 – l’historien Godard pourrait ajouter : « Enfin seul ! »
Quant à moi, je me souviens du moment précis où je sus que l’axiome « travelling de Kapo » devrait être revisité, et révisé le concept maison de « cinéma moderne ». En 1979, la télévision française diffusa à son tour le feuilleton américain de Marvin Chomsky, Holocauste. Une boucle se bouclait, me renvoyant à toutes les cases départ. Car, si les Américains avaient permis à George Stevens de réaliser en 1945 l’étonnant documentaire cité plus haut, ils ne l’avaient, pour cause de guerre froide, jamais diffusé. Incapables de « traiter » cette histoire qui, après tout, n’était pas la leur, les entrepreneurs de spectacles américains l’avaient provisoirement abandonnée aux artistes européens. Mais ils avaient sur elle, comme sur toute histoire, un droit de préemption et tôt ou tard, la machine télé-hollywoodienne oserait raconter « notre » histoire. Elle le ferait avec tous les égards du monde mais elle ne pourrait pas ne pas nous la vendre comme une histoire américaine de plus. Holocauste serait donc le malheur qui arrive à une famille juive, qui la sépare et qui l’anéantit : il y aurait des figurants trop gras, des performances d’acteur, un humanisme à tout crin, des scènes d’action et du mélo. Et l’on compatirait.
C’est donc uniquement sous la forme du docudrame à l’américaine que cette histoire pourrait sortir des ciné-clubs et, via la télévision, concerner cette version asservie de l’ « humanité entière » qu’est le public de la mondovision. Certes, la simulation-Holocauste ne butait plus sur l’étrangeté d’une humanité capable de crime contre elle-même, mais elle demeurait obstinément incapable de faire resurgir de cette histoire les êtres singuliers que furent un à un, chacun avec une histoire, un visage et un nom, les Juifs exterminés. C’est d’ailleurs le dessin – celui du Spiegelman de Maus – qui oserait, plus tard, cet acte salutaire de re-singularisation. Le dessin, pas le cinéma, tant il est vrai que le cinéma américain déteste la singularité. Avec Holocauste, Marvin Chomsky faisait revenir, modeste et triomphal, notre ennemi esthétique de toujours : le bon gros poster sociologique, avec son casting bien étudié de spécimens souffrants et son son et lumière de portraits-robots animés. La preuve ? C’est vers cette époque que commencèrent à circuler – et à indigner – les écrits faurissoniens.
Il m’avait donc fallu vingt ans pour passer de mon « travelling de Kapo », à cet Holocauste irréprochable. J’avais pris mon temps. La « question » des camps, la question même de ma préhistoire, me serait encore et toujours posée, mais plus vraiment à travers le cinéma. Or, c’est par le cinéma que j’avais compris en quoi cette histoire me concernait, par quel bout elle me tenait et sous quelle forme – un léger travelling de trop – elle m’était apparue. Il faut être loyal envers le visage de ce qui, un jour, nous a transi. Et toute « forme » est un visage qui nous regarde. C’est pourquoi, je n’ai jamais cru – même si je les ai craints – ceux qui, dès le ciné-club du lycée, pourfendaient avec une voix pleine de condescendance ces pauvres fous – et folles – de « formalistes », coupables de préférer au « contenu », des films la jouissance personnelle de leur « forme ». Seul celui qui a buté assez tôt sur la violence formelle finira par savoir – mais il y faut une vie, la sienne – en quoi cette violence, aussi, a un « fond ». Et le moment viendra toujours assez tôt pour lui de mourir guéri, ayant troqué l’énigme des figures singulières de son histoire pour les banalités du « cinéma-reflet-de-la-société » et autres questions graves et nécessairement sans réponses. La forme est désir, le fond n’est que la toile quand nous n’y sommes plus.
C’est ce que je me disais en regardant, il y a quelques jours, un petit clip télé qui entrelaçait, langoureusement, des images de chanteurs tout à fait célèbres et d’enfants africains tout à fait faméliques. Les chanteurs riches – « We are the children, we are the world ! » – mêlaient leur image à celle des affamés. En fait, ils prenaient leur place, les remplaçaient, les effaçaient. Fondant et enchaînant stars et squelettes dans un clignotement figuratif où deux images essaient de n’en faire qu’une, le clip exécutait avec élégance cette communion électronique entre Nord et Sud. Voici donc, me dis-je, le visage actuel de l’abjection et la forme améliorée de mon travelling de Kapo. Ceux dont j’aimerais bien qu’elles dégoûtent ne serait-ce qu’un adolescent d’aujourd’hui ou qu’au moins elles lui fassent honte. Pas seulement honte d’être nourri et nanti, mais honte d’être considéré comme avoir à être esthétiquement séduit là où rien ne relève que de la conscience – même mauvaise – d’être un homme et rien de plus.
Et pourtant, finis-je par me dire, toute mon histoire est là. En 1961, un mouvement de caméra esthétisait un cadavre et, trente ans plus tard, un fondu enchaîné fait danser les mourants et les repus. Rien n’a changé. Ni moi, à jamais incapable de voir là-dedans le carnavalesque d’une danse de mort à la fois médiévale et ultramoderne. Ni les conceptions dominantes du chromo bien-pensant de la « beauté » consensuelle. La forme, elle, a un peu changé. Dans Kapo, il était encore possible d’en vouloir à Pontecorvo d’abolir à la légère une distance qu’il aurait fallu « garder ». Le travelling était immoral pour la bonne raison qu’il nous mettait, lui cinéaste et moi spectateur, là où nous n’étions pas. Là où moi, en tout cas, je ne pouvais ni ne voulais être. Parce qu’il me « déportait » de ma situation réelle de spectateur pris à témoin pour m’inclure de force dans le tableau. Or, quel sens pouvait avoir la formule de Godard, sinon qu’il ne faut jamais se mettre là où on n’est pas, ni parler à la place des autres.
Imaginant les gestes de Pontecorvo décidant du travelling et le mimant avec ses mains, je lui en veux d’autant plus qu’en 1961, un travelling représente encore des rails, des machinos, bref un effort physique. Mais, j’imagine moins facilement les gestes du responsable du fondu-enchaîné électronique de « We are the children ». Je le devine poussant des boutons sur une console, l’image au bout des doigts, définitivement coupé de ce – et de ceux – qu’elle représente, incapable de soupçonner qu’on puisse lui en vouloir d’être un esclave aux gestes automatiques. C’est qu’il appartient à un monde – la télévision – où l’altérité ayant à peu près disparu, il n’est plus de bonnes ni de mauvaises procédures quant à la manipulation de l’image. Celle-ci n’est plus jamais « image de l’autre » mais image parmi d’autres sur le marché des images de marque. Et ce monde qui ne me révolte plus, qui ne provoque en moi que lassitude et inquiétude, est très exactement le monde « sans le cinéma ». C’est-à-dire sans ce sentiment d’appartenance à l’humanité à travers un pays supplémentaire, appelé cinéma. Et le cinéma, je vois bien pourquoi je l’ai adopté : pour qu’il m’adopte en retour. Pour qu’il m’apprenne à toucher inlassablement du regard à quelle distance de moi commence l’autre.
Cette histoire, bien sûr, commence et finit par les camps parce qu’ils sont le cas-limite qui m’attendait au début de la vie et à la sortie de l’enfance. L’enfance, il m’aura fallu une vie pour la reconquérir. C’est pourquoi – message à Jean Louis S. – je finirai bien par voir Bambi.
*
*
Ce texte est le premier chapitre achevé d’un livre de Serge Daney sur son expérience du cinéma, commencé à l’automne 1990, et qu’il destinait à ce numéro de la revue Trafic.
Texte initialement paru dans la revue Trafic n°4, automne 1992