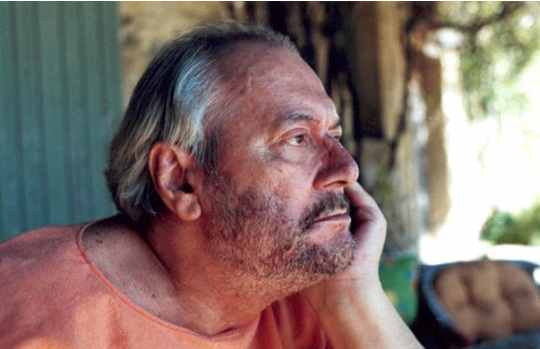
Il y a deux chemins dans le cinéma de Jean-Daniel Pollet, le documentaire et la fiction, mais il y a une seule île, le réel qui est l’autre nom du monde, et nous sommes enfermés dedans, pareils au pauvre Robinson. Tu imagines Robinson (1967) si l’on savait s’évader ce que nous pourrions faire : jouer, danser, rire et aussi être deux, un couple, ensemble. Mais on ne sait pas, aucun bateau ne viendra sur la mer maintenant déserte et on n’a pas appris à construire de radeaux. Comme redit Dieu sait quoi (1996), utilisant cette fois-ci les mots de Francis Ponge : « nous sommes les otages du monde muet ». Il y a une grande prison, la même pour tous. Ce n’est pas très difficile de faire la liste de tous les lieux d’enfermement qui ponctuent le cinéma de Pollet : le dancing de L’Acrobate (1976) où, chaque dimanche, Léon s’ennuie ; l’île de Spinalonga dans L’Ordre (1973) où sont parqués les lépreux ; la schizophrénie qui enserre le personnage du Horla (1966) ; le temple de Bassae (1964) isolé au milieu des montagnes ; la télévision de Dieu sait quoi où sont confinées les images des humains, tandis que dehors, dans le grand dehors, entre le soleil et la nuit, s’ébrouent le vent et les choses immobiles. Il faut remarquer aussi combien Pollet a mis à contribution la grammaire cinématographique pour signifier l’enfermement. La répétition, par exemple, est une de ses figures formelles privilégiées : il reprend les mêmes mouvements de caméra, les mêmes effets de montage. Il a un goût marqué pour les panoramiques ou les travellings circulaires qui peuvent se recommencer sans fin : tourner autour d’un tête de jeune fille, d’un temple en ruine, d’un taureau dans l’arène, d’une cruche en verre posée sur une table, c’est ne jamais se libérer, revenir au même comme un observateur fasciné et presque médusé. Autre retour du même, celui d’images identiques dans un film ou bien d’un film à l’autre. Il y a des morceaux de Bassae dans Méditerranée, de Méditerranée dans L’Ordre, des bouts d’un peu tout dans Contretemps et des bouts de Contretemps dans Dieu sait quoi. Cet éternel retour n’est pas du narcissisme d’auteur ; c’est simplement qu’on n’en sort pas. Qu’on ne peut pas. L’homme est condamné à la répétition. Sa seule liberté est de répéter, parce qu’obligé, la même chose, mais sur un autre ton, si possible.
Philippe Sollers dans Contretemps : « La damnation, c’est d’être obligé de se répéter, dans les limites d’un corps qui a été condamné à ne réitérer que le même geste ou la même pensée très limitée. Le paradis, en revanche, c’est la répétition mélodique ou musicale de la joie qu’il y a à se répéter, dans l’illimité. »
C’est le sens des deux chemins. Ils vont au même endroit, tournent en rond (la vie est une île) mais en passant par d’autres paysages. Le premier sentier est celui de la fiction des corps, ce qui leur arrive, ce qu’ils deviennent. Ce chemin-là est sans doute celui qui permet d’approcher au plus près du dangereux bonheur. Dans L’Acrobate, Léon court après une prostituée au nom symbolique de Fumée. Le premier court-métrage de Pollet, en 1958, s’intitulait Pourvu qu’on ait l’ivresse (ladite ivresse était déjà tristement volatile) et racontait, en moins développée, la même histoire que L’Acrobate (la répétition toujours). Si la joie est possible dans ces deux films, c’est qu’il y a la danse, l’exultation du corps, la grâce et la liberté des gestes. Sans doute, ces films-là valent-ils aussi par leur acteur, Claude Melki, pas du tout comédien à l’origine mais apprenti tailleur, que Pollet a repéré par hasard dans le dancing où il tournait les premiers plans de son premier court-métrage, après avoir abandonné ses études de philosophie. Melki est un corps burlesque, une sorte de Buster Keaton français, visage placide et lunaire, aux gestes timides de pantin désarticulé. L’Acrobate raconte l’histoire de cet homme empêché qui à l’aide de Fumée va apprendre à bouger autrement : corps fluide, gestes coulés, espace apprivoisé – et finalement, fera l’amour. Le bonheur c’est donc, chez Pollet, la sortie de la solitude, l’arrivée du deux, du couple, voire de la communauté comme l’indique Le Sang (1972), long-métrage qui rejoue l’utopie du Living Theater, compagnie théâtrale fondée en 1947 et vantant on s’en souvient la création collective, la libération des corps (les acteurs jouèrent nus) et la contre-culture. Seulement, on l’a dit, le bonheur est dangereux, l’utopie mortelle : Léon se noie dans la danse, comme Tobias dans Tu imagines Robinson se noie dans la mer, croyant y trouver la liberté. La leçon est donc terrible : l’évasion est une illusion mortelle. Le cinéma de Pollet n’a peut-être qu’une certitude, c’est celle-ci : il faut rester là, au milieu de la terre (le sens exact du mot méditerranée) et apprendre de cette immobilité, qui est celle des choses.
Raimondakis dans L’Ordre : « Nous avons cependant trouvé la cible et le but de la vie ici même, dans la fournaise de la maladie et de l’isolement. »
Apprendre par la puissance de la parole qui est le deuxième chemin, puisque le corps ne cesse de lâcher (le cinéaste est bien placé pour le savoir puisqu’il a collectionné, durant sa vie, les accidents) tandis que les mots, sans doute, retiennent encore un peu de sens pendant encore un peu de temps. Les mots pour le cinéaste résistent mieux à la mort que les hommes et les choses. Car les mots se ressourcent sans cesse à l’humus du logos pendant que les choses pourrissent, le visage de Raimondakis est mangé par le bacille de Hansen, les cruches se cassent, les herbes et les fleurs se dessèchent. Même les pierres du temple de Bassae s’effritent. Les films eux-mêmes semblent participer à ce programme immense et généralisé de ruine et d’effondrement. Montés à partir d’éléments hétérogènes, ils sont recomposés en un grand jeu de construction et de déconstruction : des images qu’un film met ensemble puis qui s’écrouleront et qu’un autre film rebâtira. Le titre Contretemps dit bien le coeur du projet polletien : lutter contre le temps par des effets de mélodie et de structure.
Ezra Pound : « Par usure n’ont les hommes maison de pierre saine/ (…) les hommes n’ont plus site pour leur demeure. »
Si les ruines du temple de Bassae ont tant intéressé Pollet, c’est, dit-il, parce que ce fut le dernier ouvrage signé Ictinos, l’architecte du Parthénon : un dernier petit temple, enfoui dans les montagnes, bâti non de marbre mais des pierres du coin, construit pour soi seul à la fin d’une vie glorieuse, comme une sorte d’adresse personnelle aux dieux et à la mort. Maintenant Ictinos est mort depuis longtemps, et ses dieux aussi, mais pas la langue comme se souvient Pollet : « La langue grecque, le chant de la langue grecque ; là dans le village ; une petite fontaine, enfin, j’ai vu ça. » Afin de « traverser la mort », Pollet n’a jamais craint de recourir à la langue et de faire ce qu’on peut appeler un cinéma littéraire, non pas un cinéma aux dialogues écrits (genre mots d’auteur et tutti quanti) mais un cinéma qui a l’ambition précise de filmer les mots, de donner corps à ces signes impalpables, de trouver des images qui soient l’équivalent précis des phrases. En 1964, par exemple, il propose un essai d’écriture en images, L’oeil de verre, à partir de textes de Georges Bataille et d’Ezra Pound. En 1963, déjà, il fait appel à Philippe Sollers – son exact contemporain, ils sont nés tous les deux en 1936 – pour écrire un texte pour le documentaire Méditerranée. Filmer le mot est une obsession qui ne quittera jamais le cinéaste. En 1996, il réalise Dieu sait quoi à partir de et en hommage à Francis Ponge, l’auteur du Parti pris des choses très attaché on le sait à un précis compte tenu des mots. Son idée première, ainsi qu’il le raconte dans un entretien aux Cahiers du cinéma, avait été d’adapter les textes de Ponge par « pléonasme dépassé. Coller exactement les images sur les mots ». On parle d’un galet, d’un savon, d’un escargot et on voit un galet, un savon, un escargot. Puis cela se compliquera finalement avec décalage, remontage du texte original, reprise, et répétition, comme toujours chez lui. Répéter, revenir de parmi les morts, recommencer, encore re-chanter, c’est cela qu’essaya aussi Orphée, le premier poète.
Texte initialement publié dans le catalogue du Festival International du Film de La Rochelle 2001






