
1. Jour après jour
film de Jean-Daniel Pollet réalisé par Jean-Paul Fargier, 2007


Il habite le monde comme sa maison : immobile.
Un grave accident l’a cloué là, en ce point du monde : une maison au milieu d’un grand jardin.
Il ne peut plus parcourir le monde : il le contemple jour après jour depuis sa maison.
Il est cinéaste. Il n’a vécu que pour faire des films.
Toujours un de plus : envers et contre toutes les circonstances.
Il imagine faire un film avec toutes ses images fixes,
se ranimant par conjonction, juxtaposition, succession.
Il en isolerait, dans le lot innombrable, ce qu’il en faut pour voir une année s’écouler,
quatre saisons, jour après jour.
JOUR APRES JOUR serait le titre. Le programme. Le seul scénario.
Une année s’y écoulera –
Une toute petite année parmi les milliards d’années du monde.
Une vie s’y imprimera-
Une petite vie parmi les milliards de vies du monde.
La maison, le monde.
La maison… le monde.
La maison : le monde.
Il vit dans le suspens de cette conjonction – déplaçant au gré de son humeur la ponctuation qui lie dans son esprit les lieux où il réside.
Il habite le monde comme sa maison : immobile.
Un grave accident l’a cloué là, en ce point du monde :
une maison au milieu d’un grand jardin.
Il ne peut plus parcourir le monde : il le contemple jour après jour depuis sa maison.
Il habite le monde comme une maison, il habite sa maison comme un monde.
Il prend des photos : de sa maison ; du monde.
Une dizaine chaque jour, nuit comprise.
Toujours les mêmes sujets – mais pas les mêmes lumières,
les mêmes couleurs, pas les mêmes températures.
Un thermomètre est le héros discret de ces variations.
Et ces vues fixes produisent un miracle : le mouvement qui se retire d’elles se
communique à lui. Il va et vient dans le monde ? Il bouge chaque fois qu’il colle son
oeil au viseur, chaque fois qu’il appuie sur le déclencheur.
Chaque clic clac le meut sans limite dans sa maison comme dans le monde , dans le
monde comme dans sa maison, hors de sa maison, hors du monde.
ET au miracle s’ajoute un prodige : quand il revoit ses images, qu’il les trie, qu’il
commence à les assembler : le mouvement se ranime en elles, entre elles. Elles sont
devenues le monde. Le monde qu’il habite, lui, et comme il l’habite, jour après jour.
Il est cinéaste. Il n’a vécu que pour faire des films.
Toujours un de plus : envers et contre toutes les circonstances.
Il imagine faire un film avec toutes ses images fixes, se ranimant par conjonction,
juxtaposition, succession.
Il en isolerait, dans le lot innombrable, ce qu’il en faut pour voir une année s’écouler,
quatre saisons, jour après jour.
JOUR APRES JOUR serait le titre. Le programme. Le seul scénario.
Jean-Daniel Pollet – Cadenet – Vaucluse.
2.
» Là, peut-être, j’ai senti la mort de plus près, je ne pouvais pas m’exprimer. J’étouffais littéralement. Imaginez qu’on vous mette un garrot autour de la gorge et qu’on serre et qu’on serre et je ne pouvais pas dire : » Détachez-moi. » C’est exactement ça. Cela n’a pas duré deux heures, ou vingt heures, c’était peut-être une minute. Infernal, c’était pire encore que la douleur d’avant ; tout à coup, ils me sortent un truc de la bouche, et l’air rentre. Alors là, l’extase, l’enivrement, le plaisir, la jouissance, tout ce qu’on veut. J’ai vu ce que c’était de tout simplement respirer un bon bol d’air. Toutes ces sensations-là.
Comme si j’étais au sommet de l’Everest et que je m’étais bouché le nez, pendant dix minutes, que j’avais retenu ma respiration jusqu’au bout et même plus encore, et que j’ouvrais les narines. Première bouffée d’air. Je m’en souviendrai toute ma vie. »
Jean-Daniel Pollet, L’entrevues, Editions de l’œil, 1998
3.
» Il y a deux cinémas : le cinéma qui propose l’oubli et celui qui propose au
spectateur ce qu’il est. Il y a une définition des films qui peut être faite à travers
l’attitude proposée au spectateur.
C’est très important, parce que, dans cette civilisation où les gens vivent toute la
semaine dans un mécanisme de vie plutôt que la vie elle-même, c’est-à-dire emportés par un mouvement qui leur est extérieur, si on leur propose, à la fin de la semaine, d’aller passer deux heures dans une salle pour entrer dans quelque chose qui n’est pas eux-mêmes non plus, si on leur propose de vivre par procuration à travers d’autres personnages et vivre ailleurs que dans la salle où ils sont… C’est la fuite… »
Jean-Daniel Pollet, L’entrevues
4.

« Notre histoire est une histoire invisible. Je vous ai invité ici, nous sommes dans
une maison et à la fois dans un film. On ne nous voit à aucun moment, pas même
nos ombres, comme si au cinéma nous étions à la fois dans la salle et sur l’écran. Nulle part. Comme dans les rêves. A quoi travaillons-nous ? Nous passons entre les images et les sons. Une histoire de fantôme. »
Texte de Jean Thibaudeau dit dans le film Dieu sait quoi de Jean-Daniel Pollet, 1995
5.
» Pour moi l’idée de prendre le spectateur par la main et de ne pas le lâcher est
intolérable. Je veux donner au spectateur la liberté de se projeter dans le film, et
laisser place à son imaginaire. »
Jean-Daniel Pollet, L’entrevues
6.
« Dans cette banale série d’images en 16 mm, c’est à nous maintenant de savoir retrouver l’espace que seul le cinéma sait transformer en temps perdu… ou plutôt le contraire… car voici des plans lisses et ronds abandonnés sur l’écran comme un galet sur le rivage… puis comme une vague, chaque « colure » vient y imprimer ou effacer le mot souvenir, le mot bonheur, le mot femme, le mot ciel… la mort aussi puisque Pollet, plus courageux qu’Orphée, s’est retourné plusieurs fois
sur cette « Angel Face » dans l’hôpital de je ne sais quel « Damas ». »
Jean-Luc Godard, à propos du film Méditerranée de Jean-Daniel Pollet, in Cahiers du cinéma n°187, février 1967
7.
» Mon seul principe pour le tournage de Méditerranée était de ne filmer qu’une seule chose par plan. Trouver des images-signes, des images-mots. Un plan signe est radicalement différent, dans son essence même, d’un plan où grouillent une dizaine de personnes. C’est au prix d’une grande austérité que j’ai pu faire fonctionner un film comme Méditerranée, et plus tard Contretemps et Dieu sait quoi, et pouvoir à nouveau affirmer cette liberté. »
Jean-Daniel Pollet, L’entrevues
8.
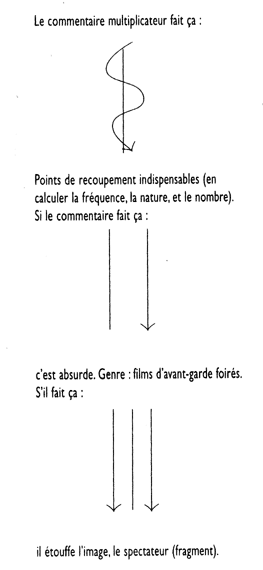
Jean-Daniel Pollet, L’entrevues
9.
« Dans un film classique, Belmondo sort d’une voiture, entre dans un restaurant, va au téléphone. On le suit. Ce n’est pas du montage, même s’il y a des raccords, plusieurs plans : on se contente de le suivre, d’un plan à l’autre. L’ellipse – on coupe un peu dans le temps et le spectateur est censé comprendre ce qu’on a coupé – ce n’est pas encore vraiment du montage, il faut couper encore plus – qu’on ne sache pas pourquoi on passe d’un plan à l’autre. Alors on obtient une certaine logique, la poésie. »
» Pour moi ce langage coule de source : là, vive le montage et le mécanisme des rêves imbibés d’inconscient !… vive le montage le soir juste avec de s’endormir. Un montage éclairant comme pour les rêves, où il n’y a d’autre logique que celle de l’inconscient. Une logique qui soit celle du bonheur ou celle de la souffrance. »
Jean-Daniel Pollet, L’entrevues
10.
Visions
Pensée
Sensations
Couleurs
Visions mentales simultanées
Jean-Daniel Pollet, L’entrevues
11.
« On voulait donc faire du cinéma qui n’en serait pas, qui serait de la métaphysique en somme. On voulait faire de la métaphysique avec quelque chose qui ressemble à du silence. Autrement dit, on se foutait complètement du marché, des bobines, de la nouvelle vague, tout ça. On allait faire autre chose. Pourquoi ? Pour l’expérience de ce qui est montré dans une image avec mouvement. Avec l’influence du fait qu’on peut aller de gauche à droite, de droite à gauche, en profondeur, dessiner une sorte de cube qui serait en même temps une sphère en lévitation et qui rassemblerait toute l’histoire de la civilisation occidentale dans sa périphérie méditerranéenne… C’est un projet extraordinairement ambitieux, mais qui a commencé très concrètement de la manière suivante. Un beau jour Pollet vient me voir et me dit : Voilà, j’ai filmé un certain nombre de choses, je commence à les monter, mais je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Peut-être, après tout, pourrait-on dire qu’une fille a eu un accident d’avion, qu’elle est à l’hôpital et qu’elle pense à ses vacances. Elle a rencontré une jeune grecque, elle aurait fait un voyage touristique et, brusquement, elle se retrouve en train de mourir à l’hôpital. Mais on a essayé de monter la chose selon un projet géométral : ce que c’est qu’aller de droite à gauche, en profondeur, d’entrer dans un blockhaus, dans des ruines, passer dans un bal, être dans un lit d’hôpital. On voulait construire, sur le terrain de la pensée la plus radicale, quelque chose qui soit géométral et métaphysique.
../..
Le montage, le collage, le détournement, la dialectique du montage est la chose, évidemment principale du fait de Pollet, mais j’étais là tout de même. Et qu’est-ce qu’il y a de plus passionnant que de travailler à un montage ? À savoir, on s’interrompt là, et puis on reprend à un point précis. Méditerranée est un film qui, je crois, peut être étudié dans l’histoire du cinéma au milieu de tous les grands du montage. Et ca valait la peine de rentrer dans cette intériorité qui consiste à savoir où on s’arrête, où on reprend avec autre chose et pourquoi on va aller, dans une contradiction apparente, vers des transversales logiques. Comment, à l’intérieur même des éléments nous allons passer d’une chose à une autre, par exemple, vous l’avez remarqué sûrement, d’un fil de fer barbelé à une épingle à cheveux dans la bouche, ou bien autre chose encore. Nous allons agir ici sur les éléments, puisque nous sommes sur la magie. Jean-Daniel avait filmé une fille dans un hôpital en état d’anesthésie. Vient-elle d’être opérée ? Vient-elle de naître ? Va-t-elle mourir ? On peut peut-être signaler au passage que cette femme est morte très peu de temps après le film dans un accident. Nous sommes dans les correspondances. Qu’est-ce que peut faire le cinéma avec les correspondances, avec les parfums, avec le goût ? Comment nous faire sentir ce que c’est qu’une orange ? On peut la représenter plusieurs fois comme, je ne sais pas, le fruit interdit, le fruit du paradis. On ne peut pas vous faire respirer, ni vous faire goûter, mais tout de même, avec les mots, la couleur, les plans, l’extrême précision des plans, les petits mouvements autour de ce qui est filmé, peut-être peut-on déclencher chez-vous spectateur, une salivation, une sorte d’odeur, des souvenirs. Alors, par exemple, les éléments c’est le feu avec le haut-fourneau qui est là, l’eau, la terre et le sang sur ce taureau méditerranéen qui n’en finit pas de saigner et de mourir, d’un moment sur l’autre. La magie, c’est très simple dans les époques de renaissance, nous en sommes loin. Mais nous faisons de la magie avec le cinéma et, par exemple, cela revient à dire que le livre du monde se dévoile comme une suite, une fuite, de plans qui se correspondent mais qui sont écrits en différentes langues que le mage, le cinéaste si vous voulez, peut déchiffrer et maîtriser dans la mesure où il réussit à comprendre que le langage fuit. Vous avez donc un effort du cinéma pour aller vers le fait que jamais on ne pourra filmer assez ni la nature, ni la sculpture, ni l’architecture, ni finalement le fond des choses. Le mage est celui qui sait lire le monde à livre ouvert, ou alors, faire de la magie n’est rien d’autre que marier le monde. Ce qui veut dire rapprocher des éléments qui n’ont pas l’air de pouvoir aller ensemble. Là, vous avez en effet dans ce film un mariage du monde, du fait de Jean-Daniel qui avait filmé uniquement ce qui le fascinait. Moi j’étais là pour mettre ça avec lui en ordre et orchestrer la chose. »
Propos de Philippe Sollers sur sa collaboration avec Jean-Daniel Pollet lors du film Méditerranée. Propos retranscrits par Hélène Raymond. Lire le compte rendu entier sur fluctuat.net (2001)
12. Pour mémoire
film de Jean-Daniel Pollet, 1978



13. Dieu sait quoi
film de Jean-Daniel Pollet, 1995
La répétition.
En quoi l’idée de répétition est-elle intéressante
? Sollers dirait : nous sommes
une répétition. Notre liberté est celle de
ces «cartes battues et rebattues» dont il
parle dans son texte pour
Méditerranée. Nous sommes tous
dans la répétition. Mais il y a répétition
mélodique, harmonieuse, ou bien répétition
dantesque; infernale. Il y a là une
petite frange de liberté, qui tient à la
façon dont j’endosse cet effet de répétition.
Par exemple, je me réveille, je
m’habille, je suis bien dans ma peau,
tout va bien, je ne sais pas pourquoi :
ça, c’est la répétition mélodique. Mais
la répétition infernale, c’est : j’ai été
tabassé dans mes rêves pendant cette
nuit-là, et la journée va se passer à
répéter tous les gestes que je n’aurais
pas faits pour me défendre… Et puis il y
a ce moment privilégié où cesse la répétition.
Oui, et ça je le vis quotidiennement.
Ici, vers cinq heures, le temps
s’arrête. Il n’y a plus de répétition, ni
harmonique, ni infernale. Il y a le plat
absolu pendant que le soleil se couche.
Ce plat descend, descend, descend. Et
ça dure une demi-heure. Je suis presque
chaque soir sous la tonnelle pour assister
à ça. Ce truc qui nous est donné par
qui ? J’ai toujours essayé, avec plus ou
moins de bonheur, de retrouver cet état
pour tourner. En vérité, j’aime ou le
clair-obscur ou le pastel quand le soleil
se couche. Disons que, pour un instant,
il y a un calme, un apaisement, quel que
soit mon «compte en banque». Je ne
pense plus à cette heure-là à mon
«compte en banque», il n’y a plus de
destinée. Il y a quelqu’un qui parle, qui
ne parle pas, qui est là…
Le monde muet.
«Hommes, animaux à paroles, nous
sommes les otages du monde muet.»
Voilà une très belle évidence, clef de
voûte de toute l’oeuvre de Francis Ponge.
Comment j’ai découvert Ponge ? Après
mon accident, j’ai passé quelques mois
à l’hôpital à ne rien pouvoir faire d’autre
que lire. Françoise m’avait apporté Le
parti pris des choses, que j’avais lu il y a
longtemps. Je me suis jeté sur l’oeuvre
entière de Ponge, sans penser d’emblée
à une quelconque adaptation cinématographique.
C’était un parcours de santé.
J’ai donc réabsorbé Ponge, avec volupté,
entre deux piqûres. Ce n’est pas moi
qui l’ai pris : il m’a happé. Je n’ai pas
été happé comme avec la locomotive :
ça c’est le choc frontal, violent. Non.
J’ai été pris insidieusement, tranquillement.
Ponge ne refuse pas, malgré son
parti pris des choses, la communication
avec les autres. Ponge était très entouré.
Il parlait souvent avec Picasso,
Fautrier, Dubuffet, Giacometti et
d’autres. Mais à l’heure où le monde est
si vaste et si proche à la fois, du fait du
développement des communications, il
ne se sent pas capable d’affronter cette
multitude d’informations. Il n’opte pas
pour les choses contre les gens. Il fait
des poèmes, il disait plutôt proêmes,
pour se démarquer de la poésie strictement
liée aux émotions. Ponge travaille
par sédimentation. Il écrit par exemple
sur une durée de vingt ans à propos de
la table, en peaufinant non pas le sens,
mais l’approche de la table. Ponge a
toujours su intégrer le temps dans son
oeuvre. Il a d’ailleurs laissé tout ce qu’il
avait écrit derrière lui : il y a dix versions
du Lézard, rien n’a été coupé. Il disait :
«même si je me trompe, tout doit être
publié». Qui oserait cela au cinéma ? Le
Savon s’est fait sur dix ans ! Je vois là
une attitude exemplaire ! J’ai mis moi
aussi beaucoup de temps à «m’approprier
» Ponge. Je me suis mis à l’écoute,
puis ai commencé à penser à un film
d’après son oeuvre. Entreprise ardue,
mais pour une fois j’avais vraiment le
temps, coincé dans mon lit. Je n’arrivais
pas à trouver de mesure pour une oeuvre
si inusuelle. Pour la première approche
du scénario, j’ai pensé qu’il y avait une
solution, celle de pratiquer le «pléonasme
dépassé». Coller exactement les
images sur les mots. Multiplier les
choses par les mots et par leur contiguïté
avec d’autres choses. L’exponentialité.
Oui. Le pléonasme développait cette
jouissance propre à la répétition. Il y
avait là-dedans une ivresse de derviche
tourneur. Il a fallu un certain temps pour
que je me rende compte des limites de
cette attitude, trop absolue. Il en reste
quelques traces dans le film. (…)
Dieu.
Je dirais que je n’ose pas faire ou que je
ne veux pas faire le pari de Pascal :
«Tant qu‘à faire, mieux vaut miser sur la
croyance en Dieu». Mais je sens aussi
quelque part un Dieu quand je vois à la
télévision une fusée décoller. Il y a une
telle accélération de l’Histoire ! on peut
imaginer que d’ici cent ans, deux cents
ans, la liste exponentielle des découvertes
va être infinie. Même si une théorie
du chaos vient troubler tout ça. Si le
progrès semble exponentiel, la question
du bien et du mal reste posée. Le mal
serait, selon Georges Bataille, la part
maudite. C’est une quantité qui est assignable
à tout le monde et qui arrive au
monde. Chacun vient au monde avec un
capital mal et un capital bien. Si le mal
ne s’exprime pas, il attend. Bataille
disait que les temps de paix contiennent
un mal qui doit s’exprimer un jour ou
l’autre, d’autant plus violemment que le
temps de paix a été long. Mais il y a
aussi un état d’attente, qui est en
revanche pour moi le souverain bien.
Raimondakis, le porte-parole des
lépreux que j’ai filmé dans L’ordre,
incarne parfaitement le bien. Il était
dans cette île où il n’y avait aucun frottement
avec l’extérieur. Là, on ne voit
pas le mal, on ne voit que l’amour qui,
d’une certaine façon, se trouve par delà
le bien et le mal. De même Dieu, dans
Dieu sait quoi, ne correspond ni à un
appel, ni au pari de Pascal. Dieu sait
quoi est aussi un film au-delà du bien et
du mal, où Dieu est une hypothèse de
travail, un peu dans le sens où Matisse
disait : «je crois en Dieu quand je travaille
». A mesure que nos forces
s’amoindrissent, et que l’échéance est
proche, peuvent apparaître toutes sortes
de transcendance qui sont latentes dans
notre corps et notre esprit même. Et qui
ne sont pas ailleurs. Depuis mon accident,
je voisine un peu avec cette transcendance.
Assez joyeusement parce que
j’ai été comme miraculé. Je jouais avec
l’oeuvre de Ponge, en voulant distribuer
autour de moi la joie que me procurait
sans cesse la lecture du poète. C’est
pourquoi un jour j’ai écrit pour m’amuser
: «je ponge, tu ponges, il ponge, nous
pongeons, vous pouvez, ils pongent». Si
Dieu se trouve quelque part dans
l’oeuvre de Ponge ce serait dans les articulations
de son langage, et je peux en
revenir au montage : un plus un égale
trois ou même quatre si tout va bien.
Dans Dieu sait quoi, Dieu peut se deviner
dans le minuscule intervalle séparant
deux images. Il est dans le raccord.
(…)
Propos de Jean-Daniel Pollet recueillis et mis en forme par Laurent Roth
Cahiers du Cinéma n°509 – Janvier 1997
14.
« La damnation, c’est d’être obligé de se répéter, dans les limites d’un corps qui a été condamné à ne réitérer que le même geste ou la même pensée très limitée. Le paradis, en revanche, c’est la répétition mélodique ou musicale de la joie qu’il y a à se répéter, dans l’illimité. »
Philippe Sollers dans Contretemps (1988)
15. Dieu sait qui
film de Pierre Borker, 2006
Jean-Daniel Pollet (1936-2004) a laissé une œuvre cinématographique derrière laquelle il s’est efforcé de s’effacer. Ce film est donc une variation autour d’un corps absent, une promenade subjective qui convoque les témoignages de collaborateurs, des souvenirs anecdotiques, des errances dans des lieux dont il aurait tiré matière. C’est aussi l’occasion de s’interroger sur la « méthode » Pollet , un mystère dont il est peu sûr que « Dieu Sait Qui » dévoile toutes les arcanes.
Voix off du film
Voix-off enfant : Jean-Daniel Pollet est mort le 9 septembre 2004 à Cadenet dans le Vaucluse. Depuis plusieurs années, il ne quittait plus sa maison qui était devenu l’épicentre de sa création artistique, choisissant ses lieux de tournage toujours plus près…
Voix-off : Par où commencer ? Peut-être par son avant-dernière demeure terrestre où j’ai travaillé avec lui pendant près de trois ans.
Quelques années plus tard, j’ai eu l’idée de ce film et je lui en ai parlé.
J’ai à la fois reçu cette lettre et une injonction. « Je ne veux pas apparaître physiquement à l’image », me disait-il.
Cela m’apparut cohérent avec son attitude qui -me semble-t-il- a toujours été de s’effacer derrière son travail. Combien de festivals, d’hommages dont les organisateurs ont espéré en vain qu’il vienne les illustrer de sa présence.
En tous cas, pour être sûr que je tiendrai parole, il s’est arrangé pour disparaître.
Voix-off : Par où commencer ? Par ce cinéma où il y a 25 ans, j’avais préparé une rétrospective de ses films. Voilà ce qu’il en reste.
Voix-off : Par où commencer ? Par ce vieux restaurant grec où il avait ses habitudes et où il m’avait fixé rendez-vous pour me jauger, moi qui le rencontrait pour la première fois.
Je venais parler de ses copies dispersées un peu partout et il m’étudiait pour savoir comment je résistais à l’ingestion de deux bouteilles de retsiné.
Voilà ce qu’il en reste.
Voix-off : Par où commencer ? Les souvenirs sont souvent trompeurs. Pour cette première rencontre, je ne possédais que cette photographie.
Et bien évidemment, il n’y ressemblait pas du tout.
Voix-off : Par où commencer avec ce corps absent ? En allant à la rencontre des témoins.
Comme l’acteur Laurent Terzieff, par exemple, impeccable interprète du Horla en 1966. Voilà ce qu’il m’écrit :
« Pardon de vous répondre si tard. Hélas, je n’ai aucun souvenir signifiant de ce tournage qui pourrait vous intéresser. J’ai passé un très bon moment avec lui, à Noirmoutier. Je l’aimais beaucoup. »
Voix-off : Bon. Il va falloir faire avec.
Voix-off : Par où commencer ? Peut-être par le début. En 1957, le jeune homme de 21 ans réalise un film pendant son service militaire. Un regard sans dialogues sur les stratégies de séduction dans un bal populaire.
C’est dans ce décor qu’il va découvrir un jeune tailleur, Claude Melki, qui sera un peu ce que Jean-Pierre Léaud fut pour François Truffaut : un grand acteur, en tous cas, qui vaut tout de suite à « Pourvu qu’on ait l’ivresse » une série de prix internationaux.
Voix-off : Comment commencer ? Dans sa maison du midi où a débuté notre collaboration.
Je m’avance, il m’accueille assis sur sa terrasse car il a du mal à se déplacer. Je pose mes bagages; je pénètre dans la maison.
Voix-off : C’est la seule personne que je connu capable de parler travail en continu.
Un être qui n’est que travail. Parfois, lors des repas, quelques anecdotes lui échappent. Puis ça repart, fluide, soutenu, inlassable, sans effort apparent.
Voix-off : Comment faisait-il ? //
Ça se déroule dans la plus petite pièce de sa grande maison. Il appelle ça « la grotte ». Il y a installé son lit et hiver comme été, j’alimente un feu d’enfer dans la cheminée. //
Quand les scènes sont un peu développées, elles deviennent des carrés de papier épinglés sur un tableau de liège. On les déplace à notre gré.
Voix-off : C’est de ce réduit qu’il conçoit le monde en un mouvement centrifuge. Un petit endroit pour une grande ouverture vers l’extérieur.
Voix-off : Comment faisait-il ? Comment faisait-il pour trouver un paysage ?
Bien sûr, il y avait la Grèce à laquelle il a consacré plusieurs films. Un endroit où il se sentait chez lui.
Sur ce scénario, nous avons travaillé au moins un an. Refusé partout. //
Il y avait quatre personnages : une femme, deux hommes et le paysage. Ou plutôt les paysages. Nous partions les repérer dans un rayon de 100 Km autour de chez lui. // Il lui fallait des lieux non-pollués, disait-il, c’est à dire dépouillés des signes du progrès technique : pylônes, fils électriques, voitures, etc. On en a trouvé quelques uns aux alentours.
Voix-off : Qu’en aurait-il fait ?
Voix-off : Qu’en aurait-il fait ?
Voix-off : Qu’en aurait-il fait ? // Et qu’aurait-il fait par ailleurs de ces autres lieux,
à l’opposé de ses goûts profonds, que je lui avait suggéré comme contrepoint ?
Voix-off : Comment faisait-il ? Comment faisait-il pour filmer un paysage ou un objet ?
JEAN-PIERRE BRAZS : Tout est fondé sur un dispositif ; Finalement, et j’ai trouvé des échos avec mon propre travail, c’est l’idée qu’on est au monde, on est entouré de choses, d’objets, de paysages, et que tout ça n’a rien à nous dire. Et que finalement, la solution pour s’en sortir de cette histoire, c’est à dire ce que signifie « être au monde », c’est de créer des dispositifs pour voir. C’est pas de montrer, d’expliquer, c’est de créer des dispositifs pour voir. Il y a dans ce film deux dispositifs majeurs : une table, des objets posés sur la table et autour, le monde, c’est à dire le paysage. Et à partir de ce dispositif très simple, il y a deux moments importants pour moi. Celui où la caméra, c’est à dire le regard, tourne entre l’objet et le paysage. Du coup, on fait le tour de l’objet et en même temps, on a le paysage qui tourne. Et ensuite, il y a une autre façon de procéder, c’est le fait de faire tourner l’objet – pas n’importe quel objet, un objet en verre – dans lequel le paysage se reflète. Et dans ce cas-là, c’est l’objet qui tourne, mais le paysage reste fixe. Et pour moi, il y a là deux façons de se situer On retrouve du coup cette idée d’un agencement des choses lié à un déplacement. Et finalement, le regard se situe dans une tension entre les deux. En fait, un dispositif de base, ce serait cela : agencer des objets pour mieux se rendre compte de la qualité de la tombée du jour, ou de la qualité de l’apparition de la lumière naturelle le matin.
Voix-off : Comment faisait-il ?
Voix-off : Ce dispositif pour voir, c’est peut-être utiliser la méthode du poète Francis Ponge : l’art du polissage.
Voix-off : Comme les peintres, aller sur le motif, moderne ou ancien, se colleter avec lui, constamment y revenir, sous tous les angles, l’effleurer, tourner autour, chercher la bonne distance.
Voix-off : Et la bonne distance, ce n’est pas seulement avancer ou frôler ; c’est aussi souvent prendre du recul. Un recul envoûtant, un recul sonore.
Voix-off : Comment faisait-il ? Je lui avais posé la question et bien évidemment, il n’avait rien à répondre. Pourtant, un jour, il me parla du rayon vert.
Un moment magique, selon lui, où la lumière revêt une apparence particulière.
Voix-off : Moi, immédiatement, je me suis souvenu de quelque chose.
« Le soleil s’abaissait déjà avec la rapidité qui semble l’animer aux approches de la mer. A la surface des eaux, tremblotait une large traînée d’argent, lancée par le disque dont l’irradiation était encore insoutenable.
Bientôt, de cette nuance de vieil or qu’il prenait en tombant, il passait à l’or cerise. Devant les yeux, lorsqu’on les voilait de leurs paupières, miroitaient des losanges rouges, des cercles jaunes, qui s’entrecroisaient comme les fugitives couleurs du kaléidoscope.
De légères stries ondulées rayaient cette sorte de queue de comète que la réverbération traçait à la surface des eaux. C’était comme un floconnement de paillettes argentées dont l’éclat pâlissait en s’approchant du rivage.
De nuage, de brume, de vapeur, si ténue qu’elle fut, il n’y avait pas l’apparence sur tout le périmètre de l’horizon. Rien ne troublait la netteté de cette ligne circulaire qu’un compas n’eut pas tracé plus finement sur la blancheur d’un vélin. »(Jules Verne)
Voix-off : Je pensais partager avec lui un secret, d’autant que dans l’un de mes films, quelque chose s’était produit.
Mais un de ses opérateurs s’est chargé de me démontrer que je faisais fausse route dans mon interprétation.
Yann Le Masson : Jean-Daniel me laissait toute liberté de décider de la lumière et du cadre. On travaillait après le coucher du soleil, dans cette lumière particulière qui est celle du ciel qui éclaire seulement. Un ciel riche en couleurs froides : le ciel étant en général dans les bleus, par rapport au soleil couchant qui colore en orange et en rouge. Cela donnait une image froide, bien qu’il s’agissait de températures de couleurs très élevées. Absence de contraste donc très belle photogénie. On tournait dans ces conditions. Cela faisait des tournages courts, car entre la disparition du soleil derrière l’horizon et le début de la nuit, il se passait une demi-heure, trois quarts d’heure et c’est tout. Donc, on réalisait une journée de répétitions en une demi-heure, trois quarts d’heure de tournage. Donc là, ça me plaisait bien. Il fallait être prêt, complètement.
Voix-off : Comment faisait-il ? // Comment faisait-il pour filmer les corps ?
Voix-off : Peut-être en figurant leur résistance à l’immobilité, à la destruction, à la mort.
Voix-off : En 1964, dans « Méditerranée », j’ai vu une jeune fille reproduire les attitudes immémoriales des humains et des dieux.
Voix-off : En 1973, dans « L’ordre », j’ai vu un homme dont la lèpre décuple la résistance à l’ordre politique, à l’ordre médical, à l’ordre de la représentation voyeuriste.
Voix-off : En 1980, dans « Pour mémoire », j’ai vu des hommes tenter de perpétuer des gestes ancestraux, sachant que leur temps était compté.
Voix-off : En 1975, dans « L’acrobate », j’ai vu un corps inhibé, maladroit dans ses rapports avec les autres corps, acquérir aisance et liberté en s’imposant des règles strictes.
Une dialectique de la liberté et de la contrainte qui est la source du burlesque.
Voix-off : Comment faisait-il pour toucher le spectateur ?
Bien que ses films aient eu un public restreint, j’ai toujours pensé que son cinéma s’adressait à tout le monde : à l’initié comme au profane, au scénariste comme à l’agent administratif.
Pascal Bonitzer : Ce qui s’est passé, Jean-Daniel a organisé pour moi tout seul une projection de « l’Acrobate ». Je me suis retrouvé avec ce film… Je l’ai revu récemment et je l’ai trouvé magnifique, je trouvais qu’il dégageait une poésie très forte, à cause de la façon dont il intégrait ce bal et ce couple de danseurs. Mais à l’époque, je n’ai absolument pas été sensible à ça, j’étais très désorienté par le film où je avais trouvé des naïvetés, des choses pour moi très dérangeantes. Donc, j’étais sorti de là très perplexe, ne sachant pas du tout ce que je lui dirais. D’autant que cette projection était une entrée en matière pour commencer à travailler sur le scénario. Je suis sorti assez perplexe, embêté. J’ai traversé la rue et je me suis cassé la jambe. En montant sur le trottoir, sans que j’ai glissé sur quoi que ce soit, je me suis retrouvé par terre avec une cheville cassée.
Alexis Bergoz : J’ai beaucoup apprécié à regarder « L’Acrobate ». C’est vraiment un film qui m’a plu. On a beaucoup de sympathie pour Léon. Je ne dirais pas qu’on puisse s’identifier au personnage mais je pense que c’est des gens qu’on peut rencontrer. Au début du film, il n’a pas beaucoup de chance dans la vie dans ce qu’il entreprend, avec ses amis – amis qu’il n’a pas beaucoup – , au niveau de son travail, c’est pas trop ça non plus. Avec les femmes, il a pas beaucoup de succès. Mais on a vraiment de la sympathie pour lui, ça nous fait de la peine mais on peut en rigoler, c’est monsieur « pas-de-chance ». Jusqu’au moment où il découvre la danse, le tango. D’ailleurs, au moment où il voit son premier concours de danse, il a une réaction assez amusante. J’ai beaucoup aimé sa façon de danser, de se secouer, c’est assez surprenant. Donc, à partir du moment où il apprend à danser, je crois que sa vie, elle change. Tout va mieux pour lui, au niveau de son travail, ses relations avec les femmes. Sa vie a complètement changé et c’est grâce à la danse. On est content pour lui. Ce qui lui arrive, il le mérite. Un peu plus tard, ça allait toujours bien pour lui jusqu’au moment où il apprend que la femme qu’il aime va partir avec un autre homme et là c’est un peu triste. On se dit que la chance est partie. Du coup, il veut arrêter de danser. Il y a peut-être un lien entre l’amour et la danse pour lui. Personnellement, il n’y a pas quelque chose qui m’a frappé si ce n’est la musique. Elle reste beaucoup en tête, elle est entraînante et à la limite, elle donne envie de danser. Je ne me vois pas encore danser le tango. Mais je l’ai regardé avec mon petit frère. Il est resté 20 minutes. Et au moment de partir, il sifflotait la musique. Elle lui est restée en tête en 20 minutes. Et moi, c’est pareil. C’est quelque chose qui m’a beaucoup marqué dans ce film et que j’ai apprécié.
Voix-off : Comment faisait-il ?
Voix-off : Comment faisait-il pour faire de nouveaux films sans oublier les anciens ?
Peut-être en réutilisant ses anciens films comme des souvenirs, des traces incontournables mais sujettes à réinterprétations.
Pr Derouesné : Lorsqu’on regarde dans une nouvelle vision le film, on voit une construction qui n’apparaît pas au premier abord. Il y a effectivement des phénomènes récurrents. Le texte de Sollers, qui est tout de même intéressant lorsqu’il dit par exemple que les choses sont à la fois les mêmes et vues différemment. Alors là, ça évoque tout à fait nos conceptions actuelles de la mémoire. C’est-à-dire qu’actuellement dans la mémoire, et en particulier dans les mémoires autobiographiques, qui se rapportent à soi, on considère que le passé n’existe pas en tant que tel, il est reconstruit à chaque évocation. Et chaque fois qu’on évoque un souvenir, on va modifier ce souvenir. Nous sommes en face d’une poétique, cinématographique, visuelle, littéraire et qu’il faut se garder d’en faire une analyse scientifique, ce n’est pas le problème. Ce que je voudrais quand même souligner, c’est que Jean-Daniel Pollet a fait ce film en 1963. Nous ne savions pas à ce moment ce que nous savons de la mémoire, de la construction des souvenirs. Et nous ne savions pas en 1963 que nous avions des systèmes de mémoire qui sont, comme dans les images du film, imbriqués les uns dans les autres.
Voix-off : Comment faisait-il avec les projets de films qui restent à l’état de projet ?
En 1965, il disait ceci : « Les films qui ne se font jamais ont une existence imaginaire assez forte pour servir d’expérience. »
Pascal Bonitzer : J’ai commencé à essayer de travailler sur l’adaptation. En réalité, j’avais déjà fait un traitement qui lui avait beaucoup plu. C’était un traitement de 30 pages qui condensait l’action des deux romans. Avec ma jambe cassée, il a fallu que j’attaque la continuité dialoguée ; et je savais que je faisais un très mauvais travail. Je sentais que ce n’était pas cela du tout, que je n’arrivais pas à trouver le ton. Je m’acharnais un petit peu. Il a pris ça, il l’a lu et il m’a dit : « Non. Quand tu as fait le traitement, tu avais la pêche et là – je voulais pas de le dire comme ça – mais tu n’as pas la pêche. » Alors je me suis dit : il faut tout recommencer. Je crois qu’il l’a quand même présenté à L’Avance sur Recettes, les choses ne sont pas faites et le projet est tombé à l’eau.
Voix-off : « L’idée de ce film m’est venue après une fin de non-recevoir de l’Avance sur Recettes pour un scénario issu d’un roman de Laurence Durrell sur lequel j’ai travaillé avec Pascal Bonitzer en 1984.
Après cet échec, je me suis questionné : que faire ? D’instinct, j’ai rassemblé les copies de mes anciens films, en m’attachant surtout à ceux que je pouvais qualifier d’essais : Méditerranée, Bassae, l’ordre, Pour mémoire etc qui avaient en commun de pouvoir être découpés – plage d’images et de textes – avec l’espoir… (JDP)
Voix-off : Une autre fois, il m’avait parlé d’une idée de scénario autour du temple grec de Bassae qu’il aimait tant.
Un américain, qui avait vu ce temple, et qui voyait là le début de la dégradation de l’architecture moderne, décidait de la faire sauter. Finalement, il se faisait sauter lui-même.
Je luis demandais alors s’il consentirait à me donner ce sujet, ce qu’il accepta. J’imaginais alors l’histoire suivante : un européen, las du tourisme de masse, décide de frapper un grand coup en faisant sauter ce temple. Il y parvient et rentre chez lui, satisfait.
Mais sa satisfaction est de courte durée car il apprend que depuis l’explosion, il y a dix fois plus de touristes qu’avant.
J’avais même imaginé filmer l’explosion et ses conséquences.
Voix-off : Mais à la différence de Jean-Daniel Pollet, moi, je n’en ai strictement rien fait.
Voix-off : Comment faisait-il ?
Voix-off : Dans un de ses essais, Serge Daney écrit de Jean-Daniel Pollet qu’il adopte la position du revenant. Que voulait-il dire ?
Peut-être pensait-il à cette idée selon laquelle un artiste est au moins une fois dans sa vie confronté aux origines de son art.
Et pour Jean-Daniel Pollet, ce ne fut pas seulement une métaphore esthétique. Il l’a vécu jusque dans sa chair. Ecoutons-le :
Voix-off : « Je me dis, je vais aller filmer la voix ferrée. Ma caméra était donc dirigée vers les rails, j’étais accroupi à un mètre d’eux.
Soudain, j’entends un grondement derrière moi. Je me redresse, me retourne, je sens qu’il va me rentrer dedans. Je gicle en l’air et je suis comme une caméra filmerait si on la projetait en l’air -on a vu ça dans 100 films- un bout de train, un bout d’arbre, des images filer.
Moi, j’étais en l’air. Je crois que j’ai attendu un peu avant de retomber. Puis la caméra qui tombe à terre et continue de tourner en finissant sur des cailloux, sur des rails, sur le ciel et sur un arbre. On peut imaginer la scène comme ça. Puis, les secours sont arrivés. Tiens, quel beau travelling me suis-je dit. Travelling en effet le bleu du ciel »(JDP)
Voix-off : Continuons à filer la métaphore du revenant.
Le propre du revenant – en théorie- c’est de hanter les vivants. Jean-Daniel Pollet nous montre plutôt ce qui nous hante.
Voix off Jean Thibaudeau : Omonia. Je ne suis pas descendu dans le métro d’Athènes. On dit qu’Omonia, la nuit, c’est l’Enfer. La drogue. Tu sais qu’au temps d’Homère, l’Enfer n’était pas au sein de la Terre mais à ses limites. Et là, on creusait une fosse, on faisait sacrifice de lait, de miel, de vin, de farine, d’agneau, de brebis noir. Et les morts accouraient.
Voix off : Et puisqu’il faut bien en finir avec ces histoires de fantômes, interrogeons un témoin bien vivant.
Voix off Yann Le Masson : Nous sommes allés aux obsèques de Jean-Daniel où il y avait pas grand monde d’ailleurs. Je pense que ça a été un peu improvisé. Il s’est passé quelque chose d’assez rigolo et je pense que dans son cercueil, Jean-Daniel a du se tordre de rire. Parce qu’à l’arrivée au cimetière, on met d’habitude les cercueils dans un certain nombre de niches, faites pour les recevoir avant qu’ils ne soient mis dans la tombe. Le cercueil est arrivé, il a commencé à être introduit dans cette niche mais impossible de le rentrer. Le cercueil était trop gros ou trop grand. C’est peut-être Jean-Daniel qui était trop gros. En tout cas, on a poussé le cercueil pour le faire rentrer et ça n’a pas été possible. Nous, on avait vraiment envie de rigoler parce que c’était comique et qu’après tout, s’il avait pu se voir en train d’être poussé dans sa niche, il aurait certainement rigolé.
Voix-off : Par où commencer ? Peut-être par le début.
Voix-off enfant : Jean-Daniel pollet est né le 20 juin 1936 à La Madeleine Lez Lille dans le département du Nord, d’une famille bourgeoise aisée. Son père était architecte et Jean-Daniel raconte comment il construisait des planeurs avec une minutie incroyable qui fascinait l’enfant qu’il était…






