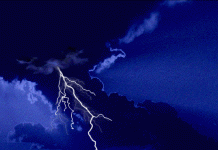« An ability to understand the hybrid nature of culture develops from an experience of dealing with a dominant culture from the outside. The artist who understands and practices hybridity in this way can be at the same time an insider and outsider, an expert in border crossings, a temporary member of multiple communities, a citizen of two or more nations… His/her job is to trespass, bridge, interconnect, reinterpret, remap, and redefine, to find the outer limits of his/her culture and cross them. »
Guillermo Gomez-Pena, From The new world border: prophecies, poems and loqueras for the end of the century, 1996.
« La capacité à comprendre la nature hybride de la culture se développe à partir d’une expérience consistant à se confronter à une culture dominante depuis un point de vue extérieur. L’artiste qui comprend et pratique l’hybridité de cette façon peut être à la fois celui de l’intérieur et celui de l’extérieur, un expert des passages frontaliers, un membre temporaire de multiples communautés, le citoyen de deux ou plusieurs nations. Son travail d’artiste, (femme ou homme) l’amène à s’introduire à tout prix, créer des ponts, faire lien, réinterpréter, redessiner, redéfinir les choses pour trouver les limites externes de sa propre culture et les traverser1. »
Guillermo Gomez-Pena, De La nouvelle frontière du monde : prophéties, poèmes et folies pour la fin du siècle, 1996.
Préalable – A la fin 1979, Robert Kramer est arrivé à Marseille un peu par hasard, à l’occasion d’une tournée rétrospective de ses films relayée par Jean-Pierre Daniel2 dans la région. Il a découvert Martigues, Fos, Port de Bouc, la Camargue et les quartiers nord de Marseille. La force et la violence de ces espaces, la confrontation entre nature et industrie lui rappelaient quelque chose des États-Unis. C’est cette rencontre avec un paysage, les étendues portuaires et le bouleversement des échelles de grandeur, la présence d’une histoire politique marquée par les luttes ouvrières, la présence ancienne du parti communiste, le nœud de contradictions des enjeux économiques, écologiques et humains qui a déplacé le projet du tournage de Guns3 vers la région marseillaise. Je crois que Robert a trouvé ici à la fois quelque chose de sauvage et d’irréductible et une tradition politique auxquelles il lui fallait se confronter. C’est encore ce qui va travailler, plus tard, l’histoire de Walk the walk. Il y a là un élément important dans la démarche de Robert Kramer, celui d’une certaine relation à l’espace pensé comme un composé sensible, une géographie en mouvement, une configuration d’éléments humains et non humains, un agencement d’énergies, de matières et de durées.
1 – Cette dimension « géographique » du travail de Robert Kramer a été souvent remarquée. Certains de ses films dessinent des parcours, de longs cheminements qui les inscrivent dans la tradition américaine des road movies, de Milestones à Route One/USA jusqu’à Walk the walk. Sa propre trajectoire, des Etats-Unis vers la France en passant par le Vietnam, l’Angola, le Portugal, l’Allemagne et la façon dont elle retrace une histoire familiale qui croise certains des grands conflits du monde contemporain, de l’Amérique à l’Allemagne Nazi en passant par Israël, fait de son cinéma une pratique qui vient s’inscrire dans une histoire politique en mouvement.
Ces films eux-mêmes sont animés par un mouvement qui a quelque chose à voir avec la marche. Ce sont des voyages, des processus dont on ressent clairement qu’ils ne sont pas entièrement prédéterminés mais qu’ils se construisent, au moins pour une part, dans leur propre mouvement et qu’ils portent avec eux la capacité d’accueillir l’imprévu propre à celui qui va sans savoir tout à fait où sa route va le conduire. Alors que, si souvent, les films se présentent comme des mécaniques habiles qui nous conduisent avec certitude vers un dénouement parfaitement prédéfini, que le suspens consiste à nous piéger dans des jeux d’apparences qui nous font croire que quelque chose peut arriver dans un monde où, en réalité, tout est déjà joué et où tous les mystères seront, au bout du compte, élucidés, les films de Robert Kramer sont pleins d’histoires qui se croisent et qui alimentent un chemin qui se trace en même temps qu’il se parcourt. Leur fin n’est jamais définitive, elle ne vient jamais fermer aucun destin, elle n’élucide aucun mystère, elle ne nous propose que des étapes, des escales dans un mouvement en devenir.
Il me semble que, pour Robert Kramer, le cinéma ne consistait pas seulement à faire des films, mais que c’était d’abord une façon de faire naître une situation et un processus dont le film sera une émergence. Ce qui était important ce n’était pas d’abord le film comme objet, mais l’ensemble de ce qui pouvait se jouer dans la mise en œuvre du film. Cela ne signifiait évidemment pas que le film n’avait pas d’importance, mais le film devait se nourrir d’un processus, du déploiement d’une situation. Il devait émerger de l’ensemble des rencontres et des croisements, par le tissage d’une série d’éléments où les gens, leurs métiers, leurs engagements et leurs pratiques (qui toujours, chez Robert Kramer, tendent à introduire à l’intérieur du film la question de la pratique cinématographique elle-même), mais aussi la mer, un fleuve (le mouvement de l’eau toujours présent4), les machines au travail, les animaux et les différentes formes de vie, tous ces éléments sont comme des fils qui doivent pouvoir garder une part de leur propre existence, de leur propre temporalité. Le film est l’endroit où la coexistence de ces éléments, leur tissage, le fait qu’ils tiennent ensemble doit se rechercher. Le corps, la médecine, la toile et le tissage, on pourrait assez légitimement faire un détour par l’histoire personnelle de Robert Kramer, et la façon qu’il a de la réintroduire dans la matière de son cinéma, non seulement dans son propos, mais d’abord dans sa fabrique5. La question est que le film soit capable de porter la richesse que le processus lui-même mobilise, qu’il en reconstitue d’une certaine façon la géographie ou, autrement dit, que le film dans sa propre temporalité soit capable d’accueillir le mouvement interne de ces durées multiples.
Cette géographie est celle d’un cinéma qui aborde le « territoire » comme une relation à l’endroit où l’on vit, à ce qu’on y fait, à ce qui peut s’y nouer d’une histoire commune dans la complexité des situations, des expériences et de leurs contradictions. Il ne s’agit pas de fabriquer une « représentation » qui se substituerait à la réalité du territoire, qui prétendrait en montrer l’identité, qui servirait la légitimation d’un discours, qui viendrait recouvrir la réalité, l’embellir, la réduire et l’assujettir, exercer sur elle une forme de captation et de travestissement pour en faire un objet de démonstration, encore moins de communication. Mais il ne s’agit pas non plus de se contenter de décrire, de prétendre rendre compte d’une réalité qui nous serait en quelque sorte donnée. Il ne s’agit pas de réduire cette complexité, d’en extraire une leçon, mais plutôt d’essayer de travailler avec elle, de la faire jouer comme une richesse, une potentialité, une source inépuisable d’énergie.
2 – Il y a donc un enjeu déterminant, qui tient à la position du cinéma par rapport à la vie, ou plus exactement, à la place du cinéma dans l’expérience que chacun peut faire de son existence. Dans les premiers textes que nous proposent les Notes de la forteresse6, où s’évoque sa rencontre avec le cinéma, Robert Kramer pose clairement une opposition : il y a d’un côté la vie réelle, il y a d’un autre côté la représentation que le spectacle cinématographique donne de l’existence. Cet écart ouvre l’espace du travail qu’il s’agit de développer, il ouvre un champ d’investigation et d’expérimentation. Dans les années 60, le spectacle cinématographique s’incarnait évidemment dans la forme culturellement dominante du cinéma hollywoodien. Il écrit ainsi : « Nous nous sentions éloignés de la façon dont les rythmes sociaux, psychologiques et physiques de la vie quotidienne (c’est-à-dire de la vie vécue, de ce que nous faisons et comment nous le faisons) nous étaient renvoyés par le grand écran. Quelque chose clochait dans le temps, la durée, dans les dialogues et la façon dont ils étaient dits, dans la disposition et l’approche de la caméra »7.
Il ajoutera plus tard : « Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de différence entre filmer et vivre. Je suppose que cela dépend, si on a en tête l’idée de faire un film ou non. Faire un film (procédure dont nous sommes tous familiers, qui demande décors, équipe, acteurs et cantines), cela n’a pas grand rapport avec regarder, ou vivre »8. L’enjeu est esthétique, mais il est aussi et indissociablement politique. Cela, Robert Kramer l’exprime clairement et sans détour : « Le pouvoir Dominant – les Médias dominants – les interprétations dominantes, la Grande Vérité, le Grand Mensonge : celui qui contrôle les armes contrôle les médias de nos vies, il contrôle une définition de la « réalité » des possibles et de l’imaginaire… Nous ne détenions pas (et ne détenons toujours pas) « la vérité », à supposer que celle-ci existe. Nous avons une expérience, vous avez une expérience – et nous serons beaucoup plus forts (également, bien sûr, en tant que force politique) si nous avons la capacité d’analyser et de comprendre cette expérience, pour voir réellement et imaginer d’autres possibilités. »9.
Il est important de garder à l’esprit le contexte dans lequel cette pensée s’est construite, celui des années soixante, c’est-à-dire évidemment celui des luttes politiques pour les droits civiques et pour la paix au Vietnam, mais aussi celui de la « Beat Generation » et de mouvements artistiques comme Fluxus.
On trouve dans les écrits de Robert Kramer de nombreuses critiques contre ce qui relève de la « technique » du cinéma, des modèles de la réalisation, etc. Mais dans cette critique de la technique cinématographique, ce sont d’abord des normes qui sont en jeu, les normes d’un certain « bien faire ». Cette critique n’est pas vraiment celle des outils et des machines. Elle n’est pas non plus celle d’une catégorie de films, les films de genre, par exemple, ou le cinéma « grand public ». C’est d’abord celle d’une relation à la pratique cinématographique comme procédure contrôlée. Elle porte par exemple sur la façon dont une approche normative conduit à découper, comme autant de moments séparés, les étapes qui doivent conduire à la fabrication du film : inventer une histoire, écrire un scénario, faire un découpage, tourner les scènes préalablement définies, les monter, faire un mixage, etc. Cette « technique » est la forme d’organisation normative qu’impose une certaine économie du cinéma.
Elle est indissociable d’une conception assez classique de l’auteur et de son statut, du film comme œuvre et de la narration comme sujet de la réalisation. Elle implique que le film commence dans un travail d’écriture qui constitue le moment où l’auteur peut affirmer son projet, l’élaborer, le faire exister sous une première forme, en quelque sorte celle de la partition. Il en résulte que le moment même du cinéma, la réalité de sa mise en œuvre vient dans un second temps, comme un moment où le projet artistique va être exécuté, interprété, mais où il doit du coup être maintenu, préservé, défendu. Dans ce schéma, le risque est que la réalisation, le tournage et ses contraintes, ne soient pas à la hauteur du film tel qu’il a été imaginé, écrit, rêvé et financé. L’enjeu du tournage et du montage devient alors un enjeu de maîtrise, un rapport de force dont l’objectif est de faire exister quelque chose qui a déjà été imaginé, décidé, et qui va devoir faire l’épreuve du réel. On voit bien comment ce processus « technique » répond à une logique économique : le scénario est la base sur laquelle les financements de la réalisation pourront être réunis.
3 – Robert Kramer se place dans une autre relation au cinéma et à sa pratique. Il ne s’agit pas d’opposer un modèle à un autre modèle, il s’agit plutôt de penser autrement les éléments dans lesquels s’articule la pratique du cinéma comme une pratique spécifique. Je me souviens d’une conférence à propos d’un spectacle inspiré par Les maîtres fous, le film de Jean Rouch. Baptiste Buob, anthropologue et cinéaste, disait à propos de Rouch que sa caméra ne fait pas que capter ce qui se passe devant elle, qu’elle le transforme parce qu’elle produit une situation et qu’elle catalyse des relations10. C’est une notion importante que je voudrais reprendre à propos de Robert Kramer. Peut-être peut-on avancer, comme une simplification méthodologique, l’idée d’une opposition entre un cinéma où la caméra s’efforce de disparaître, où elle ne veut être que la fenêtre qui donne accès à un monde différent, et un cinéma où la caméra est impliquée dans la réalité comme l’un de ses éléments. Plus largement, il s’agit de questionner la relation de l’image avec ce qu’elle montre, de sortir du schéma de la relation binaire entre le réel et sa représentation.
Ce déplacement, cette façon d’interroger la relation d’extériorité entre le réel et sa représentation conduit directement, dans le champ du cinéma, à se jouer de l’opposition entre documentaire et fiction. Le genre documentaire repose sur une fiction préalable, silencieuse, celle d’une réalité qui serait là, présente, et qu’on pourrait prélever, restituer, rapporter. Le problème est que cette fiction nourrit une illusion, celle de l’objectivité, bien sûr, mais plus généralement celle de la différence ontologique entre le monde et sa représentation, sur laquelle repose l’opposition entre le réel et la fiction. Il s’agira plutôt de considérer que le réel est toujours saisi dans des situations dont nous sommes parties prenantes, dont nous sommes non les auteurs mais les agents.
Il est nécessaire pour cela de concevoir que le film est un champ de relations avant d’être un objet qui se ferme sur lui-même pour pouvoir se présenter devant le spectateur. Cela signifie qu’il faut expérimenter d’autres façons de faire exister ce qui apparaît dans les différentes étapes qui organisent la vision dominante du cinéma, écriture, scénario, découpage, tournage, montage. Chez Kramer, l’écriture est une pratique permanente, elle accompagne le projet cinématographique au fur et à mesure qu’il se précise, elle adopte des formes d’existence qui permettent la communication avec les interlocuteurs nécessaires du processus cinématographique, mais elle se poursuit ensuite, y compris au cours du tournage, par exemple par une transformation au jour le jour des éléments scénaristiques, et encore au cours du montage. Le montage est lui-même une forme d’écriture où se compose une matière filmique qui peut se prolonger par différentes sortes d’enregistrements, la voix de Robert lui-même, par exemple. Le film s’inscrit ainsi dans un cours, dans un mouvement, dans une histoire, où il se confronte sans cesse avec ce qui est extérieur à lui et qui l’alimente ou le questionne, en même temps qu’il raconte une histoire, qu’il articule des temps et des espaces, qu’il se dessine comme un mouvement et un récit. D’une certaine façon, la question se pose de la limite du film, de ce qui est le film et de ce qui ne l’est pas, de ce qui est dedans et de ce qui est dehors. L’aboutissement du montage en décide, mais on sent encore, souvent, la fragilité de cette frontière, ou sa porosité.
4 – Par exemple, l’un des principes des règles techniques qui articulent le modèle « dominant » du cinéma est d’obtenir une sorte d’unité et de lisséité dans laquelle la fabrication disparaît au profit du récit. Robert Kramer évoque à plusieurs reprises l’idée de la caméra toute puissante qui délivre une ouverture sur le monde, impose un regard qu’on ne saurait interroger, qu’on ne peut pas contester. Lui affirme la place de la caméra dans le monde lui-même, le monde « extérieur » comme le « monde » du film, parce que la caméra est un élément de la situation et qu’elle n’a pas de raison de disparaître pour ne devenir qu’une sorte de fenêtre qui feindrait de s’effacer devant le monde ou qui s’imposerait à lui et le tiendrait dans son cadre.
Chez Robert Kramer, la caméra est à la fois une relation au regard et une relation au corps. Elle est dans l’écart entre le corps et le regard, dans l’épaisseur entre ce qui est vu et ce qui n’est pas vu, ce qui est en mouvement et ce que saisit le mouvement. Il ne s’agit donc pas de jouer la carte de ce qu’on appelle la caméra subjective, qui consiste à introduire le spectateur dans le regard potentiel d’un personnage fictif. Il s’agit de laisser vivre la caméra comme un élément de la situation dans laquelle elle se trouve réellement engagée, où elle occupe sa propre place.
Dans plusieurs de ses films, Robert Kramer, qui tient la caméra, prend la parole. On ne le voit pas à l’image, on entend sa voix. Parfois, un personnage du film lui répond, un espace de dialogue se crée, des deux côtés de la caméra. C’est le cas dans Route One/USA ou dans Walk the walk. Cette voix est bien hors-champ, mais elle est dans un hors-champ très inhabituel dans le cinéma, parce que ce n’est pas le hors-champ du monde fictif que le film génère, ni même tout à fait le hors-champ du documentariste qui vient questionner un témoin, mais un hors-champ qui participe réellement de la situation qui produit le film.
Cet espace que nous livre la caméra est un espace profondément incomplet. Si la caméra n’est plus un œil absolu, si elle n’est plus la source d’une maîtrise, si elle se trouve elle-même partie prenante de ce qui se joue comme un élément nécessaire mais situé du film, cela signifie qu’elle endosse une part de fragilité, de précarité mais aussi d’humanité qui devient curieusement exigeante pour le spectateur. Le spectateur peut être séduit par les images, les matières, les ellipses visuelles. Il peut chercher sa place dans l’incomplétude de ce monde qui ne se donne jamais totalement à voir. Mais il doit aussi accepter de faire « avec » ce qui peut apparaître comme une écriture ou un dessin, il doit l’accompagner, il doit apprendre la patience, il doit trouver sa propre place par rapport à ce qui se joue là, devant lui, sur l’écran.
Un autre élément formel tient à la place de la narration, de l’histoire qui se raconte. Il me semble que la narration est un enjeu fondamental du cinéma de Robert Kramer. D’une certaine façon, ses films sont remplis d’histoires, une multitude d’histoires les traversent, s’y croisent, y prennent part. Beaucoup d’histoires précèdent les films et peuplent les écrits que Kramer développe dans le processus de préparation du film. La narration prend son départ avant que le travail du film ne commence, mais elle ne se ferme pas comme une entité autonome, elle continue de vivre, d’évoluer, de se confronter à l’expérience du film comme processus. Elle permet de définir l’horizon d’une situation qu’elle n’épuise pas, qui trouve son sens pour sa capacité à faire exister d’autres histoires, à leur donner une place. C’est un récit qui appelle à l’existence d’autres récits.
De la même façon, le montage ne se soumet jamais entièrement à la contrainte de la narration, il n’y est pas assujetti, il n’est pas là pour donner un rythme qui fasse vivre une histoire comme dans une bulle autonome. Le montage est là pour faire émerger un espace dans lequel puissent coexister des temporalités différentes, avec leurs récits propres, et ces temporalités ne sont pas nécessairement chronologiques ou « métriques »11. Il peut s’agir de temporalités plus ou moins fluides ou lentes, étrangères les unes aux autres mais néanmoins coexistantes, constitutives d’une réalité composite. Chacune doit trouver sa place, de temps de son devenir. Le montage est un agencement qui doit tenir « avec », qui doit faire tenir « ensemble » ce qu’il compose. La dimension musicale de cette pratique du montage est incontournable12.
5 – Je voudrais approcher ces éléments autrement que comme des données méthodologiques. Il me semble, par exemple, que le concept de dispositif peut nous y aider. Il peut nous aider à dépasser la notion de technique et la façon dont elle tend à faire couple avec celle de modèle. Penser qu’il y a un modèle cinématographique dominant, qui trouverait dans les productions hollywoodiennes son expression privilégiée, et qui s’adosse à un ensemble de normes qui disent ce qu’il faut faire pour réaliser un film conforme au modèle, conduit à une vision évidemment schématique. Cela laisse entièrement de côté le fait que ce modèle ne cesse de se transformer, de se réinventer, de jouer avec lui-même et ses propres normes, de se nourrir de ses propres subversions. Cela laisse surtout de côté la question de l’expérience, ou plus exactement, le fait que ce modèle dominant ne peut l’être que parce qu’il propose aussi, et peut-être d’abord, le film non seulement comme une représentation mais comme une expérience, et une expérience capable d’agir sur l’expérience que nous faisons de notre existence.
Il y a bien un travail sur le dispositif filmique chez Robert Kramer. Je voudrais faire l’hypothèse que c’est ce qu’il découvre avec la rencontre des cinéastes Norman Fruchter et Robert Machover à l’occasion du tournage du documentaire Troublemakers en 196513. A cette époque, Robert Kramer n’est pas encore cinéaste. Il s’intéresse à la pratique de l’écriture, il s’imagine d’abord en écrivain et il est engagé dans un combat politique. C’est cette rencontre dont on dit qu’elle a constitué le point de départ de sa démarche cinématographique. Il me semble qu’elle a pu jouer ce rôle parce qu’elle était non seulement une rencontre avec le cinéma en train de se faire, mais aussi une rencontre avec un autre cinéma, une autre façon de faire du cinéma que celle dont le cinéma hollywoodien faisait la démonstration. Ce n’était pas seulement la rencontre avec un genre du cinéma, le documentaire par opposition avec la fiction, mais avec le type de dispositif cinématographique que le documentaire rend possible, avec ce qu’il engage dans l’espace du tournage, ce qu’il suppose de la place de la caméra et de son rôle, de sa fonction par rapport à une réalité à l’intérieur de laquelle elle prend place. Cette rencontre fait apparaître aux yeux de Robert Kramer une autre façon de faire du cinéma, parce qu’elle fait apparaître la possibilité d’un autre dispositif cinématographique et qu’elle définit un espace pour un travail d’écriture. Ce qui se trouve mis en question, ce n’est pas la fiction, c’est le fait que le dispositif cinématographique dominant, de type hollywoodien, pour le dire vite, produise de la fiction comme un « autre monde » qui n’a rien à voir avec le monde réel dans lequel on agit et on vit14.
Mais on a compris qu’il ne s’agit pas non plus de vouloir restituer un réel qui existerait en lui-même et qui attendrait qu’une caméra arrive pour le saisir. Je ne pense pas que Robert Kramer ait jamais cru en ce réel là. Au contraire, il a toujours perçu la tentative de le saisir par les moyens du cinéma comme un exercice de manipulation plus ou moins clairement assumé. La seule façon de se confronter au réel, c’est de le mettre en jeu dans un processus de travail, c’est d’inventer une situation qui permette ce travail, qui réunisse les éléments qui contribuent au processus de réalisation, qui le rende possible. C’est ce qui constitue ce que j’appelle ici le dispositif cinématographique chez Robert Kramer.
Encore que le simple fait de dire cela doive s’accompagner d’un certain nombre de précisions. Quand on parle de dispositif, on a tout de suite tendance à imaginer une structure fixe, quelque chose qui vient organiser un ensemble d’actions, de productions, de positionnements et de stratégies. On conçoit aussi une articulation d’éléments qui convergent vers des effets qu’ils produisent. D’une certaine façon, c’est bien de cela qu’il s’agit. Mais il faut aussitôt ajouter qu’il n’y a certainement pas « un » dispositif cinématographique chez Robert Kramer, quelque chose qui ferait système, mais une façon permanente de travailler le dispositif cinématographique, de s’y confronter et d’essayer de le réinventer et de faire en sorte que le cinéma, comme mise en jeu d’une situation, y fonctionne. Le dispositif cinématographique doit faire l’objet d’une expérimentation, il se propose comme une configuration possible, une aventure à tenter. Il n’y a pas une façon de faire du cinéma, mais des façons de faire du cinéma. Il y a bien des éléments qui sont réunis pour qu’advienne la possibilité d’un film et d’un film dans lequel quelque chose de la réalité se développe et travaille, mais il n’y a rien de fixe, il n’y a pas de « méthode » pré-établie, de configuration arrêtée15.
Il me semble qu’un certain nombre d’éléments peuvent être désignés qui contribuent à la mise en place des dispositifs cinématographiques chez Robert Kramer. Il y a la caméra, sa position, son propre mouvement. Il y a l’écriture et la pratique de l’écriture, sa double fonction d’espace d’invention et de moyen de communication. Il y a l’idée de l’invention d’une situation qui est indissociable de la fiction, mais qui permet de penser la fiction autrement, comme quelque chose qui vient travailler le réel, ou dans quoi le réel va pouvoir venir s’engouffrer. Il y a la question du montage ou de ce qui va pouvoir venir en tenir lieu comme processus d’émergence formelle, par exemple la situation du direct, l’intervention performative16 ou la contrainte du plan séquence17. Il y a enfin la question de l’espace, dans toute sa complexité, parce qu’elle est ce dans quoi les autres éléments peuvent venir trouver leur place et se mettre en situation. Tout cela, et d’autres éléments encore, dessinent une configuration mobile, une première géographie avec laquelle il s’agit de travailler et qui dessine dans l’autre géographie, celle de l’espace réel, le jeu des traçages qui peut rendre possible l’existence concrète du film.
Mon hypothèse est donc ici qu’une certaine géographie est doublement à l’œuvre, à la fois dans les films de Robert Kramer (j’entends ici non seulement les films comme résultats, comme objets visibles, mais comme processus, comme aventures) et dans la relation à l’espace où ils se déploient. Ou bien, si cela peut être plus clair, que les films s’articulent dans un double espace, celui de l’agencement des éléments qui participent de la situation qui les rend possibles, ce que j’ai appelé le dispositif, et celui qu’ils dessinent par les lignes qu’ils tracent dans ce qu’on appelle le territoire. Cette hypothèse ne fonctionne peut-être pas pour la totalité du cinéma de Robert Kramer. Elle me semble en tout cas intéressante à suivre de Milestones à Route one/USA, de Walk the walk à Cités de la plaine, et elle fait écho, autrement mais non moins fortement, dans d’autres films qui ne sont pas des parcours dans l’espace mais qui les rendent sensible à partir d’un lieu et d’une position, Guns d’une certaine façon, Doc’s Kingdom, A toute allure, Berlin 10-90 par exemple.
6 – Si je veux approcher cette géographie, il me faut faire un détour et abandonner un temps Robert Kramer pour mieux pouvoir y revenir. Le titre de notre Colloque, Cinéastes Arpenteurs, Qu’est-ce qu’un territoire cinématographique ? propose évidemment une piste qu’il est tentant de saisir. Parler de cinéastes arpenteurs, c’est bien sûr renvoyer à une pratique de la marche ou plus largement du déplacement, mais c’est aussi souligner un certain type de relation à ce qu’on appelle le territoire. En l’occurence il s’agit de mettre en avant une forme d’attention précise pour un environnement qu’on explore. Le territoire est ce que livre cette exploration. Si marcher désigne de façon très générale une action, arpenter insiste sur chaque pas, sur la suite des pas, sur leur régularité et leur caractère systématique et répété. Évidemment, cette insistance appelle à la métaphore. Les « arpentages » peuvent être de natures bien différentes et on peut imaginer que l’environnement qui en fait l’objet soit géographique ou humain, qu’il porte des questionnements écologiques, historiques et politiques, économiques, sociaux, culturels. Mais l’arpentage renvoie bien à l’idée d’un espace qui se trouve ainsi défini, circonscrit, déterminé, constitué comme un objet identifiable et, d’une façon ou d’une autre, appropriable.
C’est que l’arpentage est avant tout une opération de distinction. Il marque le passage d’un espace relativement indéterminé à une étendue bien définie. Il est même d’abord et étymologiquement lié à une opération de mesure et donc à la production d’un schéma, d’une figure, d’une représentation. Des repères, des bornes, des témoins, un plan, une carte, quelque chose qui fait « texte ». L’idée de l’arpentage d’un territoire n’est pas seulement celle d’une relation à un environnement, à un contexte général, à la réalité concrète d’un espace particulier. Elle appelle autre chose qui non seulement pointe, identifie, mesure, mais qui ferme aussi et qui approprie. Elle en appelle à une forme de territorialisation. Je voudrais insister sur l’ambivalence de la notion de territoire. Cette ambivalence est importante : d’un côté, le territoire spécifie un espace, il lui ajoute la notion d’une identité ou d’une particularité qui le distingue. Un territoire n’existe que par rapport aux autres espaces qui ne sont pas lui comme il existe par rapport aux usages, à l’attention, aux formes d’inscription, sensibles comme matérielles, dont il fait l’objet. Mais d’un autre côté, cette identité est le résultat d’un processus d’objectivation, si ce n’est d’abstraction. Cette identification constitue le territoire à la fois comme un objet de savoir et de pouvoir, ce sur quoi s’exerce un acte d’autorité et une forme de contrôle.
Il est alors logique de faire le détour par la question cartographique. Les pratiques de l’arpentage sont, comme on le sait, très anciennes, et avec elles les techniques de calcul et de mesure des géomètres. Elles remontent à la plus haute antiquité, à l’Égypte et à Rome. L’histoire de la cartographie est elle aussi très ancienne et elle est indissociable de la pensée scientifique ou pré-scientifique en Grèce, en particulier de la géométrie et de l’astronomie. Ce qui m’importe ici c’est que l’histoire moderne de la cartographie, dont l’une des caractéristiques est certainement la façon spécifique dont elle articule et unifie ces deux lignes, celle de l’arpentage et des techniques des géomètres et celle de la cartographie générale et de ses relations avec l’astronomie, est une histoire qui participe étroitement à la production de l’État moderne et de la pensée territoriale qui l’accompagne. L’aventure scientifique des Cassini18 en est l’expression emblématique. Dans la relation traditionnelle de la carte et du territoire, l’idée que la carte représente le territoire peut induire une naïveté qui participe d’une illusion essentialiste, celle qui voudrait que le territoire soit ce que la carte vient représenter et donc qu’il la précède. En réalité, la carte, dans une perspective d’histoire des sciences, produit le territoire en même temps qu’elle le représente. Elle contribue par exemple de façon déterminante à l’apparition des frontières conçues comme des lignes continues qui séparent des étendues spatiales.
Dans la notion d’arpentage, il y a donc deux dimensions, celle de la mesure et celle de la proximité, ou du contact. D’une certaine façon, l’arpentage, c’est la mesure par contact, celle qui se fait pas à pas, pied à pied, dans le suivi matériel et effectif du terrain. Il y a là, d’une certaine façon, l’idée d’un passage et d’une séparation. La mesure implique l’idée d’une distance, d’un écart, un passage du qualitatif au quantitatif, de la réalité sensible du monde à la donnée abstraite du nombre. Quand Michel Serres nous parle de ce que Thales a vu au pied des pyramides19, il montre comment les grecs, au tout début de l’histoire de ce qu’on va plus tard appeler la science, ont acquis la capacité de mesurer sans contact, à distance, par la vue, en rapportant un triangle à un autre triangle, semblable sans être identique. Cet acte de fondation va donner lieu à l’existence de toute une série d’appareils et d’instruments, qui sont des appareils de visions et de mesure par la vision, de mesure à distance de ce qu’on ne peut toucher. Cela va permettre de mesurer la distance de la Lune à la Terre ou la circonférence du globe terrestre. Cela va permettre aussi de définir des lignes abstraites, les latitudes, puis de poser leur complémentaires, les longitudes, et de constituer la matrice logique de la cartographie moderne.
La notion d’arpentage conjugue deux dimensions opposées : la proximité avec le terrain tel qu’il est et sa mesure qui permet d’en reporter la surface sur une représentation normée. Quelque chose qui est de l’ordre de la matière et du concret, quelque chose qui est de l’ordre du dessin et de l’écriture. Quelque chose qui est de l’ordre de l’expérience et de l’enquête, quelque chose qui est de l’ordre de la norme et de la loi. D’une certaine façon, nous nous trouvons bien au cœur de la question, celle de la façon dont s’articulent les formes d’existence de l’espace concret, des modélisations savantes, des enjeux de maîtrise, de pouvoir, de domination. A cet endroit là, ce qui semblait constituer deux plans bien séparés, ce qui pouvait être compris comme deux préoccupations étrangères l’une à l’autre, les pratiques cinématographiques dans leurs relations aux territoires d’un côté, les pratiques techniques de l’arpentage et du calcul des surfaces de l’autre, se rejoignent ou se croisent. Se contenter d’opposer l’une à l’autre, opposer par exemple l’horizontalité du cinéma, à hauteur d’homme, et la verticalité de la carte, dont le point de vue serait surplombant et en tant que tel dominateur, n’est pas une bonne solution, parce que l’horizontalité du territoire reflète une conception de l’espace indissociable de la verticalité cartographique. L’une ne peut pas se penser sans l’autre20.
L’appareil « caméra » est en lui-même à interroger dans le fonctionnement de cette bifurcation. Il est à la fois moyen de découverte et outil de contrôle. Il est instrument d’écriture et machine de surveillance. Il ne faut pas oublier que la caméra porte cette ambivalence dès le départ, qu’il y a par exemple une histoire commune de la caméra et des machines volantes, que Nadar était aussi un précurseur du vol en ballon21 et qu’on a pensé, lors de la première guerre mondiale, à embarquer dans les avions des caméras avant de penser à les équiper avec des armes22. Poser une caméra dans l’espace est un acte immensément signifiant.
7 – Comme beaucoup d’autres notions, le terme de territoire véhicule un piège manifeste, ce genre de piège qu’il ne suffit pas de connaître pour les éviter. C’est l’idée que le territoire serait quelque chose qui existe et se maintiendrait en lui-même, indépendamment des activités des hommes – plus généralement des organismes vivants qui l’occupent. C’est une forme de substantification, ou d’essentialisation, qui nous conduit à voir le territoire comme quelque chose qui est donné, qui peut-être même nous définirait ou qui serait ce à quoi nous nous affrontons, comme nous pouvons nous affronter à la mer ou à la montagne, au vent ou à la pluie. Bref, nous confondons les espaces, dans leur existence concrète, dans l’expérience que nous pouvons en faire, dans l’existence que nous pouvons y mener, et le territoire, que je propose de considérer plutôt comme un résultat ou comme le produit d’une certaine façon de construire cette expérience et d’organiser cette existence. Par exemple, il vaudrait certainement mieux dire qu’il n’y a pas des territoires, mais des façons de produire de la territorialité, ou encore des façons de produire l’espace comme territoire. Le territoire est le résultat d’un agencement ou d’un type d’agencement, dont ce qui a été dit de la notion d’arpentage peut donner une assez bonne idée.
L’histoire moderne de l’occident est largement, de ce point de vue, celle d’un processus de territorialisation. Ce qu’on appelle l’impérialisme est bien une façon de territorialiser de vastes étendues spatiales et d’agencer cette territorialisation dans des rapports politiques de dépendances où des formes de diversité, culturelles, linguistiques, pratiques, politiques aussi, sont hiérarchisées dans des systèmes juridico-militaires ou économiques et culturels d’assujettissements. Il faut aussi rappeler que les États modernes se sont constitués comme des unités territoriales liées au principe d’une unité politique mais aussi culturelle, linguistique, fantasmatiquement ethnique si ce n’est pseudo-biologique et raciale, qu’on appelle la nation. Les trois unités de l’État comme institution politique et administrative, de la nation comme identité culturelle et du territoire comme étendue spatiale et comme foyer, sont bien au fondement de ce qu’on appelle les États modernes. Et comme nous le savons tous mais qu’il est bon de le rappeler, tant le discours inverse ne cesse de revenir à la charge, ces trois unités sont de pures fabrications de l’histoire, et d’une histoire remarquablement récente. Je ne peux qu’insister sur ces figures de l’unité : unité de l’État, unité de la culture et du peuple, unité du territoire, parce qu’elles supposent des récits qui sont ce par quoi on peut les imposer et les approprier, parce qu’elles font l’objet d’une guerre des récits.
Ces figures, évidemment, feignent d’affronter leur contraires – la division des intérêts qui pourraient conduire à une dissolution de l’autorité de l’État, la présence d’une altérité qui viendrait miner l’unité et l’intégrité de la culture ou du peuple, l’éclatement de la cohérence spatiale qui menacerait l’autorité de l’État et l’unité, qu’elle soit culturelle ou physique, de la nation. Bien sûr, ces trois figures « négatives » nous parlent immédiatement, nous y reconnaissons les thèmes fondamentaux des idéologies nationalistes et nous y voyons aussitôt les ressorts qui font fonctionner les manipulations les plus grossières : les pouvoirs occultes, cinquième colonne, centres de décisions clandestins, complots qu’il faudrait dénoncer, et pourquoi pas organisations terroristes. Nous y reconnaissons les innombrables variantes de l’altérité négative et largement inventée dont les principales figures sont aujourd’hui celles du « grand remplacement » et du « communautarisme ».
Les migrants sont aujourd’hui devenus les principales victimes de cette construction fantasmatique. Il est indispensable de rappeler que, depuis que le mur de Berlin est tombé, il y a donc exactement 30 ans, jamais autant de frontières n’ont été créées, jamais autant de murs ne se sont érigés, jamais autant de barrières ne se sont dressées, jamais autant de moyens n’ont été réunis pour filtrer la circulation des personnes. Jamais autant de gens sont morts en essayant de franchir les frontières. Et il est indispensable de bien repérer cette tendance à nourrir l’imaginaire des figures nationales et des figures des ennemis de la nation. Et de se rendre compte que nous sommes, à chaque fois devant l’exercice de la violence.
8 – Dans son très beau livre de 1983, Imagined communities, traduit en français par L’imaginaire national, ce qui n’est pas tout à fait la même chose, Benedict Anderson envisage les nations comme des communautés produites et dans la production desquelles la dimension imaginaire est essentielle23. Dans l’esprit de B. Anderson, cet imaginaire n’est pas seulement celui d’une imagerie qui produirait les récits et les héros capables d’incarner la communauté nationale, les événements qui seraient proposés à une mémoire commune, les symboles paysagers qui provoqueraient l’identification d’un « chez soi », tout ce qui peut constituer la source émotionnelle d’un sentiment d’identité et de sécurité. Bien plus profondément, il consiste à donner corps à des conceptions du temps et de l’espace. Il serait plus exact de dire que les figures que je viens d’évoquer ne peuvent exister et prendre sens que dans un certain cadre, plus fondamental, constitué par les formes dans lesquelles ces récits, ces figures, ces paysages trouvent leur place et leur unité. Ce qui intéresse Anderson, ce sont les figures narratives d’un temps et d’un espace homogènes, continus, partagés simultanément par des individus différents mais situés dans une chronologie et une unité géographique qui les constituent immédiatement comme des éléments appartenant à une même communauté. Cette unification passe d’abord par le partage de ces espaces et de cette histoire, par le sentiment de leur inscription dans les deux plans de la continuité spatiale et de la linéarité chronologique.
Anderson pense d’abord à la littérature et il cherche des exemples dans des romans qui font émerger non pas nécessairement un discours nationaliste, mais le sentiment d’une unité spatio-temporelle commune et partagée. L’un des thèmes, ou des agencements formels, sur lesquels Anderson s’arrête est celui de la simultanéité et de la conception qu’elle suppose du « en même temps que » comme condition des modalités modernes de la narration. Il oppose la simultanéité médiévale qui fait communiquer les ordres du mondain et du sacré comme deux modalités du présent, et la simultanée rendue possible par ce que Walter Benjamin appelait « un temps vide et homogène », une temporalité abstraite et générale qui permet de concevoir l’idée du « pendant ce temps là ».
J’ajouterais pour ma part qu’il faudrait de la même façon distinguer la vision essentiellement qualitative d’un espace dont les agencements hétérogènes répondent à des ordres différents qui est significativement celle de l’antiquité et de la période médiévale, de la vision quantitative d’un espace homogène propre à la modernité et dont la cartographie a contribué à donner une représentation de plus en plus cohérente.
Or l’espace et le temps sont directement la matière des pratiques artistiques en général, et évidemment du cinéma en particulier… C’est exactement ce que le cinéma produit, directement, par le filmage pour une part, mais surtout par le montage, par la façon dont il fait émerger un espace et un temps cinématographique. De ce point de vue, le cinéma est une formidable machine à produire de la continuité spatiale et temporelle. De sorte que la question territoriale et avec elle sa figure moderne et dominante, celle de l’État national, n’est pas seulement ce dont parlent beaucoup de films, ce dont ils manipulent inépuisablement les représentations, que ce soit volontairement ou involontairement, mais c’est aussi ce qui les traverse dans leur facture et leur forme, la façon dont ils construisent les conditions spatio-temporelles des histoires qu’ils racontent. Cette territorialité et la temporalité qui l’accompagne relève ainsi d’une esthétique, au sens premier qui désigne non des valeurs et des qualités soumises à l’appréciation d’un jugement, mais des formes qui déterminent notre perception, les conditions dans lesquelles s’exerce notre sensibilité.
Il me semble que c’est pour une bonne part ce que le cinéma de Robert Kramer ne cesse d’affronter, de l’intérieur d’abord, comme cinéaste d’une radicalité politique, puis d’une façon bien plus subtile, pour se mettre à démonter le schématisme de l’unité territoriale dans le mouvement de ses marges et de ses fractures et de se confronter à l’invention à la fois d’une autre spatialité et d’une autre temporalité.
9 – Je ne peux pas ne pas voir dans des films comme Milestones, puis dans Route One/USA, très différemment dans Berlin10/90, puis dans Walk the walk et évidemment dans Cités de la Plaine, les jalons d’un questionnement sans cesse repris et retravaillé sur les territorialités et les temporalités. Il s’agit d’expérimenter une façon de penser et de raconter qui ne se soumette ni au principe de l’homogénéité de la continuité géographique, ni au principe de la simultanéité chronologique.
Par exemple, il me semble qu’il n’y a jamais chez Robert Kramer de « pendant ce temps ». Il y a des mouvements de disjonctions ou de bifurcations temporelles, ou au contraire des croisements et des rencontres, qui dessinent des espaces complexes où coexistent des lignes narratives autonomes. Parfois, ces disjonctions sont traversées par des jeux de correspondances. Dans Walk the walk, par exemple, les escaliers de la gare Saint-Charles à Marseille et les grands escaliers d’Odessa, qu’Eisenstein avait filmé dans Potemkine, se trouvent dans une situation d’échos et de contamination, mais à aucun moment il ne s’agit de dire : « pendant ce temps, sur les escaliers d’Odessa, etc.. ». A l’opposé, comme je l’ai déjà souligné, on ne cesse de rencontrer des formes de coexistence de ce qu’on pourrait appeler, avec Deleuze, des « blocs de durée » qui, chacun, développent leur propre mouvement24. Le montage est là pour faire émerger un espace dans lequel puissent coexister des temporalités différentes et ces temporalités ne sont pas nécessairement chronologiques ou « métriques ». Il peut s’agir de « mouvances » plus ou moins fluides, plus ou moins solidaires les unes des autres mais néanmoins coexistantes, constitutives d’une réalité composite. C’est le fleuve dans Route one/USA, c’est la mer ou la Camargue dans Walk the Walk, c’est d’une certaine façon la présence continue, dans la salle de bain de l’appartement dans Berlin 10/90, des images qui se déroulent sur l’écran de la télévision posée à même le sol.
C’est largement la raison pour laquelle Robert Kramer pense beaucoup de ses films comme des parcours ou comme des cheminements. Alors, les déplacements sont des chemins qui croisent d’autres chemins, des lignes qui font apparaître des perspectives multiples, des couches spatio-temporelles qui trament l’apparente unité territoriale. Il s’agit de traverser ces couches, de suivre ces lignes, de jouer sur les modalités de leur coexistence, sur leur capacité à produire non une unité lisse, mais une variation productive, non une continuité linéaire, mais la traversée d’un éventail de trajectoires discontinues.
Je voudrais tenter de suggérer des moments qui ne constituent certainement pas les étapes d’une évolution mais qui me paraissent contribuer à faire apparaître quelques-unes des questions qui ponctuent une préoccupation dont je fais l’hypothèse qu’elle ne cesse de venir travailler la pratique du cinéma chez Robert Kramer. L’un des enjeux qui l’animent est certainement d’affronter la façon dont les formes d’existence de la territorialité se transforment, et avec elles les modalités de l’exercice de la domination. J’irai donc par grands traits, dont j’accepte entièrement l’arbitraire, l’imperfection et la partialité.
10 – Je partirai d’une première remarque : avoir choisi comme titre pour la publication d’un recueil des textes de Robert Kramer Notes de la forteresse me semble extrêmement significatif de la position spatiale qui a d’abord été la sienne. La forteresse, c’est évidemment l’État national sous sa forme d’État impérialiste. Et la question qui est posée est de savoir comment on peut être dehors tout en étant dedans. Il me semble que cette question traverse tous les premiers films de Robert Kramer. C’est à la fois une question politique, celle de l’activisme radical, une question subjective et personnelle, celle de l’implication de soi dans l’action et la relation aux autres, et une question esthétique ou artistique : comment faire du cinéma sans reproduire les normes esthétiques qui confortent la forteresse comme figure de l’unité nationale. Milestones est à la fois le constat des limites de cette position et une tentative de les surmonter. C’est un effort pour dépasser la figure schématique de la contradiction et la réinventer sous la forme d’un processus complexe. C’est aussi l’affirmation du cinéma comme un espace où ces questions peuvent être mises en travail.
On peut penser que c’est l’impossibilité de rester « dedans » qui contribue à conduire Robert Kramer vers l’Europe, non seulement comme une remontée vers les sources historiques de la trame qui articule l’histoire de sa propre famille à l’histoire de la forteresse, mais comme une expérience de la position d’hybridité, au sens où l’artiste Mexicain Guillermo Gomez-Pena en parle dans la citation que j’ai proposé comme exergue à cette réflexion. Cette position de l’hybridité devient alors une position esthétique et politique. Elle conduit Robert Kramer à se confronter non seulement à d’autres territoires, à d’autres cultures, à d’autres histoires, mais à d’autres façons de faire du cinéma. Cette hybridité est une façon décisive de déplacer la contradiction binaire de la relation dedans/dehors. Celle-ci supposait la possibilité théorique d’une résolution par une affirmation d’unité : être dedans ou bien être dehors. Elle appelait au moins à la radicalité du choix d’une position. L’hybridité y substitue le travail permanent de la contradiction comme un moteur d’invention.
La première guerre du Golfe est, me semble-t-il, un moment décisif de ce parcours. C’est la première expérience de « la fin du cinéma ». Elle se joue en deux temps : Robert Kramer est en résidence à Berlin, ville où ses parents ont vécus au début des années 30, avant même de se rencontrer. C’est le cœur de l’histoire du nazisme. C’est l’endroit où le bloc soviétique a commencé à s’effondrer et où le mur vient juste de tomber. Un nouveau monde se profile, et avec lui un nouvel ordre mondial. La guerre du Golfe est l’une des premières manifestations de ce nouvel ordre mondial et en annonce bien des caractéristiques. Or la guerre du Golfe se vit en temps réel et comme un spectacle télévisé. L’état major américain diffuse en permanence une parole qui commente l’avancée des opérations militaires et fabrique quelque chose qui ne manque pas d’évoquer ce qu’on a récemment appelé, à propos des discours de Trump, une « réalité alternative », où les frappes sont « chirurgicales » et où la guerre fait zéro mort. Des caméras sont embarquées sur des missiles autoguidés qui infléchissent leurs trajectoires pour atteindre leur cible. Les images ne sont plus seulement les enregistrements d’une réalité passée mais les éléments mobiles d’un processus en cours. Les médias sont intégrés dans le dispositif politico-militaire pour donner naissance à une nouvelle synthèse technologique. La guerre est la démonstration de l’existence d’un nouvel ordre techno-politique qui est aussi un nouveau cadre de l’exercice de la violence. Robert Kramer passe des journées et des nuits devant la télévision, il enregistre des heures d’émissions. Avec la guerre du Golfe, l’opposition entre dehors et dedans a cessé d’exister : il n’y a plus d’extériorité. Enregistrer est une façon de filmer, c’est aussi une façon de monter, c’est-à-dire d’articuler et de penser à l’intérieur de cette nouvelle logique territoriale. L’espace cinématographique n’est plus le même, il s’est dilaté, il s’est aussi dispersé et métamorphosé.
Il y a en effet un troisième élément dans ce qui se joue au tournant des années 90, c’est l’expansion rapide des technologies numériques. La micro-informatique, apparue au début des années 80, est portée par les grandes entreprises qui structurent aujourd’hui le monde des industries post-fordiennes. Apple, Microsoft sont apparues et pénètrent d’une façon tout à fait nouvelle l’espace personnel des identités subjectives. Au début des années 90, c’est l’apparition du WEB et une nouvelle façon de penser la spatialité, en terme de flux et de réseaux. Des textes essentiels viennent marquer l’ampleur des transformations qui sont en train de s’opérer dans la logique spatiale de la territorialisation, comme le Post Scriptum sur les sociétés de contrôle de Gilles Deleuze, paru dans le premier numéro de l’Autre Journal en mai 1990 et TAZ, d’Hakim Bey paru en 1991. On ne peut plus penser de la même façon la relation à la machine, au corps, à soi et aux autres, à ce qui fait communauté.
Il est intéressant de dire ici quelques mots de Berlin 10/90, film commandé par La Sept selon le principe de la réalisation d’un plan séquence d’une heure, au moins pour deux raisons. D’abord parce que Robert Kramer y répond en mettant en œuvre un dispositif cinématographique qui éclaire sa façon de penser la pratique du cinéma. Ensuite parce que le contexte du film, explicitement situé et daté à Berlin, en octobre 1990, un an après la chute du mur et au moment de la guerre du Golfe, expérimente la façon dont le cinéma peut être mis en travail comme un outil pour une pensée critique engagée dans le mouvement de son temps. Le plan séquence est conçu comme le protocole d’une performance dans laquelle la durée va entièrement articuler le film dans son projet et sa réalisation. Cette durée ne sera pas pensée comme une contrainte externe, mais comme une donnée interne qui va devenir la matière sensible du film, jusque dans les moments de silence et d’immobilité.
Les éléments du dispositif ont été préparés. Ils sont matériels, comme la télévision posée au sol dans la salle de bain de l’appartement qu’il occupe avec Erika, sa compagne, ou bien sûr la caméra (que le cinéaste va déplacer, manipuler, devant laquelle il viendra parler). Ils sont aussi visuels (des images tournées ou enregistrées par Robert Kramer qui vont défiler continûment sur l’écran de la télévision), scénographiques (la salle de bains comme lieux d’enfermement qui renvoie directement à d’autres lieux d’enfermement, la cabane où s’était réfugié Ezra Pound à la fin de la seconde guerre mondiale, les cellules où des prisonniers ont été torturés, etc.), mentaux (une importante préparation nourrit ce qui sera une prise de parole, un discours devant et avec la caméra). Mais le film sera pensé comme une écriture en acte, largement improvisée et montée par les déplacements du corps de Robert Kramer dans cet espace réduit, la présence des images diffusées par la télévision au sol, ce qui s’aperçoit de l’appartement où Erika travaille, etc. Le jeu de l’intérieur et de l’extérieur est donc l’objet même de cette écriture, comme la relation à l’histoire et à la mémoire. Du temps, de l’espace, l’invention du dispositif de leur articulation dans le travail de l’écriture, en l’occurrence celle d’un « montage » en action dans le plan continu.
On est devant quelque chose qui relève d’une performance, mais il ne s’agit pas pour autant d’un document qui rendrait compte d’une performance qui existerait pour elle-même. La performance n’existe ici que pour et par la caméra, elle l’intègre dans son dispositif comme elle intègre l’écran de la télévision et le flux des images qui y font irruption comme une extériorité déjà formée, articulée. Il s’agit d’un huis-clos, mais un huis-clos qui s’ouvre par les deux voies de l’image en mouvement, celle de l’écran au sol, et celle de la caméra à laquelle Robert Kramer s’adresse. L’une et l’autre reconstruisent un espace télévisuel dans lequel le film s’inscrit. Dans Berlin 10/90 la fermeture de cet espace sans fenêtre devient un point autour duquel toute une géographie vient s’agencer, New-York et les États-Unis, les pays du Golfe, l’Égypte, Israël. Le titre d’une exposition, Géographies de la terreur, devient, sur l’écran de la télévision, par le jeu du cadrage, graphie de l’erreur.
11 – Il devient donc nécessaire de penser cette nouvelle spatialité. Je conçois Walk the walk, en 1995, comme une tentative en ce sens, où c’est d’abord la dissolution et la crise violente des spatialités territoriales qui est interpelée. Dans Walk the walk, chacun est confronté à la nécessité de réinventer ce qui peut constituer la communauté. C’est à la fois une dispersion, celle du trio familial dont chaque membre va chercher sa propre voie, sa propre voix25, et une quête. Cités de la Plaine, en 1999, constitue une autre tentative de poser la même question, mais dans un rapport entièrement différent à la territorialité. Le monde des Cités de la Plaine est un monde coupé en deux, mais il ne l’est plus dans une logique de juxtaposition. Les formes complexes et ramifiées de la coexistence de deux logiques des configurations spatiales sont intriquées : la conurbation mondiale des métropoles qui font réseau et les espaces interstitiels de l’ensemble des zones qui perdurent entre ses ramifications, ce que Robert Kramer, en mémoire et à contrepied de William Gibson, qui a inventé la notion de cyberespace en 1982, appelle la matrice.
Ce monde a perdu la continuité homogène qui était auparavant la sienne. Il voit se redistribuer profondément ce qui était pensé comme l’opposition du distant et du proche. Aujourd’hui, ces distinctions ne correspondent plus à des distances spatiales neutres et objectives, elles transitent par la coexistence de couches ou de strates spatio-temporelles qui coexistent et s’articulent par des modules de connections : autoroutes, aéroports, gares, supermarchés, mais aussi terminaux d’ordinateurs, etc. A plusieurs reprises, Robert Kramer fait allusion à l’espace médiéval, ce qui revenait dans bien d’autres textes de l’époque, par exemple chez Umberto Eco. L’idée est donc d’un monde complexe, dans lequel l’espace et sa mesure sont différents selon où on se trouve, en l’occurrence à Tourcoing, dans la métropole lilloise, mais aussi selon qui on est et de quel côté on le regarde.
Il est alors éclairant de lire ce que Robert Kramer écrit dans les premières pages des notes26 qu’il rédige en novembre 1998 dans le cours de l’élaboration du film. Il s’agit d’une description des cartes sur lesquelles des urbanistes de la Métropole travaillent, ce qu’on retrouvera dans les premiers plans du film. Ce sont des surfaces, mais des surfaces qui se déploient comme des couches archéologiques, des organisations animées par leur propre logique et leurs propres temporalités. Ici, la verticalité cartographique se multiplie dans l’épaisseur de ses propres strates.
« Ce qu’on voit, c’est la surface même de la Terre, c’est une peau : vue d’en haut, une petite portion de la planète.
Puis il y a la représentation des différentes couches de cette portion, chacune allant plus profond, comme d’habiles interventions chirurgicales, révélant une archéologie de l’intégration.
– Au-dessus de la Terre, le tracé des vols commerciaux de la région, dont la configuration est intriquée dans un réseau de communication invisible, de radars et signaux radio, de transmissions télévisées.
– Sur la Terre, les anciennes frontières politiques et administratives, la démographie courante. Et puis les usines textiles abandonnées. Le rouge indique les réseaux électriques. Il y a le système des trains, des routes et des canaux, des autoroutes, qui traverse cette forêt de signes et qui se dirige vers la Métropole suivante.
– En dessous, une couche silencieuse de transports souterrains. Dispersés, les restes enfouis d’autres villes, d’autres époques.
– Tissé autour de ces tunnels et de ces histoires, au fond de la Terre, un univers de câbles et de conduits : gaz, eau, égouts, coaxial et fibre optique.
– Et puis, la qualité et le caractère de cette portion de terre même, la base minérale, les veines usées de charbon, les puits et les couloirs profonds abandonnés des mines qui les ont desservis. »
Reste à penser la capacité du cinéma à continuer de travailler la complexité de ces nouvelles spatio-temporalités. Dans les années 90, je me souviens surtout de la difficulté que le cinéma avait d’affronter la question des mutations technologiques apportées par le numérique, autrement que comme le moyen de l’extase spectaculaire des effets spéciaux. Les cinéastes qui se sont confrontés à ces enjeux sont étonnamment rares. Encore plus rares sont ceux qui ne se sont pas contentés de les penser comme une menace. Chris Marker est certainement l’un de ceux-là, abordant le numérique comme l’ouverture de nouveaux espace à explorer, prenant le risque de se confronter aux formes éphémères qui en émergeaient. C’est le célèbre CD-Rom Immemory, L’ouvroir sur Second Life ou le film Level Five. Robert Kramer était confronté à la même question, par d’autres biais, d’une autre façon27. Une voie possible était de l’aborder sous l’angle de la transformation des machines et des organismes, ce qu’il tente dans Ghosts of Electricity. Mais il me semble que c’est surtout par la question de l’espace, du territoire et du politique qui continuait à travailler son cinéma en tant que pratique, que cette confrontation s’est opérée.
Cités de la Plaine ouvre de nouveaux horizons. Il entame une nouvelle façon de penser cette géographie en mutation, et, avec elle, sa propre position de cinéaste. C’est devant cette ouverture que Robert Kramer nous aura brutalement laissé, cette nouvelle voie d’exploration des possibles. Devant le sentiment que ce film, qui se trouve accidentellement être le dernier, inaugure une nouvelle façon d’interroger ce que c’est que voir et que filmer. Il nous laisse devant tout ce que le film porte de questionnements, de chemins à prendre que nous ne pouvons pas percevoir et qui nous font nous sentir un peu comme Ben, le personnage principal du film, aveugles, mais avec devant soi la nécessité d’apprendre à voir autrement.
Jean Cristofol, antiAtlas des frontières, Locus Sonus (ESAAix), 2020.
Contact : cristo(arobase)plotseme.net
L’image en haut du texte est issue du film Dear Doc de Robert Kramer, 1990.
Ce texte fait suite à une intervention de Jean Cristofol, Tracer les traces, au delà du territoire, lors du colloque Cinéastes arpenteurs : Qu’est-ce qu’un territoire cinématographique ?, le 28 novembre 2019 à l’IMéRA.
1 Traduction Dominique Poulain.
2 Cinéaste, pédagogue, créateur et ancien directeur de l’Alhambra cinemarseille.
3 Le projet de Guns, déjà très avancé, devait d’abord se réaliser au Havre. Robert Kramer a déplacé le tournage au dernier moment. Guns est le premier film réalisé par Kramer en France.
4 Quand Robert Kramer achètera avec Erika, en Normandie, une maison, ce sera tout à fait au bord de la Seine, devant le fleuve.
5 Le père de Robert Kramer était médecin, sa mère, une artiste pratiquant le design textile.
6 Notes de la forteresse (1967-1999), Robert Kramer, Édition établie et présentée par Cyril Béghin. Textes traduits de l’anglais par Cécile Wajsbrot et Cyril Béghin, Post-Éditions, 2019.
7 « Pour le catalogue italien », 1980, Notes de la forteresse (1967-1999), p 135
8 « Walk the walk », Notes de la forteresse (1967-1999), p 357
9 « Pour le catalogue italien », 1980, Notes de la forteresse (1967-1999)
10 Intervention de Baptiste Buob dans le cadre de la séance du 17 avril 2019 du séminaire Recherche, art et pratiques numériques, intitulée Du film à la performance, de la performance au film, IMéRA, Marseille.
11 Voir Gilles Deleuze, L’image-temps, Éditions de Minuit, 1991, p50 et suivantes.
12 Il faudrait évoquer ici la rencontre avec Barre Phillips, qui va accompagner Robert Kramer à partir de Guns. L’une des clés de leur collaboration est bien que Barre Phillips ne produit pas une musique qui « commente » les images ou qui est là pour exprimer les émotions que le spectateur devrait ressentir, mais une musique qui joue avec les images et le mouvement du film, à la fois autre et avec. Il est important de relever que c’est Barre Phillips qui va ouvrir à Robert Kramer la pratique de l’improvisation et la pratique de la performance. Robert performera à plusieurs reprises avec sa caméra dans le cadre d’événements initiés par Barre Phillips.
13 Troublemakers est un film documentaire réalisé par Norman Fruchter et Robert Machover
14 « Avec la plupart des gens avec qui j’ai commencé aux Etats-Unis au début des années 60, on avait un peu la même impression, c’est-à-dire que tous les films hollywoodiens qu’on voyait – bons ou pas, ça dépendait – ne parlaient pas de ce dont on parlait le soir entre nous. Donc, on a décidé de parler des choses qui nous intéressaient à notre manière – qu’il y ait un public ou non était secondaire. » Hommage à Robert Kramer, Propos recueillis par Civan Gürel, Bertram Dhellemmes et Cédric Verlynde. Mise en forme par Thierry Laurent. Cet article est extrait du Tausend Augen #5
15 Robert Kramer ne va pas cesser de se confronter à différentes « façons » de faire des films. C’était le cas avec Guns, où le fait de faire un film en France, avec une équipe française et de se confronter aux « façons de faire » françaises était un véritable enjeu. C’est encore le cas de À toute allure et évidemment de Diesel, son grand échec. D’une certaine façon, il s’agit chaque fois d’explorer ce que peut être la pratique du cinéma, d’expérimenter ce qu’on peut faire avec.
16 Ces expériences performatives, menées avec Barre Phillips, ont profondément transformé sa relation à la caméra et sa façon de penser la présence de la caméra dans le tournage.
17 Un exemple majeur est évidemment donné par Berlin 10/90
18 La famille Cassini compte plusieurs générations de cartographes qui vont, au XVIIIe siècle, réaliser la première carte détaillée du Royaume de France à partir d’un système de triangulation géodésique qui s’appuie sur des repères matériels localisés sur le terrain. La carte Cassini est un ensemble cartographique homogène et régulier qui donne la base d’une connaissance précise du territoire.
19 Michel Serres, « Ce que Thalès a vu au pied des pyramides », Hommage à Jean Hyppolite, Presses Universitaires de France, 1971.
20 Alors même que je suis en accord avec la relation que Gilles Chamerois voit, dans son article sur Route One/USA, « Aller, revenir, tisser un abri » (dans Transatlantica, 2012), entre le cinéma de Robert Kramer et la géographie, je ne suivrai donc pas l’opposition qu’il y développe entre le point de vue vertical de la carte et le point de vue horizontal du film.
21 Le 23 octobre 1858, Nadar dépose un brevet intitulé « Un nouveau système de photographie aérostatique » dans le but « d’employer la photographie pour la levée des plans topographiques, hydrographiques et cadastraux ».
22 Walter Franck, « Tentatives de vol, Formes définitives d’une économie esthétique de l’aérien », Éditions HYX, 1995.
23 Benedict Anderson, L’imaginaire National, réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, éditions La Découverte Poche/ Sciences humaines et sociales, 2006.
24 Gilles Deleuze, Cinéma, tome 2, L’image Temps, les Éditions de Minuit, 1985, p50 et suivantes.
25 En un sens parfois littéral : la jeune fille, Raye, pratique le chant lyrique.
26 Notes de la forteresse (1967-1999), Post-Éditions, 2019.
27 Il faudrait consacrer un travail spécifique aux relations entre Robert Kramer et Chris Marker qui se sont trouvés, à bien des moments, très proches.