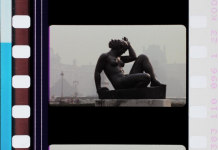C’est là que réside la différence essentielle entre le cinéma et le reste. Dans ce nombre – le plus grand – donc le plus sauvage. Vous sortez de chez vous un matin, le ciel est bleu, il y a du soleil. Vous recevez ce choc du ciel bleu et du soleil dès le seuil de votre maison franchi. Quelque part en vous, dans votre organisme physique ou mental, la chose se traduit avec la fulgurance de la sensation par : “Bleu le ciel ce matin, soleil.” Plus tard, lorsque cette fulgurance sera recouverte par du temps passé, si vous voulez lui faire un sort, le dire à autrui, vous la traduirez en une phrase, aussi bien orale qu’écrite, laquelle phrase explicitera dans quelles circonstances, un beau matin, en sortant de chez vous, vous avez été frappé par le ciel bleu, le soleil. C’est là, sans aucun doute, le sort le plus courant que connaîtra l’événement que vous avez vécu. Mais il y en a d’autres, des milliers, dont le poème, par exemple, ou le cinéma.
De tous les modes de dire, le cinéma sera sans doute le dernier parce qu’il se présente comme le plus inaccessible – du fait de la technique – et le plus séparé de l’événement. En fait, au contraire, c’est ce moyen-là qui sera le plus apte à recréer le choc de l’événement soit : “Bleu le ciel ce matin, soleil”, et à le transmettre au plus grand nombre. Quatre mots, deux images articulées entre elles par une syntaxe muette, invisible, très proche de coïncider, dans un non-dit, avec la sensation originelle. Ce plus grand nombre, qui est-ce ? D’où vient-il ?
Le travail d’un cinéaste à un film – ne parlons pas de l’encombrement, du freinage de ce travail par l’appareil technique – se situe à un endroit différent de celui de l’écrivain eu égard à un livre. Avant d’atteindre le film, le cinéaste en passe par un livre dont l’écriture n’aura pas lieu mais qui a valeur d’écrit quant à sa place dans la chaîne créatrice. Il passe par-dessus ce livre et se re- trouve à la place de sa lecture, justement celle du spectateur. Regardez bien certains films : cela se lit, la trame de l’écrit s’y lit. Le stade de l’écriture occultée, conscient ou non se voit, sa place, son passage se voient. (On ne parle pas bien sûr d’un cinéma commercial fait de recettes de cuisine et qui se situe aux antipodes de toute écriture). À cet endroit de sa création, la place du cinéaste se trouve à l’opposé de celle de l’écrivain par rapport à son livre. Peut-on dire que dans le cinéma on écrit à l’envers ? On peut dire quelque chose comme ça, il me semble. C’est justement à la place du spectateur que le cinéaste voit, lit son film, tandis que l’écrivain se tiendra dans une obscurité qu’aucune lecture ne peut encore lire, indéchiffrable même pour celui qui va l’aborder. C’est après cette obscurité que se trouve le cinéaste. Faire du cinéma quand on a écrit des livres, c’est changer de place par rapport à ce qui va être fait. Je suis devant un livre à faire. Je suis derrière un film à faire. Pourquoi ? Pourquoi éprouve-t-on le besoin de changer cette place, abandonner celle où on se tenait ? Parce que faire un film, c’est passer à un acte de destruction du créateur du livre, justement, de l’écrivain. C’est annuler celui-ci.
Qu’il soit l’auteur d’un livre “en creux” ou d’un livre “en plein”, en effet, l’écrivain sera détruit par le film. L’écrivain qui est dans chaque cinéaste et l’écrivain tout court. Et il se sera quand même exprimé. La ruine qu’il sera de- venu sera le film. Son “dit” sera cette matière lisse, le chemin d’images.
Entre quelqu’un qui n’a jamais écrit, et un écrivain, il y a moins de distance qu’entre un écrivain et un cinéaste. Celui qui n’écrit pas et le cinéaste n’ont pas entamé ce que j’appelle “l’ombre interne” que chacun porte en soi et qui ne peut sortir, s’écouler au dehors, que par le langage. L’écrivain, lui, l’a entamée. Il a entamé l’intégrité de l’ “ombre interne” ; le silence essentiel commun, il a opéré la réductibilité de ce silence. Et tout acte qui freine cette réductibilité, par exemple, le cinéma, fait régresser la parole écrite. Ce n’est pas vrai que le cinéma dit autant l’écrit que le langage écrit. Le cinéma fait remonter la parole vers son silence originel. Une fois la parole détruite par le cinéma, elle ne revient plus nulle part, dans aucun écrit. Et chez le cinéaste, c’est le pli même de sa destruction qui deviendra un acquis créateur.
C’est sur cette défaite que l’écrit que – pour moi – se bâtit le cinéma. C’est dans ce massacre que réside son attrait essentiel et déterminant. Car ce massacre c’est justement le pont qui vous mène à l’endroit même de toute lecture. Et encore plus loin : à l’endroit même du subissement tout court que suppose toute existence vécue dans la société actuelle. On peut dire cela d’une autre façon : que l’option quasi universelle de la jeunesse pour le cinéma est une option – consciente ou intuitive – d’ordre politique. Que vouloir faire du cinéma c’est justement vouloir aller droit vers le lieu de son subissement : le spectateur. Et cela, en évitant, en détruisant le stade – toujours privilégié – de l’écrit.
Le maquereautage phénoménal du cinéma par le capitalisme dès après sa naissance a formé quatre à six générations de spectateurs et nous nous trouvons devant un HIMALAYA d’images qui constitue sans doute le plus grand sottisier historique moderne. Parallèlement à l’histoire du prolétariat, il y a l’histoire de cette oppression supplémentaire ; celle de son loisir fabriqué par le même capitalisme qui l’asservit, le cinéma de ses samedis. Pendant des décennies, seul le capitalisme avait le moyen de fabriquer le cinéma. L’accès au film était un privilège de classe. On ne veut pas dire par là qu’il ne l’est plus ; il l’est simplement un petit peu moins. Mais il n’y a qu’à voir la colère des cinéastes commerciaux devant “ce petit peu moins” pour comprendre à quel point c’est vrai, à quel point ils se voulaient patrons du cinéma mondial. J’ai entendu une fois Henri Verneuil parler des Cahiers du cinéma, il écumait de rage alors que les Cahiers du cinéma sont cent mille fois moins lus que ne sont vus les films du même Henri Verneuil. Et vouloir faire du cinéma, c’est aussi, justement, sortir de ce rôle de consommateur du cinéma capitaliste, c’est s’extraire, se sevrer de cette consommation réflexe dont on peut dire qu’elle parachève de façon criante le cercle infernal de la consommation tout court. Ce faisant on accuse. On peut dire que tout le cinéma parallèle accuse.