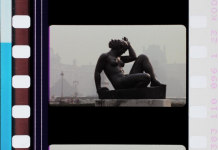Dialogue autour du film Le Pont du Nord de Jacques Rivette
MARGUERITE DURAS. – Écoutez votre film, c’est comme ça que je le vois. Je le vois dans Paris, dans Paris hors du temps, imprévisible, incroyable, comme une ville qui a été admirable et qui est en cours de destruction et que, dedans cette destruction, il y a ces deux femmes errantes qui doivent venir d’on ne sait pas trop quel lieu ni de quelle société, soit de prisons , soit d’asiles psychiatriques, soit de grands ensembles, soit de certaines familles françaises, de l’aristocratie Muette-Passy. Ces femmes défient toute notion de classe et elles sont lâchées dans la destruction de Paris , elles ne peuvent plus s’arrêter , elles roulent comme des automobiles, comme l’actualité, comme New-York en Europe , comme le cinéma , comme l’éternité. Elles sont poursuivies, tandis qu’elles roulent, par le pouvoir dont on ne sait pas non plus s’il est celui de la police ou celui de la passion. Il y a Bulle qui aime un homme et qui n’en meurt pas, il y a Pascale qui aime le karaté : on n’a jamais vu de femmes comme ça dans l’air libre, sans attache aucune, sans identité, film qui est, comme coule une rivière, admirable, admirable, admirable.
JACQUES RIVETTE. – Ça m’intrigue, pourquoi vous dites » et qui n’en meurt pas… » ?
M. D. – Parce que je fais mourir d’amour presque toutes les femmes de mes films. Mais Bulle, ici, ne meurt pas de passion, elle meurt tuée.
J. R. – Oui. La passion elle en fait son deuil, d’une certaine façon. Bulle finit par en faire son deuil, cela prend quatre jours. Le Pont du Nord, c’est un peu le trajet du deuil de la passion. Bulle dit à la fin » tirer un trait » sur cette passion.
M. D. – Bulle atteint ici une sorte d’immensité, un raz de marée à elle seule.
J. R. – C’est une immense comédienne. Là, je parle aussi d’un autre de mes films, l’Amour fou. J’ai été moi – même très étonné en revoyant le film de ce qu’elle fait, car, pour moi , c’est quelque chose qui est au-delà de ce que j’avais vu dans le montage et le tournage ; c’était sans doute trop neuf, trop différent quand ça été fait. Après quinze ans, on voit mieux.
M. D. – Pascale est à la fois tendre et terrible, et d’une beauté très rare, très insolite. Elle est plus près des lions qui défilent au début du film, de ces lions fabuleux de Paris découverts par vous – dont on ne savait pas qu’il y en avait une armée – que des humains.
J. R. – La grâce des deux comédiennes, Bulle et Pascale, est le principal du film.
M. D. – J’ai envie de parler du final comme on parle du final en musique, du final de ce film tragique, le Pont du Nord… Quand Pascale veut faire du karaté et quand Bulle est seule sur le trottoir et qu’elle tombe, c’est-à-dire quand le film se termine, alors qu’il pourrait continuer , c’est exactement ça que je ressens, qu’il se termine comme la vie se termine, par une crise cardiaque.
J. R. – » Doit pouvoir être continué « , c’est une formule que j’aimerais mettre à la fin de tous les films.
M. D. – Oui, c’est vraiment l’accident, c’est-à-dire que le meurtre équivaut ici à l’accident cardiaque, c’est-à-dire à un meurtre décidé par Dieu. Plus personne n’est responsable de ce meurtre, que cela soit appelé Dieu ou la déveine.
J. R. – Quelqu’un qui marche, qui a brusquement une embolie, qui ne sait pas trente secondes auparavant qu’il est en train de voir pour la dernière fois le soleil, que c’est la dernière passante qu’il croise, qu’il voit, et sur laquelle, éventuellement, il se serait retourné.
M. D. – La mort, quant à moi, c’est le bruit de la rue que je n’entendrai plus tout à coup, mais c’est un faux problème, je ne serai plus là pour savoir que je ne l’entends plus. Je ne me souviens pas avoir vu au cinéma un tragique d’une telle pureté. Peut-être que les films ne se terminent jamais et que vous, pour la première fois, vous avez terminé un film de cinéma.
J. R. – À la fin, j’avais plutôt le sentiment d’avoir emprunté et de rendre et les personnages du film encore vivants, et le décor, et le mouvement de la caméra ; c’est pourquoi je fais se détourner et partir cette caméra, comme ça sur le mur ; c’est l’idée qu’on rend de la vie au temps normal, après la parenthèse de la fiction ; on a emprunté ce décor, on l’a capté pendant les cinq semaines de tournage pendant les deux heures de la durée du film ; on a emprunté les visages de Pascale, de Bulle, de Pierre, de Jean-François, et, à la fin, on les rend, on libère Paris pour d’autres films.
M. D. – Quand Pascale est dans la joie physique du karaté, on a l’impression qu’il y a un piétinement du corps mort de Bulle, du film, c’est inoubliable.
J. R. – Cette fin, je l’ai faite comme une fin banale, je l’ai tournée comme la fin la plus banale qui puisse se faire.
M. D. – Guitry disait : » J’ai joué » dans un film et » Je joue » au théâtre. C’est terrifiant ce passé irrémédiable du film.
J. R. – » Une fois pour toujours « , c’est un sentiment que j’ai de plus en plus, et de plus en plus fort, et c’est en même temps ça qui est pour moi le cœur du cinéma, ce qui lui donne tout son sens par rapport aux autres arts .
M. D. – Quelle différence y a-t-il entre vos méthodes de travail dans le Pont du Nord et l’improvisation ?
J. R. – Il n’y a pas d’improvisation du tout, mais j’aime bien voir les choses venir au fur et à mesure. J’aime bien dire : le présent du film c’est la scène que nous tournons aujourd’hui, je ne veux savoir que celle-là. Bien sûr, il est nécessaire de savoir celle que nous tournerons demain, il est inévitable de la prévoir ; ce sont des amis qui s’occupent de ça sur le tournage, comme Eduardo de Grégorio l’a fait sur plusieurs films. Là c’est Jérôme Prieur qui l’a fait, d’être quelqu’un qui est à la fois présent et absent sur le tournage et qui peut avoir cette avance d’un jour ou de deux jours sur le moment présent dans lequel moi je m’obstine, car je ne veux pas être ailleurs que dans le présent de ce qu’on tourne maintenant.
M. D. – Ça se sent dans votre film, l’instant est complètement royal, il est traité comme le seul.
J. R. – Moi j’aime bien dans les films qu’on ait peur de ce qui va arriver , je pense que dans le cinéma les films qui me touchent, ce sont les films où j’ai peur de ce qui va arriver dans l’instant qui suit.
M. D. – Quand je vois votre film et que j’y pense, je n’accepte pas, je ne peux pas accepter que Rivette n’ait pas d’argent pour tourner des films.
Ça commence toujours comme ça
J. R. – À la place on me donne des médailles en chocolat, des diplômes, des grands prix, des ordres de je ne sais quoi. Je ne gagne pas d’argent avec mes films, mais avec les Assedic… Ce sont les Assedic qui me rapportent le plus d’argent. Certaines choses on les a faites dans l’esprit de pauvreté, dans l’esprit d’humilité ; toutes les vertus chrétiennes, nous les avons pratiquées sur ces tournages, mais, cela dit, je pense qu’il faudrait pouvoir alterner les films où l’on pratique les vertus chrétiennes et les films où nous pratiquerions les vertus païennes, j’aurais envie de temps en temps de pratiquer des vertus païennes de prodigalité, de dépense… (Rires.)
M. D. – Le C.N.C. a refusé par trois fois une aide au Pont du Nord. C’est inconcevable et pourtant c’est vrai. Que pensez-vous de ces personnes qui forment les commissions du C.N.C. et de qui nous dépendons ?
J. R. – L’idée que je me fais de toutes ces personnes des commissions et des ministères, c’est que, finalement, ce sont des gens qui sont pleins de bonnes intentions, qui veulent faire du bien au cinéma français afin qu’il soit sain et plein de bon sens, et c’est ça qui est terrifiant, des gens qui veulent faire du bien aux autres. Or, à partir du moment où on veut faire du bien aux autres, on est obligé – pour qu’il y ait vraiment le maximum de bien pour le maximum de personnes – de mettre de côté d’autres personnes, une minorité qui devient peu à peu exclue et qu’il faut détruire . Le bien, dans tous les domaines, implique l’idée de choix, de sélection, l’idée qu’il faut, pour que ce bien – qui n’est pas inépuisable – soit distribué, qu’une partie, même toute petite, soit écartée. On commence par dire que cette partie du cinéma français est minoritaire, ce qui implique rapidement qu’elle est élitaire, ce qui fait qu’on passe très vite à l’idée de décadence, et de celle-ci à celle de la destruction, de l’anéantissement, de l’effacement de ces marges. Cela, je le pense de plus en plus profondément, la logique en est si forte qu’elle m’apparaît comme absolue. Il y a des films qui ne devraient pas exister , qui n’existent que parce que quelques personnes s’obstinent on ne sait pas trop pourquoi… On a tous des moments d’ailleurs où on se demande pourquoi on continue. Je crois que je ne suis pas le seul à avoir ces moments de doute, malheureusement… Je vous admire et je vous envie de ne pas les avoir, mais je ne crois pas que cela puisse durer très longtemps.
M. D. – Je peux vous le dire, c’est nous, c’est Rivette le gagnant. J. R. – Nous serons les gagnants dans nos tombes.
M. D. – Non, non, ce n’est jamais complètement dans les tombes, c’est déjà là avant les tombes. Des tas de gens ont vu votre film et ils l’adorent, ça commence toujours comme ça, à l’envers.
J. R. – La question n’est pas que les films, à l’arrivée, soient aimés, à la limite c’est même pas qu’ils soient bons ni qu’ils soient réussis – parce que, finalement, l’idée de réussite n’est pas très intéressante, – la chose la plus importante c’est qu’ils existent avec une cohérence interne.
Initialement publié le 25 Mars 1982 dans le journal Le Monde