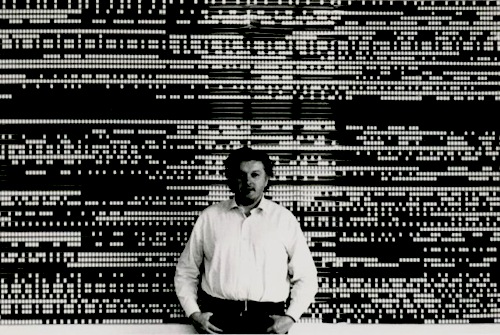
Peter Kubelka : Peut-être est-ce plus simple de l’expliquer historiquement. J’ai décidé, quand j’avais 17 ans, que je voulais faire du cinéma. C’était une vocation. J’étais absolument sûr que je ferais du cinéma même si, à cette époque, j’en avais vu très peu. Pendant quinze ans, plus ou moins, je n’ai fait que penser au cinéma, intensément. Jour et nuit, mon existence était consacrée à cela. Puis, en 1966, je suis allé pour la première fois aux États-Unis à l’invitation de gens comme Jonas Mekas et Stan Brakhage, que je connaissais déjà depuis des années. C’était alors par nécessité. Je ne pouvais pas finir Unsere Afrikareise parce qu’à cette époque, en Autriche, il n’y avait pas encore de système sonore adéquat pour faire un son optique. J’avais fait tout le travail créatif en Autriche, il ne restait plus que le montage final de l’original à faire. À New York, j’ai pu, pour la première fois, présenter personnellement mes films. C’était à la cinémathèque que Jonas a fondé sur la 46e rue, la New York Film Anthology. Ce fut un grand succès ! Cette conférence a immédiatement entraîné d’autres invitations, dont une de Harvard. Cette université organisait alors une série de conférences et ils m’ont invité à prendre la parole. Je leur ai dit : « D’accord, je peux présenter mes films, mais je ne fais pas de conférence. » Ils m’ont répondu : « Tu dois faire une conférence sinon, on ne peut pas te prendre dans ce programme-là. » J’ai donc accepté. Quelque temps avant la conférence, je suis allé à Harvard et ils m’ont installé dans une petite maison où, sans parler à personne, je me suis préparé d’arrache-pied. J’étais persuadé que ce serait la première et dernière conférence que je donnerais ! Mais ce fut comme un miracle : nous étions dans l’amphithéâtre du Corporate Center et c’était rempli à ras bord ! Ils ont dû retransmettre le son à l’extérieur où les gens attendaient. J’ai parlé pendant environ 3h30 en me disant que si c’était la seule, la première et la dernière conférence de ma vie, je devais dire tout ce que je pensais. Même si, quelquefois, je perdais le fil, ça c’est très bien déroulé. À la fin, j’ai même reçu une ovation et j’en ai pleuré ! Ma vie a changé ! Quelques mois avant, en Europe, j’étais dans une situation très difficile ; je n’avais jamais réussi, pendant 14 ans, à gagner ma vie avec mon travail. C’était absolument… désastreux !
HC : Mais, à partir de 1966, il faut attendre 11 ans pour avoir un autre film, soit Pause !, un film atypique dans votre œuvre. Vous vous êtes donc consacré exclusivement aux conférences ?
Peter Kubelka : Après cette conférence, j’ai eu beaucoup d’autres invitations et j’ai effectivement commencé à en accepter beaucoup. J’ai aussi pris part à diverses discussions dont le principal enjeu était de savoir si le cinéma était vraiment un Art ou un art mineur, un art qui ne serait finalement que reproduction mécanique des choses que l’on fait déjà au théâtre. J’ai cherché à m’armer intellectuellement quand j’ai compris une chose : que mon éducation n’était pas suffisante. Mon éducation scolaire était mauvaise, comme celle que l’on reçoit dans toutes les écoles. En autodidacte, je suis allé chercher toutes les choses qui me seraient utiles. L’une d’elles consistait à dégager les critères qui font que les autres Arts (peinture, sculpture, etc.) sont reconnus comme tel. Alors, j’ai réétudié la musique que j’avais découverte grâce à mon père, un très bon violoniste professionnel. Par ma mère, j’ai découvert la littérature : elle avait des livres de poésie allemande et je les ai tous lus avant mes 18 ans. Et puis, j’ai aussi été exposé à la cuisine, mais en ce temps-là, je ne considérais pas cette discipline comme l’un des Arts. Pour raccourcir, à partir de 1966-1967, j’ai commencé ces études pour défendre le cinéma. Je suis donc revenu à la musique et puis à la peinture, à l’architecture, à la littérature. J’ai utilisé toutes ces disciplines dans mes conférences et, à un certain point dans ma vie, est venu ce que j’appelle ma dé-spécialisation. J’ai consciemment décidé de ne plus être un spécialiste.
HC : Vous avez donc cessez d’être un cinéaste…
Peter Kubelka : Un cinéaste ou un théoricien. J’ai voulu me libérer de ces définitions que l’on retrouve maintenant sur les épitaphes. Sur votre tombe, on inscrit votre profession ! Cet acte trouve son origine dans un problème que j’ai toujours : comment défendre l’individu contre la société, contre l’ensemble. Mon exemple de toujours est de prendre l’alouette, un oiseau que j’aime beaucoup. Si l’on prend une alouette et on lui demande si elle peut chanter, elle répondra : « Naturellement que je peux chanter ! Je suis une alouette et toutes les alouettes savent chanter ! » Si l’on pose la même question à un être humain, il répondra : « Vous savez, j’appartiens à une espèce qui chante – parce que l’être humain peut chanter – mais moi personnellement je ne chante pas. Il y a des spécialistes qui dédient leur vie entière à la pratique du chant et ils le font tellement bien que ça ne vaut pas la peine que moi je chante. Alors j’assiste à des concerts de gens, de spécialistes. » . C’est partout la même chose : l’être humain normal est spécialisé et consomme les œuvres de professionnels, de virtuoses. Ce n’est certes pas idéal. Naturellement, on ne peut pas tout faire comme un virtuose. Mais là, la virtuosité devient aussi questionnable. Maintenant, par exemple, je m’intéresse beaucoup aux arts appliqués parce que, avant, tous les arts étaient appliqués. Il n’y avait pas cette idée de l’art libre, esthétique, etc., qui n’est de toute manière pas tout à fait libre aujourd’hui non plus. L’art, ça sert à quelque chose ; l’art doit toujours servir à quelque chose. Mais la question de la virtuosité, de la spécialisation amène aussi cette séparation entre l’art que tout le monde fait, l’art populaire, et l’art où la virtuosité commence, l’art d’artiste. On dit maintenant « arts folkloriques », ce qui est péjoratif ! Quand j’ai commencé cet acte de dé-spécialisation, je n’avais pas encore les idées très claires, mais l’idéal était de redevenir tel un enfant qui n’est pas encore spécialisé et d’être ainsi ouvert à toutes les possibilités que l’animal humain possède… Pour revenir à votre question, c’est ça qui est derrière cette série de conférences. Par contre, ici [à la Cinémathèque québécoise], je n’ai pas touché à tous les aspects de mon travail. Par exemple, il n’y avait pas de musique, il n’y avait rien sur les aspects ethnologiques et archéologiques de mes recherches, que j’ai beaucoup développés au cours des dernières années. J’ai commencé une collection – que j’appelle « didactique » – d’outils et d’instruments de musique. J’ai aussi commencé à travailler sur une théorie de la naissance de l’art qui peut prendre la forme d’un entonnoir, que l’on regarde par le grand bout. C’est un peu comme le Big-Bang en astrophysique : tout se réunit, toutes les disciplines de l’humanité, quand on va vers la préhistoire et la protohistoire, se recoupent en une seule discipline ! Par exemple, on a beaucoup parlé de ce phénomène de la sanctification de la vie chez les Amérindiens. C’est là un aspect très intéressant que l’on retrouve partout, dans toutes les civilisations et à différentes époques. La vie normale était en même temps sérieuse et comique, sanctifiée et érotique, poétique et efficace, il n’y avait pas un travail qui n’était pas aussi poétique, qui n’était pas aussi de l’art. Il n’y avait pas un outil qui n’était pas sacré ! C’est un peu comme si on fait de la musique ancienne, gothique. C’est ce que j’ai fait au début de ma dé-spécialisation : j’ai repris mes études musicales, j’ai continué mes études de flûte à bec, de la flûte à bec baroque. De la flûte à bec baroque je suis passé à la flûte à bec renaissance et ancienne (Moyen Âge) et j’ai étudié la musique ancienne. Là, on rencontre ce phénomène qui veut que, par exemple, un musicien qui a bien compris la pensée musicale de Schubert, qui a bien intériorisé la musique romantique, peut avoir d’énormes difficultés à interpréter Bach. Si on exécute la musique de la Renaissance avec une sensibilité d’après Schubert, d’après Beethoven, c’est une catastrophe ! En musique, il y avait ce mouvement qui était de reconstruire la musique ancienne, musique qui a pratiquement disparue avec la mort de Bach en 1750 parce qu’une nouvelle génération d’instruments est venue qui pouvait jouer forte et piano. Le piano est arrivé et il a détruit le clavecin, et la musique ancienne a été oubliée pour à peu près cent ans. Après ça, on a voulu retrouver cette musique et il a fallu encore cent ans pour qu’on puisse bien la réécouter. Pour cela, il a fallu pratiquement changer la pensée musicale, comme lorsqu’on change de langue, passant de l’Allemand au Français : il me faut changer ma pensée d’une langue à l’autre. Ç’est un travail qui m’a pris des années et des années ; un énorme travail historique, mais aussi un travail émotionnel et artistique, pour pouvoir me mettre dans la tête d’une personne qui a vécu au néolithique ou au paléolithique…
HC : Et qui ne connaissait pas l’histoire ! Par exemple, quelqu’un qui joue Bach aujourd’hui, il a beau se mettre dans la tête tant du spectateur que de l’interprète de l’époque, avec les mêmes instruments, etc., il ne peut pas s’empêcher d’avoir dans les oreilles Michael Jackson, etc.
Peter Kubelka : Mais il faut oublier ! Si l’on exécute Bach, il faut qu’on élimine toutes ces découvertes de la musique faites après lui.
HC : Il faut aussi le faire quand on l’écoute. Et le cinéma, c’est la même chose. Quand on écoute un film des Frères Lumières, il faut oublier ce qui vient après.
Peter Kubelka : Voilà ! Oui, c’est exactement cela !
Notre voyage en Afrique
HC : Nous aimerions maintenant parler de l’histoire du cinéma. Comment vous situez vous vous-même vous dans cette histoire du cinéma que vous connaissez très bien ? Vous avez été pendant des années directeur du Filmmuseum de Vienne. Votre réflexion semble se situer dans le sillon des réflexions qui furent celles de Vertov et d’Eisenstein, c’est-à-dire une réflexion sur la spécificité du médium. On sait que vos films ont eu, dans l’avant-garde américaine, une influence extraordinaire, qu’ils ont été vus, revus et analysés par des gens comme Paul Sharits, Conrad et Snow. C’est évident qu’ils ont vu vos films et que leurs œuvres en sont imprégnées. Comment, essentiellement, pensez-vous que vos films se situent par rapport à ce qui s’est fait avant et surtout après ?
Peter Kubelka : C’est difficile de répondre. C’est difficile, vraiment, de s’avancer sur la position historique qu’on occupe mais, pour moi, j’ai toujours voulu aller à l’essence du cinéma et je crois que je l’ai fait. Mais je crois sincèrement que l’évolution de mon travail n’est pas finie, qu’il y a encore des choses inachevées. Je suis étonné que Unsere Afrikareise n’ai pas eu plus de succès. Pour moi, Afrikareise est, dans son genre, le film sonore le plus intense qui existe. Vertov et Bunuel avaient travaillé déjà avec ce même postulat, à savoir que le synchronisme naturel n’est pas l’idéal, qu’il y a possibilité de séparer ce synchronisme naturel et de parler à travers un son qui n’est pas celui qui va naturellement avec l’image. C’est là la grande possibilité du film sonore. Bunuel dans L’âge d’or, qui est un monument incroyable, vraiment merveilleux, utilise ce principe pour construire cette séquence de la vache qui s’en va tandis que la femme reste là. Il conserve le son des cloches de la vache et, visuellement, coupe à l’amant qui rencontre un chien. Les deux sont unis par les sons de cloches ! C’est miraculeux ! L’autre film, c’est Enthousiasme de Vertov. Dans cette scène, au début du film, il juxtapose les gens qui se tuent à force de boire avec ceux qui refusent de vivre parce qu’ils sont trop religieux. Il met le son des buveurs avec les gens qui montent à l’Église et les chants religieux avec les buveurs. Vertov a juxtaposé des blocs ; ce n’est pas un synchronisme naturel. Dans Afrikareise, le son et l’image sont, comme dans la nature, en synchronisme naturel. Quand le son fait comme ça [il frappe dans ses mains], l’image fait comme ça [il frappe encore, mais sans bruit ; il mime le son] ! Le son devient le portrait acoustique de l’action visuelle. Quand rien ne change, quand rien ne bouge, il n’y a pas de son. Le son naît seulement quand il y un mouvement, une action, un changement de situation. Physiquement, on sait que le son est un mouvement de l’air causé par le mouvement des corps solides. La manière dont un corps solide se meut donne sa forme au son. Notre mémoire de compréhension de l’univers travaille avec ça. Si un mouvement a un certain rythme, une certaine forme, et que je trouve un son qui a la même forme, qui rime pour ainsi dire, c’est, dans mon esprit, le son naturel. Dans Afrikareise, si vous le regardez attentivement, chaque mouvement d’un corps, d’un animal, d’une main ou d’une plante correspond au son, comme si ce dernier était créé par ce mouvement. C’est différent de Vertov : mon film est pour ainsi dire un film naturaliste artificiel. J’utilise la disposition du spectateur à croire au synchronisme. Dans mon film, on voit un homme qui vise avec un fusil et qui tire. Il y a d’abord le moment du tir, puis le mouvement très rapide du recul. Par association, le spectateur sait que l’homme dans le film a tiré. Il y a là l’essence du tir. Si, par exemple, je n’entends pas le tir parce que je suis dans une cage de verre insonorisée, en voyant ce mouvement je sais qu’on a tiré. C’était le raisonnement de Copernic qui était convaincu que, puisque les astres bougent, ils doivent faire un son ; ce qu’on a appelé la musique céleste. C’est très joli. Mais revenons à mon exemple du fusil. Dans le visuel, j’ai un tir. Maintenant je peux utiliser ce tir visuel pour parler avec un son. J’ai donc mis le son de la voix de l’un de ces messieurs qui écrit son journal. Il dit : « So ! » qui veut dire « Alors ! » en allemand. De sa voix de comptable, il dit : « On a fait, ça et ça, etc. » J’utilise ce son comme portrait exact de l’émetteur. Alors, j’ai combiné, ou juxtaposé, ou synchronisé, le tir mortel du fusil avec ce « So ! » d’une indifférence toute petite bourgeoise qui lui fait écrire : « Cher journal, on est maintenant en Afrique et, bla, bla, bla… »
HC : Au-delà du synchronisme, il y a là un commentaire. Sémantiquement, il y a là une prise de position, un contenu !
Peter Kubelka : Oui ! Mais ma position est articulée à travers ce synchronisme artificiel où j’utilise cette disponibilité du spectateur d’accepter un acte qui est synchrone entre le visuel et le sonore comme étant vrai. Visuellement, c’est très violent. On voit qu’il a touché l’animal mais le son, ce « So ! » est tout à fait indifférent. Et tout le film est construit comme ça. Ce ne sont pas des grands blocs comme ont fait les ancêtres Bunuel et Vertov, mais pratiquement un documentaire tout à fait synchrone, comme Leacock l’aurait fait avec ce synchronisme permanent, mais artificiel. Avec cet artifice, moi, je parle ! Je n’ai jamais vu un autre film qui soit comme cela. Il y a beaucoup de choses qui sont mises là puisque j’ai travaillé cinq ans pour ces douze minutes.
HC : Unsere Afrikareise a toujours été traité comme un document sur la situation coloniale, du rapport entre la bête, l’Africain et le colonisateur, etc. Ce sont des choses qui sont évidemment dans votre film, par exemple quand vous avez cet Autrichien qui tire, puis une coupe sur l’Africain et, tout de suite après, une bête qui agonise. On a là une description assez directe de la situation coloniale et du voyage exotique en Afrique. Croyez-vous que l’on a trop insisté sur cette dimension et pas assez sur son articulation, sur sa forme ?
Peter Kubelka : Toutes les critiques sérieuses, jusqu’à aujourd’hui, n’ont pas été faites en langue allemande. C’est très difficile parce que l’on ne peut pas traduire cette langue populaire et parce que j’utilise le langage dans toutes ses facettes, avec la forme des mots. C’est comme de la bonne poésie : intraduisible. Il faudrait peut-être qu’une étude soit faite par un linguiste et un cinéaste qui travailleraient ensemble. Il faudrait aussi faire l’étude sur la table de montage.
Entre deux choses : une métaphore
HC : Vous en parliez lors votre troisième conférence portant sur la cuisine comme l’un des beaux-arts : aujourd’hui, nous sommes capables de fabriquer des aliments où le goût, où chaque goût, ressort de façon très prononcée. Cependant, il n’y a pas ce phénomène que vous appelez « l’objet trouvé ». Par exemple, l’Amérindien qui a trouvé, par hasard, la sève de l’érable dans la neige et l’a porté à sa bouche, par opposition au produit contemporain qui fait ressortir tous les sucres, naturels ou ajoutés. Il y a cette beauté de l’objet trouvé, de l’objet originel. Pourquoi revenez-vous sans cesse sur cette idée de l’origine en art ?
Peter Kubelka : J’ai insisté sur cette première rencontre avec « l’objet trouvé » – de la sève qui, naturellement, est tombée sur la neige. Maintenant, le sirop est fabriqué beaucoup plus condensé, plus fort tout comme la glace. C’est là un événement très fort, plus articulé, mais l’objet trouvé, l’acte original préparé par la nature, est compris et identifié par la personne publique/artiste. Ces deux entités viennent aussi ensemble dans l’Antiquité : l’artiste et le public sont la même personne et l’artiste travaille donc pour lui-même. Il n’y a cependant rien de plus grandiose qu’une œuvre d’art trouvée, qui communique et que je peux lire, mais dont la création n’avait pas d’autres moyens, ni d’autre finalité, que sa propre existence. Si on peut lire la poésie dans l’univers tel qu’il est, c’est l’art le plus grand. Mais comment communiquer ce savoir à un autre ? C’est là le problème premier de l’artiste comme nous le voyons, l’artiste actif qui fait quelque chose, qui naît. Et peut-être que le premier acte artistique a été de faire cela : de créer une œuvre d’art en faisant ce geste [il pointe du doigt] : pointer avec un doigt quelque chose alors que le regard de l’autre suit cette indication et comprend l’œuvre qui est là.
HC : C’est un peu comme une projection de cinéma.
Peter Kubelka : Non ! C’est l’activité d’un artiste, si ça fonctionne.
HC : C’est donc la fonction de l’art.
Peter Kubelka : …de pointer une chose, oui ! Revenons à mon film, qui peut sembler être l’autre extrémité du développement des arts. En vérité, je ne fais que pointer des choses. Parce que je ne commente pas ces choses dans mon film – c’est très important – je vous montre toujours deux choses. C’est cette métaphore entre deux choses : entre son et image, ou entre image et autre image, ou entre son et autre son. C’est ce que je montre, à vous de comprendre. Je ne fais que pointer. Et moins c’est nécessaire, mieux c’est.
Qu’est-ce que le cinéma ?
HC : Revenons maintenant à cette idée du cinéma non industriel. Que voulez-vous dire par là ?
Peter Kubelka : Il y a d’abord cette erreur qui veut que l’artiste ait des obligations face à la société, qu’il ne doit pas créer pour lui-même. C’est vrai dans une certaine mesure, mais c’est également faux. D’un côté, vous avez l’artiste qui travaille pour lui-même, qui se prend comme juge et qui travaille moralement à dire la vérité. Il prend une position qui n’est pas arrogante du tout, parce que c’est une position valide pour quiconque cherche à comprendre quelque chose. De l’autre côté, vous avez les films publicitaires qui ont pour but de tricher puisque, par nature, la publicité est mensonge. On peut toujours les entendre dire : « Oui, oui, j’ai fait ces conneries, mais c’est pour l’argent… » Ce n’est pas l’artiste qui est arrogant, ce sont eux ! Il faut comparer l’artiste à un homme de science qui veut trouver un résultat. Mais cette distinction entre cinéma « industriel » et « non industriel » vient du fait que l’on me qualifiait « d’expérimental ». J’ai toujours détesté ça, c’est absolument sans respect ! Le cinéma, son industrie, opère consciemment cette marginalisation. Par exemple, un poète comme James Joyce, personne n’ose le qualifier « d’expérimental » !
HC : C’est toute l’ambiguïté de la notion d’auteur au cinéma. Il n’y a pas de littérature dite « d’auteur » puisque c’est implicite, que c’est là une tautologie.
Peter Kubelka : L’industrie, quand elle accepte les cinéastes « expérimentaux », elle le fait en se disant qu’elle peut utiliser ce travail à son avantage : c’est simplement de la récupération. J’ai essayé de repousser cette marginalisation puisque, pour moi, ce sont eux qui sont à côté, ce sont eux qui font un cinéma que je qualifie « d’industriel ». Les motifs sont économiques : investissement d’argent et récupération d’argent. Ça force donc naturellement le réalisateur à parler un langage que, déjà, tout le monde parle. Billy Wilder a déjà dit que faire du cinéma à Hollywood, c’est comme faire des voitures à Détroit. Il a parfaitement raison. Cela dit, il y a de belles voitures !
HC : Et des voitures différentes ! Les voitures construites par Wilder sont infiniment plus belles que celles de Fleming, par exemple.
Peter Kubelka : Oui, mais les voitures, je ne les crois pas capables de transporter mes pensées à un niveau plus intéressant.
HC : Mais si l’on prend Wilder, il y a de ses films qui, au-delà d’un simple plaisir, nous disent des choses sur les États-Unis, par exemple.
Peter Kubelka : Oui, mais c’est là un autre champ. Je dirais même que c’est un autre art, motivé par autre chose. C’est un autre monde.
HC : Est-ce que vous croyez à une liberté au sein du système industriel de production ? Les Français, par exemple, ont revendiqué cela à une époque, tout comme le cinéma étatsunien dit « indépendant » aujourd’hui.
Peter Kubelka : Je n’aime pas ces mélanges ! J’aime les extrêmes pour ainsi dire : soit un cinéma qui s’occupe d’intelligence et de spécificité du médium, soit un film pleinement hollywoodien, avec ses grands moyens, son spectaculaire et sa stupidité de découpage, la banalité de son contenu, etc. C’est soit ce spectacle intéressant, soit c’est Brakhage, Snow, moi et quelques autres.
HC : Mais il y a des cinéastes comme Godard, Bergman, Tarkovski et toute une pléiade de cinéastes d’un intérêt énorme ! Que faites-vous de ceux-là ?
Peter Kubelka : Godard m’ennuie. Bergman aussi, ainsi que tout ce cinéma français des cinquante dernières années qui est ni vraiment spectaculaire, ni vraiment intéressant. Mais bon, cela peut exister.
HC : Et heureusement, cela existe !
Peter Kubelka : Vous savez, celui qui a détruit le cinéma en France c’est le producteur libéral qui a dit : « Bon, M. Godard, vous pouvez exprimer toutes les philosophies que vous voulez, du marxisme au maoïsme, mais faites-moi 90 minutes avec une jolie fille et un peu d’amour et nous allons vous financer. » Ce fut la chute du cinéma français. Ce qui est venu ensuite, c’est ce cinéma entre deux mondes. On parle toujours du meilleur des deux mondes, mais en réalité ils ont le pire des deux mondes : moins intellectuel que ce que l’on pouvait écrire et donnant moins à voir que ce qu’Hollywood arrivait à faire.
HC : Mais justement, n’est-ce pas là l’idée du « entre » qui vous est si chère ?
Peter Kubelka : Tout ce cinéma me m’intéresse pas. Mais Jean Rouch, même si j’avoue ne pas bien le connaître, je partage avec lui un grand intérêt pour l’ethnologie. Mais je ne veux pas poser le Jugement dernier sur le cinéma. Et puis je ne peux pas être un juge objectif. J’ai cessé de prétendre à l’objectivité. Maintenant, ma position est simple : je suis moi-même un artiste et, en vérité, je n’aime personne sauf mon œuvre et quelques exceptions.
De la beauté sensuelle du film
HC : Quand vous avez fondé le Filmuseum de Vienne, c’était « pour voir des films ». Qu’y programmiez-vous ?
Peter Kubelka : La Cinémathèque a aussi une histoire complexe… Je n’ai pas pu réaliser la cinémathèque que je voulais, et cela pour des raisons extérieures, comme le financement, et intérieures, comme les relations avec mon co-directeur et nos divergences de vues. J’ai donc commencé par projeter ce que j’aimais : Dreyer, qui a pourtant fait des longs-métrages de fiction et qui devrait donc tomber dans cette catégorie de films dont je parlais plus tôt. Il a pourtant été un très grand modèle pour moi, et j’ai énormément d’admiration pour lui. Je n’ai jamais tenté de faire un cinéma comme le sien, parce que ça ne se fait pas, mais j’aime beaucoup ses films.
HC : On peut cependant sentir son influence dans un film comme Mosaik Im Vertrauhen.
Peter Kubelka : Non, non, je ne crois pas : personne ne peut faire comme les acteurs de Dreyer…
HC : Lors de votre première conférence, vous avez parlé rapidement de ce qu’il est convenu d’appeler « les nouveaux médias » et de leur rapport au cinéma. Pour des raisons d’abord financières, beaucoup annoncent la « mort du cinéma », à tout le moins comme médium sur film.
Peter Kubelka : Je ne crois pas que ce soit une mort. Ce sera peut-être un assassinat de la part de l’industrie qui est tentée d’arrêter la production de la pellicule. Ce serait un assassinat parce que le cinéma n’est pas achevé ! Il est encore jeune et a des possibilités absolument incroyables ! Pour reprendre un exemple connu, ce fut la même chose avec la peinture au moment de la naissance de la photographie. Beaucoup de gens ont pensé que c’était la fin de la peinture parce que la peinture de cette époque était essentiellement académique et se préoccupait beaucoup de la réalité par la recherche du naturalisme, etc. Mais, au contraire, ce fut la naissance de l’art moderne ! Déjà, les impressionnistes avaient peint des réalisations visuelles qui échappaient jusqu’alors à la peinture.
HC : Mais on trouve très peu d’œuvres faites dans ces « nouveaux médias » qui ne soient pas d’abord motivées par une pensée technique habillée d’un discours esthétique. On nous vend la vidéo et le numérique comme l’évolution du cinéma, alors que c’est faux. On a parfois l’impression que les « nouveaux médias » n’ont fait que récupérer le langage du cinéma et lui imposer en retour certains tics esthétiques, comme la recherche à tout prix d’un surplus de réalité. Où trace-t-on la limite entre des médiums qui sont distincts ?
Peter Kubelka : Quand j’enseignais le cinéma, j’ai toujours fait commencer mes nouveaux étudiants avec du Super-8. J’exigeais d’eux qu’ils fassent avec ce format quelque chose qui ne soit en rien inférieur au 16mm, mais qui toucherait en même temps à quelque chose que le 16mm ne pouvait faire. Avec le Super-8, on ne peut pas couper, on ne peut pas vraiment faire de montage. Si on veut un film qui soit parfait sur l’écran, il ne faut pas couper parce que toute coupure sera visible, et le film aura l’air de deuxième ordre. La loi : trois minutes sur l’écran = trois minutes dans la caméra. Cet exercice demandait une énergie et une mémoire extraordinaire, parce que les étudiants devaient toujours savoir la durée de chaque prise, quelle était la dernière image, qu’est-ce qu’ils avaient fait au début de la bobine, etc. Cela ressemblait au travail du sculpteur avec la pierre : une fausse attaque de la pierre et tout est fini ! Avec le Super-8, c’est pareil : une fausse image et c’est gâché, impossible de corriger ! Si vous faites la même chose avec la vidéo, toute cette tension n’existe plus puisque l’on peut se reprendre. Il n’y a pas cette économie, cette conscience des coûts en argent sonnant. Quand on fait de la vidéo, le temps coule, et coule, et coule, et coule… Quand on fait du cinéma, on entend chaque cadre « trrrrrrrrrrrrr ». Le résultat est complètement différent. Quand on a un film, même en Super-8, la beauté sensuelle est beaucoup plus grande que celle de la vidéo.
HC : La question qu’on peut alors se poser dans les cinémathèques – et on la pose – c’est celle de l’archivage : Va-t-on transférer sur support numérique les archives, et ainsi les rendre plus facilement accessibles et échangeables ? Par exemple, il arrive que les professeurs doivent présenter des films sur DVD, parce que la copie film de l’institution est dans un état pitoyable, pour autant que l’institution ait cette copie film. Et souvent les étudiants ne semblent pas voir la différence. Dès lors, le cinéma perd-t-il réellement quelque chose à être projeté en numérique ?
Peter Kubelka : En fait, c’est le plus grave problème auquel j’ai été confronté lors des rencontres annuelles de la FIAF (Fédération internationale des archives du film) depuis 1964. C’est une guerre entre deux groupes. Il y a un groupe qui dit : « Nous allons transférer tout ce que nous avons sur support vidéo et nous n’aurons plus de problème de feu, de dégénérescence de la pellicule, etc. » Il y a l’autre groupe qui dit : « Le cinéma doit rester le cinéma, le support doit rester celui du cinéma. » Avec le temps, je suis devenu l’un des derniers – et peut-être le plus radical – porte-parole de ce groupe malheureusement minoritaire. J’ai la conviction que les cinémathèques ne conservent pas le contenu. C’est l’erreur la plus catastrophique des conservateurs. Le contenu n’existe pas ! Personne n’a jamais touché physiquement un contenu. Le contenu est indissociable du matériel dans lequel il est inscrit et, si l’on transfert le cinéma sur un autre support, on perd donc le contenu ! Naturellement, il y a certaines catégories de cinéma ou cette perte est moins grande.
HC : Votre cinéma, par exemple, est impensable sur support vidéo !
Peter Kubelka : Mon film Arnulf Rainer sur une télévision c’est… c’est…
HC : …C’est une anomalie !
Peter Kubelka : Exactement ! Ça ne fait aucun sens ! Encore une fois, il y a différentes catégories de cinéma. Mais même un film très littéraire, hollywoodien, perd du contenu lorsqu’on l’écoute sur une télévision. C’est très important ! Ça rejoint ce que je disais plus tôt sur le rapport entre Super-8 et vidéo : pour faire un film sur film, disons dans les années 1930 ou 1950, le metteur en scène et l’opérateur devaient être beaucoup plus intenses. Bien sûr pour des raisons économiques, mais aussi parce qu’ils ne pouvaient pas voir immédiatement le résultat, ce qui est possible en vidéo. Dreyer devait attendre trois jours pour voir ses rushes. Pour ce qui touche les archives, nous devons d’abord nous demander : Pour qui conservons-nous le cinéma ? Pour les producteurs ? Eux ne conservent que pour l’argent. Ils ont détruit un immense pan du cinéma muet dans les années 1930, croyant pouvoir mieux rentabiliser une nouvelle version parlante qu’un muet au potentiel commercial épuisé. Seulement, avec la télévision, ils ont compris que l’on peut faire de l’argent avec de vieux films, et maintenant ils conservent tout. Et malheureusement, c’est leur idée qui domine : nous conservons pour un public payant, en vue d’une utilisation commerciale. C’est très difficile de faire comprendre aux directeurs de musées et aux États qui subventionnent ces cinémathèques que nous conservons pour l’archéologie. Nous préservons pour les générations futures qui voudront comprendre ce que les cinéastes ont pensé en faisant leurs films. Par exemple, si aujourd’hui on numérise mes films et que, d’ici cinquante ans, apparaissent au moins trois nouveaux supports sur lesquels on transférera encore les films, en 2050 il sera impossible de comprendre ce que j’ai voulu faire avec mon œuvre. Les sources seront perdues parce que c’est la pellicule qui m’a enseigné quoi faire. Par exemple, quand je parle de la musique ancienne, la musique du Moyen Âge. On peut la jouer sur une flûte d’époque, mais on peut aussi la jouer sur un synthétiseur ! Cette mélodie du Moyen Âge, jouée sur un clavier, est très facile à interpréter, au point que l’on peut dire qu’il s’agit d’une musique primitive qui, lentement, a évolué vers notre musique savante… Ça donne tout de suite une position condescendante envers le passé. Seulement, quand on reconstruit des instruments comme ceux utilisés au Moyen Âge, cette mélodie devient très difficile à jouer et surtout très belle. Ajoutez à cette musique, le jeu de l’architecture avec son écho, en contraste avec l’arrondissement sonore numérique. On peut alors comprendre le génie de cette musique. Je crois fondamentalement à ce lien intrinsèque entre l’œuvre, son contenu, et le matériel dans lequel il est inscrit. Du cinéma aux « nouveaux médias », je suis contre cette idée qu’il s’agit d’un progrès ou d’une succession. Il s’agit de voix parallèles qui, en même temps, peuvent coexister. Les gens qui travaillent avec ces « nouveaux médias » ont encore à découvrir leur noyau dur. C’est le même travail que nous avons fait pour le cinéma. Et puis la longévité physique du film est de loin supérieure à celle de la vidéo. Une loi de la nature veut que plus un média est jeune, plus courte est sa durée de vie : la pierre dure des millions d’années, le bois des milliers d’années, la toile des centaines d’années, la photographie déjà moins, et la vidéo ne se conserve même pas dix ans ! C’est catastrophique ! Et les systèmes de lecture sont liés à la survie des grandes corporations qui les fabriquent ! Par exemple, réparer un ordinateur que l’on utilisait il y a vingt ans est devenu impossible. Les problèmes d’archivage des nouveaux médias semblent donc beaucoup plus grands que ceux du film.






