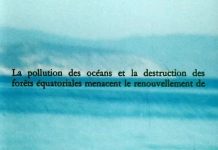Le 15 mars 2011, yann beauvais s’exile définitivement au Brésil. Dès qu’il me l’a appris, je me suis dit, : il faut absolument que nous l’interrogions sur ses décennies de pratique – de la réalisation à la diffusion – qu’il a eu de cinéma expérimental en France et ailleurs. Rendez-vous fut rapidement pris. Et voici ce que cela a donné :
YT : Vu tes multiples activités, comment t’auto-définis-tu ?
YB : Ça dépend du contexte. Si je suis dans le milieu du cinéma, je mets en avant ce que j’ai fait dans le champ du cinéma. Si je suis dans un domaine qui a trait à l’homosexualité, ça sera cet aspect-là.
YT : La première fois que j’ai entendu parler de toi, c’est en tant que distributeur de films expérimentaux.
YB : J’ai fondé Light Cone au début des années 80 parce que j’étais cinéaste. J’ai commencé à faire des films au début des années 70 et il m’a semblé très rapidement qu’en France, on ne pouvait pas simplement être cinéaste expérimental. À cette époque, c’était impossible il fallait donc se donner les moyens d’avoir des lieux spécifiques qui puissent permettre à ce cinéma d’exister. Et je n’étais pas satisfait des batailles qui existaient entre deux groupes, le Collectif Jeune Cinéma et Paris Film Coop. Ces lieux de cinéma expérimental avaient comme particularité de se focaliser autour d’une bataille de chefs. Les jeunes cinéastes étaient victimes de ces batailles d’ego. L’alternative, c’était de concevoir un autre espace et au lieu de travailler sur l’exemplarité, de façonner un héros, il me semblait plus important de permettre aux cinéastes de faire circuler leurs films et surtout de mettre en rapport, ce qui n’était pas fait à l’époque, le cinéma français avec la production étrangère. Et pas simplement pour voir les films une fois mais pour qu’ils soient en distribution et que cela permette d’autres échanges.
_
Je n’aurai pas assumé si facilement la réalisation de films expérimentaux si je n’étais pas homo. Faire du cinéma expérimental dans les années 70, cela signifie bêtement s’élever contre la domination outrancière du cinéma de la Nouvelle Vague et c’est aussi se positionner contre un autre genre très présent dans ces années-là, le cinéma militant. Faire de l’expérimental était la pire chose que tu pouvais souhaiter. Tu étais méprisé. Résister à cela, affirmer sa différence, j’avais dû le faire avec l’homosexualité. Quand on défilait dans les manifs du 1r mai et que nous étions les folles en pantalon blanc, le service d’ordre de la C.G.T. et du P.C. nous tombait dessus à bras raccourcis. Ayant dû me façonner et me prémunir contre cet état de fait, ce n’était pas plus difficile à faire dans le champ du cinéma expérimental.
YT : À l’époque, j’avais fait un travail sur les débuts, 1951-1958, des Cahiers du Cinéma, je me rappelle qu’ils étaient violents et méprisants avec le cinéma expérimental.
YB : Autre chose. Je ne suis pas tout-à-fait de Mai 68. Je suis d’après. J’avais 14 ans en 68. Les questions idéologiques, je ne les résolvais pas de la même manière. Il était plus important, plutôt que d’appartenir à une idéologie spécifique, d’essayer de faire fonctionner les choses. Il fallait établir un fonctionnement dans lequel il pouvait y avoir des luttes mais dont la lutte ne soit pas le moteur, lutter pour la reconnaissance de nos pratiques en acceptant des tendances diverses. À Light Cone se mêlait des pratiques. En 1974, j’ai aussi participé à la naissance du Gai Pied. Pour moi, l’essentiel est d’être plusieurs choses simultanément, d’avoir plusieurs axes à partir desquels m’investir, me lancer. Au moment où on a créé Light Cone, les temps étaient difficiles pour le cinéma expérimental dans la mesure où la découverte de l’art vidéo, son instauration comme un art par les musées, ont fait que ce qui relevait d’un cinéma radical a été jugé comme antique, dépassé, n’existant plus. Il n’y avait vraiment pas d’argent pour ce cinéma. Ce fut une traversée violente, dure. Light Cone a été essentiel parce que ça a permis de maintenir, de générer, de montrer, de découvrir des cinéastes et aussi de favoriser l’éclosion de certains. Je voulais, outre faire découvrir des cinéastes étrangers, forcer le monde de l’art à l’accepter comme une pratique artistique. C’est une bataille que j’ai menée rondement. Cela m’a été reproché aussi parce que cette reconnaissance a fonctionné. Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait rien puisque Peter Kubelka, en 1975, avait réussi à ce que le Centre Pompidou ouvre avec une collection de films expérimentaux à travers une manifestation Une Histoire du cinéma.
YT : Avant Light Cone, les films expérimentaux ne passaient que dans des festivals et des cinémathèques, après, partout.
YB : C’est ça, l’activisme qu’on a développé. Cela revêtait la forme d’une guérilla. Nous essayions d’occuper chaque position de territoire qui était possible pour permettre à ces films d’être plus largement vu. Et ça c’est fait…
YT : Et Scratch ?
YB : J’ai fondé Scratch qui était une émanation de Light Cone. C’était bien d’avoir des étagères où s’entassent les films, mais si les films restaient sur les étagères ca ne servait a rien. Donc il fallait les montrer. Et puis la troisième chose, c’était de créer une revue, parce que si on n’en parlait pas, ca revenait au même problème. Donc on a édité une revue en français et en anglais qui essayait de provoquer des échanges. Tout cela tendait à manifester l’existence de ces pratiques et à favoriser des passages. Par exemple de dire que telle exposition pouvait être rattachée au travail de tel cinéaste, donc montrer ses films, qui avaient entre temps pu être oubliés, et de pointer des liens possibles, et ainsi de suite. J’ai donc eu des soutiens divers, dont ceux de cinéastes, comme Paul Sharits ou Malcom LeGrice, autant que des partenaires dans des musées, qui étaient prêts a recevoir des coups, et a mettre en place, progressivement un rouleau compresseur , qui rendait ces films enfin visibles, pour les imposer. Une autre chose importante, c’est que lorsque nous avons fondé Light Cone, le punk était assez présent, et cela a changé beaucoup de choses pour le cinéma expérimental. Certains cinéastes structurels, par exemple, ne comprenaient absolument pas ce qui était en train de se passer, et le contenu de certaines revendications qui étaient totalement différentes et nouvelles. Il y a eu le cinéma des Femmes, le cinéma Homo, et cela a remis en cause un certain nombre de dogmes de ce cinéma, qui était surtout appréhendé dans une optique moderniste , et qui oubliait ce qui avait par exemple à trait au corps, au désir, ou a d’autres trucs plus tordus. Donc le punk a eu également une incidence sur les films, comme les mouvements de libération féministes et homos. Voilà des choses qui ont influencé ma réflexion a l’époque. Au même moment, dans les années 80, il y avait un certain nombre de réalités de l’Angleterre de l’époque Thatcher, des combats, qui n’étaient pas structurés comme ceux qu’on avait l’habitude de penser, par exemple, la question des minorités raciales. Et le cinéma expérimental devait se mettre au diapason de ce genre de chose, surtout en France, qui semblait coupée du reste du monde. Il fallait relier un certain nombre de choses.
YT : Il y a aussi les films junkies, avec le sur-désespoir, qui devient idéologique, dès la fin des années 70.
YB : Oui, sous couvert de Post-Modernisme, qui est un mot tarte a la crème, quelqu’un comme Paul Sharits s’est par exemple mis à cette période à faire des choses très trash autant dans ses peintures que sculptures que dans ses performances fluxus. Plus personne ou peu le comprenait, alors que pour moi ce qu’il faisait restait bien évidemment du Paul Sharits. Il y avait une lecture hygiénique de l’art qui faisait écran pour lui et pour beaucoup d’autres.
YT : Les faux-semblants ont sauté.
YB : Il y avait toutes ces remises en causes, très nourrissantes pour le cinéma, ainsi que tous les échanges provoqués par cette réouverture vers l’étranger. Pour les programmations par exemple, nous en faisions en France, mais il était important d’aller projeter ailleurs, en rapporter des films ensuite, et les montrer ici, ainsi de suite. Mais, j’avais une pratique un peu étrange du cinéma, à l’époque, qui était celle du multi-écrans. Même dans le champ du cinéma expérimental c’était souvent problématique, puisqu’à chaque nouvelle une salle, il fallait dérégler leurs dispositifs techniques précalibrés, pour pouvoir montrer des films à deux, trois ou quatre écrans. Obtenir un projecteur en état de marche, c’était possible, mais alors trois ou quatre, c’était l’enfer. Ces expériences m’ont beaucoup servi ensuite pour le travail de performance avec les musiciens. La capacité d’improvisation. Mais ces dispositifs multi-écrans étaient une stimulation créative personnelle, pas forcément une démarche provocatrice.Avec les musées, c’était encore plus compliqué, et donc ça a entraîné une volonté de briser certaines choses. Ca a déclenché dans les années 90, une recherche structurelle qui m’a porté du coté du cinéma d’installation. J’ai donc commencé a organiser des expositions de cinéma, dans des musées, où les historiques côtoyaient les artistes contemporains. Et ça a été un formidable détonateur. Des gens comme Pierre Huyghes par exemple n’arrêtaient pas d’appeler à Light Cone, ou chez moi, pour en savoir plus sur certains travaux, sur certaines choses que nous avions exposées. On a donc a aussi été utilisés, et récupérés, par la suite. Mais il y avait cette formidable énergie à cette période. Energie qui est bien sur aussi venue du fait d’avoir auparavant traversé les années 80 et ce qu’on en a dit.
YT : Lorsque tu programmais à L’Entrepôt, à Paris, par exemple, tu pouvais réorganiser l’espace ?
YB : Je me souviens du Groupe Shmelzdahin composé de trois jeunes allemands, dont Jurgen Reble, et la particularité de leur travail, c’est qu’ils ne voulaient pas entendre parler des projecteurs qui étaient dans la cabine, ils venaient avec les leurs, ils les installaient sur des tables, entre les sièges, ou au milieu de la salle. Ils amenaient aussi tout leurs outils, ustensiles et produits chimiques, pour faire des interventions en direct. La moquette de la salle venait d’être remplacée. Et ils utilisaient des produits de teinture et de virage, assez violents… La séance se déroule très bien, mais en repliant une table, ils ont fait une fabuleuse tache de décoloration sur la moquette toute neuve… D’autres fois parfois ils mettaient le feu à la pellicule… Ce qui a posé pas de problème lorsque Jurgen a fait une performance avec feu à l’auditorium du Louvre lors d’un cycle que l’on co-organisé là.
Oui, du temps de la fin de Frédéric Mitterrand, puis ensuite avec Carole Roussopoulos, on a eu beaucoup de facilités pour modifier la salle de cinéma, projeter en double écran, etc. Et le projectionniste était un mec génial, Bouba, qui depuis, est devenu photographe. Il photographie et reporte le mouvement et toutes les manifestations de Sans-Papiers. Il était d’une décontraction sans nom dans les situations injouables techniquement. On a vraiment pu inventer dans ce cadre. Et c’était aussi, un détail important, une salle qui n’avait pas de rideau, ni de cadre d’écran. Donc par exemple avec la projection super 8, on pouvait investir réellement l’espace de l’écran, s’y promener en quelque sorte. Projeter en décadrage. Ou projeter du 16mm depuis la cabine, et projeter simultanément le Super 8 depuis la salle.
YT : Le cinéma de Carole Roussopoulos est-il pour toi militant ou féministe ? Peux-tu décrire les rapports que vous aviez ?
YB : Le cinéma de Carole est avant tout militant, elle a travaillé dans cet activisme en tant que femme mais aussi en relation avec ce qu’elle vivait ce qu’elle partageait. La cause des noirs, le FHAR, le mouvement des femmes…
Je me souviens de l’avoir rencontré au moment ou elle reprenait l’Entrepôt et nous avons sympathisé et travaillé dans la mesure du possible en collaboration. Elle est son mari était deux personnes pour lesquelles j’avais beaucoup d’affection. À la mort de mon père, après une période un peu compliquée, alors que je pensais aller en Egypte pour me changer les idées, ils nous ont proposé leurs maisons à Spetsai où nous sommes allés une dizaine de jours en hiver. C’était absolument juste comme suggestion et incroyablement généreux. Cette ouverture aux autres se retrouve dans ses films.
YT : Tu filmes aussi beaucoup de manifs ?
YB : Oui , dans plusieurs de mes premiers journaux de la fin des années 70 et début 80, j’avais documenté les manifs gays. Edson Barrus a commencé vers 2006 un projet qui s’appelle Manifestons, ou il mettait des vidéos sur internet. Et maintenant il y en a plus de 600. Il filme des manifestations dans le monde entier. Parfois on filme ensemble, et parfois séparément chacun dans une ville. Et depuis un moment, certaines de ces vidéos, comme elles sont vues de nombreuses fois, deviennent des succès de You Tube. Elles deviennent des tubes, elles sont incoporées dans des Play List, en tête du site. Mais comme ce sont des manifestations, ils exigent des droits qui leur permettent de les censurer, puisqu’ils exigent des choses impossibles, comme l’autorisation de toutes les personnes filmées, ou celle des propriétaires des musiques diffusées. Cette plateforme est devenue un véritable laboratoire de travail, qui pose des questions de représentations, de censure, de diffusions de ces images. Techniquement, en plus, ça participe de l’expérimentation, puisqu’on filmait avec des caméras, et que maintenant on utilise un téléphone portable, ce qui donne des choses incroyables. Et puis les images circulent, elles réapparaissent sur des sites allemands, turcs, etc. Ce travail a donné envie a Edson Barrus de créer un autre objet qui s’appelle XORUME dans lequel il tisse plus de 140 films par page ouverte dans un site, et que l’on peut s’approprier et réinjecter.
_
La circulation permet une autre visibilité. C’’est la continuation d’une démarche coutumière au cinéma expérimental, celle de la capture, ou celle du tourné-monté. Il y a également des commentaires très spontanés qui apparaissent sous les vidéos, c’est intéressant si on compare ça aux séances dans les salles de cinéma, qui sont souvent très guindées. Il y a une autre violence, un autre type d’échange, qui pour moi continue de poser des questions de cinéma. Une des vidéos, celle de la manif pour défendre le groupe de Tarnac , a été extrêmement relayée. Puis d’autres sur Sakineh ont déclenché des affluences. Sur Internet, on peut associer des mots aux images, des tags, qui font que les gens vont tomber sur une image à partir de mots, lors de leurs recherches. Il faut aussi jouer avec ça. Je parle de tout cela, parce que ce sont des lisières. Ça n’est pas tout à fait le champ de l’expérimental, ni celui du cinéma, ou de l’art, mais ça n’est pas non plus du divertissement, c’est un autre territoire. Une autre pratique des images.
YT : Il y a moins de redondance dans les images que dans les textes, sur Internet. Par exemple, tout les articles sur la Tunisie semblent calquer la même dépêche AFP, alors que les vidéos amateurs mises en lien ont une variété de regards, et elles se placent à un autre niveau de l’évènement. Mais revenons à ta pratique du cinéma, et à ses débuts.
YB : J’ai véritablement commencé en 16mm, d’une façon étonnante, parce que j’ai fait une réduction de ma maîtrise, en 16mm, en inscrivant des textes, qui seraient vus, et qui nous pousseraient à penser comment fonctionne le cinéma. C’est mon premier film, une réduction d’un texte de 150 pages. Puis j’ai eu la chance de tomber sur une caméra 16mm qui ne m’a rien coûté du tout, aux Puces. Et il était relativement simple, en 1974, d’obtenir de la pellicule périmée. Le premier film que j’ai fait avec a été, malheureusement pour moi, bien apprécié dans le monde du cinéma expérimental. Ça s’appelait R, c’est basé sur une fugue de Bach. C’est devenu un double écran, puis triple, puis une installation . Mais ça a tout de suite été considéré comme un classique , et donc c’était un peu chiant : Et après, qu’est-ce que tu fais? Et bien ça été pendant un moment assez lamentable. Je n’arrivai pas a tirer quelque chose de ce qui fonctionnait dans ce premier film. C’est plus tard, quand j’ai commencé à écrire des textes sur le cinéma expérimental, que j’ai repensé les choses un peu différemment. Par exemple : écrire avec des images. J’ai fait un film en 1987, un film qui s’appelle VO/ID, un double écran, avec du texte en anglais et en français, et avec des jeux de mots, si on comprenait les deux langues, quelque chose d’un peu politique. Un jeu entre les deux écrans. Ça m’a beaucoup stimulé, et ça a donné un certain nombre de films, que j’approfondis depuis des années, qui interrogent la manière dont on appréhende le texte, le discours, le sens, sa résurgence. J’ai par exemple travaillé autour du Sida, pour certaines installations : Tu, Sempre. Il y a aussi la notion de musicalité qui m’intéresse beaucoup, qui revient par exemple à cette fugue de Bach qui travaille sur deux voix, tout comme le film était en double écran. Mais la musicalité ne veut en soi rien dire, la synesthésie ne m’intéresse pas tellement. Cela permettait de penser la composition d’un film en court-circuitant cette idée de narration. La composition, dans l’écran par exemple, ou les rapports qu’entretiennent des images les unes a coté des autres. Ou les unes dans l’espace où il y a les autres. Parce qu’à un moment les écrans sont dissociés l’un de l’autre, et charpentent l’espace. (www.yannbeauvais.fr).
YT : Ce premier film, cette fugue, c’était figuratif ?
YB : Ce premier film était filmé dans des jardins d’une demeure du 18ème siècle en Charentes, dans laquelle quelqu’un répétait un morceau de clavecin en vue d’un concert. Un jardin abandonné. Et il y avait un panoramique sur ce paysage filmé avec de la pellicule périmée, mais dont le flicker était très beau. Il y avait une relation entre sautes de notes et flicker d’images. Et ce dispositif, sans que je ne m’en rende compte au début, permettait d’explorer toutes les possibilités de la musique baroque. C’est-à-dire, l’inversion, le renversement, le renversement rétrograde. Et avec ça je pouvais donc travailler avec trois, quatre écrans sans aucun problème.
YT : Et le super 8 ?

YT : Et la vidéo ? C’est pisseux, non
YB : Ça c’est amélioré.
YT : Ouai… Ce n’est pas linéaire. Les projos tout ça. Il y a des régressions.
YB : Ça, ça m’intéresse d’une certaine manière parce que ça à voir avec les expériences que j’ai pu faire à chaque fois. Vu que je pratiquais les multi-écrans, tu ne sais jamais comment ça va fonctionner ! Je me souviens qu’avec Thomas Köner, nous sommes allé à Rome pour une performance de Des rives sur laquelle on travaillait ensemble depuis plusieurs années et j’avais demandé quatre projecteurs et deux écrans. On est arrivé et il n’y avait que deux projecteurs et demi qui marchaient.
Avec les ordinateurs, on retrouve un peu ça aussi. C’est chiant mais en même temps c’est intéressant parce que cela te mets dans une situation d’incertitude. Les risques m’intéressent. Une des particularités de mes installations, c’est que je souhaite qu’on puisse les débrayer à tous les niveaux. Donc Thomas, musicalement et moi, visuellement, on intervenait à tous les niveaux et en direct, en changeant les paramètres ou en explorant ce qui était potentiel. Nous avons fait cela avec trois installations. Là, cette semaine, on a parlé de se relancer dans un travail ensemble. Nous avons interrompu cette collaboration pendant 5, 6 ans parce que, l’un et l’autre, nous avions besoin d’aller voir ailleurs. Il me presse de retravailler avec lui parce qu’il dit que c’est stimulant parce que lui a tendance à privilégier le côté méditatif et moi, la simultanéité des informations. Et j’ai bien envie que l’on s’y remette.
YT : Tu as aussi une activité d’historien. J’ai assisté à l’une de tes conférences/projection. C’était gratifiant.
YB : A cause de Light Cone, de Scratch, j’ai une connaissance assez étendue du cinéma expérimental et même de l’art vidéo. J’ai fait beaucoup de conférences thématiques mais aujourd’hui je préfère faire découvrir des choses. Tu as assisté à la séance du film de José Agripino de Paola : Hitler Terceiro Mundo cet écrivain très peu connu en France, un brésilien, aux écrits superbes et qui a fait quelques films. Au Brésil même, il n’est pas si connu et pour moi, c’était très important de lui donner à son travail cinéma une autre chance, d’avoir une autre existence. (www.lafuriaumana.it)
YT : Merci. C’était une très belle séance Fraîche ! Plein d’énergie, de délire et de beauté.
YB : Je suis historien dans ce sens-là, trouver les oeuvres qui ont étés disqualifiées, méconnues, pas connues ou alors qui ont été rejetées. Pour moi, ça été important de remettre en circulation les films de Len Lye ou de Lazlo Moholy-Nagy dans les années 80. Donner accès à des choses dont on a entendu parler mais qu’on a pas pu voir, de les mettre en circulation. Les films de Gordon Mata Clark, peu de gens les avaient vu ou bien encore Adrian Brunel.
YT : Et Ubu.com ?
YB : C’est super. J’ai plusieurs de mes films sur Ubu . Plus les films sont visibles, accessibles, plus de gens qui n’ont pas la possibilité de voir ces films, peuvent au moins les voir sur l’écran de leur ordinateur. Parfois, ces gens pourront les voir dans un musée ou dans une salle de cinéma un jour. Après l’irruption d’un ayant droit improbable de Jack Smith, une sœur inconnue, tous ces films sont sortis de la distribution. Ensuite, ils sont tous passés dans une galerie new-yorkaise à qui il faut payer très cher. Eh bien, heureusement, qu’il existe 2, 3 sites dans lesquels tu peux quand même voir Flamming Creatures ou une partie de Normal Love.
YT : L’irruption du Sida dans ton existence ? Moi, ça a totalement changé ma vie. Fini les petits coups à la va vite entre deux portes. Ah ! Quelle déprime… Je me souviens que dans un de tes films tu parlais de rapports secs – plus moyen d’avaler le sperme…
YB : C’est effectivement quelque chose que je profère d’une autre manière dans Still Life, dans lequel je dis que j’appartiens à cette génération d’homosexuels pour lequel le fait d’avaler le sperme de nos amants n’étaient pas problématique. Aujourd’hui, cette liberté n’existe plus. N’y aurait-il qu’une sexualité sèche ?
_
L’irruption du sida a changé beaucoup de choses oui, dans les comportements, certes mais pas forcément, il a fallu s’adapter. À un autre niveau, cela a transformé le cercle de mes connaissances, de mes amis, de mes amants. De New York à Paris en passant par Londres c’était toujours la même (ou presque) histoire. Comme beaucoup de gays de ma génération, il n’a pas été facile de faire face à ces disparitions, à cette hallucinante haine et production délirante qui s’est diffusée dans la société, du cancer gay au sidatorium, la coupe débordait, et je crois qu’elle déborde encore et toujours, mais c’est plus feutré, plus délicat. Regardez, on vous a accordé des droits, de quoi vous plaignez vous !
_
L’irruption du Sida m’a aussi comme de nombreux pd à prendre position, à m’engager différemment de ce que j’avais pu faire jusqu’alors avec Gaipied ou quelques festivals. J’ai souhaité faire des films qui traitaient de ces questions et qui pouvaient ainsi servir de plateforme de discussions, réflexions. Depuis 1991 j’ai donc réalisé plusieurs films et installations dont le Sida était l’objet, le sujet même. En 2001 j’ai conçu une installation Tu, Sempre qui traitée du Sida et des ses représentations et depuis 10 ans cette installation s’est constamment réactualisé selon en fonction des lieux, des pays dans lesquels elle est montrée sous sa forme installation, performance ou film. C’est un travail en évolution constante, en transformation constante dont j’espère pouvoir arrivé bientôt à faire une version pour le réseau qui se modifierait en temps réel.
YT : Quelle est ton dernier bon souvenir professionnel ?
YB : Je viens d’en terminer un qui s’appelle Luchando et que j’avais tourné à Cuba. C’est hyper compliqué parce que pour les gens de nos générations Cuba était une sorte de truc dans la tête et j’ai travaillé justement sur toutes ces choses là qui sont dans la tête. En tant qu’homo aussi, Cuba, ce n’est pas facile et vis-à-vis du Sida aussi. Pour moi c’est un grand film. Il fait 62 minutes. C’est copieux et cela a été très complexe à faire à plus d’un niveau à cause de tous ces contenus idéologiques que je ne maîtrise pas forcément. Cela a induit d’autres enjeux. Et travailler avec tant de sources a été prodigieux. J’ai pillé ce qui était possible à droite, à gauche puis j’ai truffé ou lardé avec quelques images que j’avais faites au téléphone portable, ne voulant pas utiliser d’autres images faites plus stable que nous avions faites. Je ne voulais pas entrer dans cette fascination qu’il y a en ce moment dans les documentaires avec la belle image. On fait passer plein de choses avec la belle image et notamment des contenus idéologiques auxquels on prête pas toujours attention. Ce film – ça fait longtemps que je n’avais pas eu ce sentiment, je l’avoue -, il y a quelque chose dedans comme dans d’autres travaux que j’ai pu faire à d’autres moments. Il n’est encore sorti. On vient je viens juste d’arriver à faire la vidéo. Je me suis battu pendant des mois avec la compression, la conversion. Il y a deux semaines Aziz ne comprenait pas ce qui se passait lorsqu’on a essayé de le faire. C’était aberrant. Ce qui m’intéresse, c’est d’avoir réussi à mêler à une dimension d’un journal filmé des préoccupations politiques.
YT : Et l’école ?
YB : L’école… Ce qui m’a surpris, c’est l’étrange rôle que j’ai du jouer depuis le début, du pédé de service.
YT : Par rapport à qui ?
YB : Aux collègues et aux directeurs successifs… Les étudiants en parlent aussi… Ce qui m’a le plus outré, c’est la caricature d’homophobie qui s’exerce au détriment chaque étudiant homo qui recevait un nombre de trucs monstrueux.
YT : Je t’ai envoyé un étudiant d’origine polonaise qui ne savait pas encore qu’il était homosexuel.
YB : Ah oui ! Dominik. Lui, ils l’ont massacré. Il en a bavé. Philippe aussi, ça a été dur. Par moment, il n’en pouvait vraiment plus. Il est parti à Nice. Ca n’a jamais été facile dès que l’homosexualité était assumée. Je ne vais pas les citer tous.
_
Un jour, nous avons fait un voyage pour aller voir une exposition de Michel Journiac à Strasbourg. Il y avait trois étudiants et moi. Un déplacement de folles ! Mais ce fut la première fois que ces étudiants ont parlé entre eux de ce qui leur arrivaient à l’école. Et l’an dernier, j’ai suggéré à Hye Young : « Vas à Bourges. Là au moins, il y a Nathalie Magnan et d’autres femmes qui enseignent, car à Mulhouse on peut pas dire qu’il y en ait beaucoup ».
Il y avait une black qui était blanche et qui suscitait une jalousie affolante, un racisme. Ça me fatiguait ; elle s’intéressait aux questions de races, aux colonialismes etc, c’était plus stimulant.
_
Hier soir, on en a parlé avec Nathalie Magnan, c’est la même chose dans la plupart des écoles et ça, sous couvert que ça n’existe pas car on est dans le milieu de l’art. Ces comportements, ces attitudes, ces non-dits qui surgissent comme ça, c’est choquant. Je demande aux étudiants un travail assez personnel avec une participation orale intense et ça produit des trucs. Depuis que j’ai annoncé que je partais, beaucoup me demandent de parler de moi, ce que je ne fais jamais et j’ai l’impression que ça joue sur la notion de modèle : ils découvrent qu’un pédé, c’est une personne comme une autre. J’ai toujours gardé une grande distance par rapport aux étudiants. Pour moi, cette distance est importante. Si après…
YT : Et avec les directeurs ?
YB : En général, pas de rapport. On peut néanmoins dire de l’actuel qu’il ne comprend absolument pas ce que c’est qu’une école et qu’il a des difficultés avec l’image en mouvement. Dès que je fais quelque chose, il me dit : « Ah mais tu fais du yann beauvais » ce qui doit signifier quelque chose pour lui !
——————————
David Yon de Dérives a souhaité poser trois autres questions à yann par mail.
DY : Que penses-tu actuellement des possibilités de diffusion du cinéma qui t’intéresse et de la question de son public ?
YB : C’est une question qui est complexe dans la mesure ou le cinéma qui m’intéresse est vaste. Je ne pense pas que je puisse le réduire à un genre bien précis. Le champ du cinéma qui m’intéresse est multiple. Ce qui m’étonne c’est que depuis le champ du cinéma expérimental est devenue un objet d’études académiques autant qu’un objet muséal, patrimonial les conditions de réalisation de la plupart des cinéastes ne se sont pas véritablement améliorées, par contre les espaces de projection se sont diversifiés et la projection en salle n’est plus dominante. Hormis quelques élus et la progressive reconnaissance du cinéma expérimental dans l’espace de l’art contemporain, qui a permis a certain cinéaste d’être appréhendé selon d’autres critères et d’autres histoires, le cinéma dit expérimental est toujours méconnu. La question de sa visibilité est essentielle et tourne autour de son accessibilité. Que certains des films de l’histoire du cinéma expérimental soit visible sur la toile me paraît alors une chose importante car elle potentialise la circulation, l’accessibilité aux œuvres. On en a souvent la preuve lorsque donnant une conférence ici ou là, ou montrant des films on rencontre des gens qui parle de la découverte d’œuvres non pas en entrant par hasard un jour de pluie dans une salle qui montrait des films expérimentaux comme le raconte Ernie Gehr, mais en surfant.
_
Je ne sais pas si le public parisien m’intéresse vraiment, je ne sais plus même si le public de nos régions m’intéresse encore. Trop blasé, rien ne l’anime en dehors du même et de sa répétition ou de la célébration tardive de ce à quoi il n’avait pas eu ou su avoir accès. J’attends du public plus d’insatisfaction, plus de critique, plus d’incompréhension, moins de divertissement, moins d éloges, moins de ronronnement. Lorsque j’ai montré les films de José Agrippino de Paula, je fus sidérer du provincialisme parisien et d’une saisissante inculture et méconnaissance qu’il a de l’autre, celui qu’on nomme l’étranger. L’ignorance et la réification élevée à la culture d’état et au comportement de masse ne sont pas vraiment des moteurs pour les films et les pratiques que je souhaite continuer à défendre. Il me semble toujours important de rendre accessible, de faciliter les découvertes d’œuvres, non pas dans une course effrénée pour le nouveau, mais plutôt permettre de voir telle ou telle ouvre qui pour différentes raisons n’a pas été beaucoup vue. En ce sens je crois plus en la possibilité de montrer à des gens qui auront envie de montrer ou de faire des films. Un film, une œuvre n’est intéressante que par les questions qu’elle fait surgir et parce qu’elle déclenche. On pourrait envisager que le public fût tel.
DY : Je suis allé voir A Idade da terra de Glauber Rocha à Pompidou lors du cycle que tu as programmé autour de José Agrippino de Paula et j’ai été très déçu de constater que le film était projeté en dvd. Penses-tu que la question du support n’est plus importante ?
YB : Lorsque j’avais établi cette programmation autour de José Agrippino de Paula, il était entendu que nous aurions accès à une copie 35mm scope du film. La cinémathèque française semblait avoir une copie, mais il y avait aussi la possibilité d’obtenir la copie de la cinémathèque de São Paulo. Ce n’est que trois ou quatre semaines avant le début du cycle que le centre Pompidou m’a informé de l’impossibilité d’obtention d’une copie film de A idade da terra, sous-titré, la seule copie disponible ne l’était plus car en trop mauvais état. C’est à ce moment -à que fût prise la décision de le montrer en dvd, car celui-ci avait bénéficié d’une restauration et de plus il était sous-titré. Ce que je ne sais pas c’est si le film a été projeté avec ses sous-titres ou non.
_
Il n’était donc pas question ici de faire l’impasse sur le support d’origine mais de faire face à une impossibilité qui avait surgi. Par ailleurs le service cinéma du musée n’a pas des moyens énormes et le sous-titrage électronique de tout film ampute son budget qui est depuis quelque temps pour le moins ridiculement petit. C’est par défaut qu’a été présenté un dvd, non pas en regard de la question du support.
_
Derrière ces questions de fidélité au support se glisse pas mal d’autres questions. Aujourd’hui la projection de film sur le support d’origine est beaucoup plus restreinte qu’auparavant (moins de copies tirées, ou en état d’être projetée, moins de cinéma équipé avec les projecteurs et optiques adéquates) la circulation et l’accès aux œuvres s’effectuent bien souvent via les dvd, la télévision, internet…. Se pose alors la question de savoir, et ceci est une question pour le moins politique, si on ne peut voir un film que dans les questions de projection idéales, en tout cas proches de celles qui avaient vue la projection dudit film. On connaît bien à cet égard la position de Peter Kubelka, qui avait conçu son Invisible Cinema, comme réponse idéale vis-à-vis de l’irruption de la télévisualisation de l’expérience cinématographique. Rappelons en effet que l’idée de cet Invisible cinéma date de 1958, et n’a pu être mis en application à New York qu’au début des années 70, alors que l’Expanded Cinema battait son plein, s’inscrivant ainsi à l’encontre de ces expériences qui interrogent l’unicité de l’expérience cinématographique à la seule pulsion scopique avec une seule source sonore frontale sous l’écran. Mais la pratique du cinéma excède cette définition et cet usage (voir les installations, les multi écrans, les performances, le live cinéma…) donc, d’autres modalités s’inscrivent potentiellement dans, au travers d’un questionnement du dispositif. Parmi celles-ci, la question du support est importante. Face aux difficultés de tirage de copies super 8 ou 16mm, nombreux furent les cinéastes qui ont transféré leurs films sur vidéo (voir : à cet égard le travail de défrichage des New Romantics en Angleterre à la suite de Derek Jarman). Nombreux furent les cinéastes super 8 qui ont accepté, ou décidé de faire des copies en 16mm, puis en numérique afin de pouvoir travailler sur des qualités granulaires qui leur permettent de retrouver certaines qualités plastiques du support d’origine. Mais on ne peut se limiter à une réponse qui privilégierait seulement le propos des cinéastes, car comme tu le sais bien, faire un film c’est aussi le diffuser, le montrer. C’est ici que la question du support de diffusion devient emblématique et implique des considérations politiques quant à l’accessibilité des œuvres, et à qui ces œuvres sont destinées. Si en tant que cinéaste travaillant avec le support argentique on revendique la seule fidélité au support d’origine et aux conditions de diffusion d’origine, alors le champ va se restreindre et se limiter à certains territoires qui inscrivent leur appartenance à La Culture. Les lieux privilégiés ayant encore ces équipements seront d’un côté les lieux alternatifs (de résistances ?) et les lieux institutionnels. Cela relève d’un choix qui marque l’appartenance à une culture (patrimoniale), mais pourrait relever de la nostalgie, ou d’un certain fétichisme, ou bien encore d’une fétichisation. La projection en salle avec de la pellicule est devenue plus rare, quasiment évènementielle. L’accessibilité aux œuvres passe par d’autres modalités de projection, qui se font par-delà les supports. À vouloir être fidèle aux conditions de projections d’origine, on disqualifie l’accès aux œuvres sous prétexte qu’elles ne sont plus comme elles l’étaient (de mon temps, le problème avec ce type d’argument c’est que ce n’est plus « mon », « ton temps, c’est le temps présent). Et plus grave on réserve, on assigne les œuvres aux seuls publics qui a les moyens de s’offrir les conditions idéales de projections (on voit bien qu’entre marge et institution, l’écart s’amenuise). Il nous faut créer une pluralité d’accès aux œuvres afin de contourner monopoles : les musées, cinémathèques et autres prisons patrimoniales qui confisquent les œuvres, leur permettant d’exister que sous leur seul contrôle. Il faut multiplier les lieux et les plateformes qui donnent accès aux œuvres afin qu’elles puissent être vues quand on le souhaite et non pas comme émanation de la rareté. Il faudrait penser arrêter d’appliquer les critères du marché de l’art aux œuvres cinématographiques (dans le sens que lui donne Gene Youngblood).
DY : À l’heure où les frontières sont de plus en plus poreuses entre cinéma expérimental, essais documentaire, art contemporain. Que doivent défendre aujourd’hui les coopératives qui se sont fondées pour le cinéma expérimental ?
YB : Il faudrait multiplier les lieux car une coopérative généraliste aujourd’hui est-elle encore vraiment pertinente ? Par-delà l’utilité et la nécessité de coopérative telle que Light Cone qui lorsqu’elles furent crées, incarnaient une alternative et correspondaient à une attente spécifique ; aujourd’hui il me semble que ces organismes sont peut-être un peu lourd et trop orienté vers une activité patrimoniale, qui bien que nécessaire et structurante ne correspond pas forcément aux attentes de tous. Aussi faut-il saluer les initiatives qui se déploient selon d’autres axes et qui permettent à d’autres œuvres d’être vues selon d’autres modalités et circuits favorisant et permettant une visibilité que les structures plus établies n’auraient pu leur apporter. La focalisation sur un groupe restreint de cinéastes et d ‘œuvres permet une agilité qui n’est plus du ressort de structures plus lourdes mais, qui peuvent en même temps fédérer des transformations comme par exemple ce fût le cas avec la plateforme 24-25. De plus ces coopératives de cinéma expérimental correspondaient à un état du cinéma, à un moment dans la pratique du cinéma qui s’est depuis très largement démocratisé, outrepassant les rêves les plus optimistes des cinéastes underground des années 60. Aujourd’hui on ne fait pas du cinéma comme on le faisait dans ces mêmes années et la mise en circulation d’un film, sa diffusion ne s’effectue pas selon les mêmes circuits que ceux utilisés à ces différentes époques. La circulation de l’œuvre ne dépend plus seulement de l’horaire d’une programmation hebdomadaire que l’on risque de manquer. On peut mettre son film en ligne, sur certaines plateformes et toucher autrement des publics distincts. Ce n’est pas tant le nombre que la possibilité de créer des passerelles de visibilité qui ne se font pas au détriment de la projection en salle, ou du festival et de la galerie, mais sont en parallèle et active différentiellement la réception d’un film. Je pense que les coopératives doivent défendre d’autres objectifs qui ne sont plus ceux, sur lesquels elles ont été fondées. Les questions de la mise à disponibilité de l’œuvre, celles du droit d’auteur doivent être re-examiner à l’aune des développements contemporains qui bousculent nos modes de penser et d’agir avec, par et pour le cinéma.
_
Que les genres soient plus poreux et que les pratiques se contaminent, se pervertissent, s’explorent, s’embrassent etc doit aussi se retrouver dans la diffusion et dans les instances qui les défendent. Il nous faut construire d’autres moyens de diffuser, de penser et d’articuler les pratiques cinématographiques et c’est ce que nous allons tenter de faire au sein de bcubico à Recife.