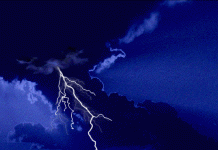Oh, papa, c’est dur de grandir sans toi. La mort a une façon de révéler des émotions cachées et de nous obliger à faire une mise au point en un quart de seconde. Elle lève les inhibitions et me voilà, à vouloir poser mille questions auxquelles ta chaude voix radiophonique et tes yeux pétillants ne peuvent plus répondre. Alors que je réalisais le film sur ta mort et que je réfléchissais à ton absence avec Steve Dwoskin, notre cousin Eric Kroll m’a retourné la question que je lui avais adressée pendant l’interview : « Quel est ton premier souvenir avec Robert ? », j’ai vraiment eu un blanc, j’ai tenté une réponse, maladroite et un peu raide… « C’est moi qui pose les questions, ici… » ai-je répondu d’une voix faussement sérieuse. Je n’avais jamais réfléchi à ma relation avec le souvenir et, en général, n’étant pas par nature dans la nostalgie ni la préméditation, je me suis fait la réflexion que nos histoires familiales étaient très souvent le fruit d’une association entre le visionnage d’images et leur fabrication. Je me suis éloignée pour y réfléchir. J’y ai passé un bon moment, quel était mon premier souvenir avec toi ? Qui ne soit ni une photographie, ni un film…
Cet exercice me rappelle les cours de maths, où rien ne vient spontanément à l’esprit – je crois, papa, que tu m’aurais gentiment bousculée, le sourire aux yeux, « Allons, Keja » et que tu m’aurais posé une autre question pour mieux revenir à la première.
Il n’existe pas de photo qui confirmerait la réalité de cette image-souvenir. Aucune photo à faire circuler qui serait la preuve que nos êtres ont existé et vécu dans un espace donné, l’image d’un temps arrêté. Il y a tellement de photos de nous, en général, que je me suis mise à réfléchir à ce que cela signifiait : est-ce parce que nous sommes une famille d’images que nous sommes devenus des fragments, des pièces du grand film de la vie ? Toutes les familles s’observent-elles par le trou de l’objectif, s’inspectant à travers la lentille ? Je te regarde, tu me regardes, et ce troisième œil de verre cligne son miroir obturateur, clac, clac, se rapproche, cadre et nous fragmente l’un l’autre. Seule la mort a le pouvoir de me rappeler cette absence présente dans ces images, ces valises, ces coffres pleins d’une vie de famille qui commence à ressembler à la lecture d’un magnifique roman d’action.
L’histoire se détaille dans la couleur vive d’une mer étincelante d’un bleu électrique ; sans continuité ou sans son, comme en avance accélérée dépourvue d’images figées – alors, papa, tu te souviens : comme nous sommes hors du temps, je suis plus jeune et sans âge, nous sommes au bord de la mer, hors du monde. Sur une plage au milieu de plein de gens, rassemblés pour un rendez-vous mondial, un pique-nique universel, où nous, le peuple, grâce au pouvoir de la volonté et à l’esprit positif, allons nous unir au cosmos pour méditer un instant sur la paix dans le monde. La plage déborde de bonnes intentions, je me souviens d’Eric et de sa famille, d’un chien, du soleil et du sable, d’une douce brise sur les peaux nues, de grandes serviettes de bain. Je vois l’endroit, sans signes particuliers, comme nous bougions tout le temps, personne ne peut être assimilé à un endroit précis du globe. Je suis toute petite et l’océan est vaste et puissant, de grosses vagues se brisent sur la plage en harmonie avec les vibrations du cosmos. Le décompte du temps est d’une extrême importance, une guerre se déroule quelque part, pensons à la paix, ne soyons pas en retard pour le rendez-vous cosmique. Maman n’est pas en train de nager, il n’y a que toi, papa, à être dans l’eau. Il me semble que tu t’amuses plus que les autres à jouer dans le déferlement des rouleaux, te préparant à ta façon pour le rendez-vous cosmique et la paix spirituelle cristalline, engagé dans un duel avec la mer. L’énergie ionique remplissant chaque pore, mon tout petit corps s’est mis en tête de te suivre au plus profond du bleu des eaux puissantes. Nous nous tenons la main et sautons par-dessus les vagues, les plus grosses se brisant en fanfare sur nos petites têtes, l’océan m’arrache à ta main ferme. Il m’entraîne dans ses fonds merveilleux, submergée par la déferlante qui se brise sur les galets polis, je suis incapable de lui résister, je suis terrorisée, battue et secouée par sa puissance – Culbutée par le tambour d’une gigantesque machine à laver cosmique, désorientée, perdant tout souvenir de l’oxygène. Tes bras m’ont arrachée à lui, je suis paniquée, ma mère est furieuse, le bruit des flots surplombe le rassemblement pour la paix et tu me tiens solidement dans tes bras glacés. Tu me demandes si ça va… l’oxygène est devenu un nouvel ami ; tu veux m’apprendre à chevaucher la mer. Nous devons y retourner, et laisser derrière nous l’air et le sable ferme. Tu me regardes dans les yeux et tu me dis : « Ne lutte pas, cela t’épuiserait, laisse-toi flotter, si tu te retrouves sous l’eau, ne te débats pas, essaye de te détendre et tu remonteras naturellement à la surface… éventuellement. »
Le compte à rebours cosmique déclenche le début de la méditation, les esprits de cristal parcourent la planète et, l’espace d’un instant, un espoir de paix traverse le globe. C’est beau et silencieux.
En ce jour bleu, je ne me suis pas noyée, j’ai appris à chevaucher les vagues et les chevaux d’écume. Avec ce souvenir de bout de bois à la dérive, j’ai pensé au contraste qu’il y a à affronter la mer à tes côtés tout en méditant pour la paix dans le monde. Rien de plus, mais un sentiment de sérénité d’avoir partagé avec toi un moment sur la planète. Ce genre de situations est devenu, pour moi, une occasion d’explorer les frontières invisibles des contradictions. Cette rencontre avec la Paix planétaire a généré peur et rage. Soudain, le noir et le blanc, quand ils se font couleurs de l’expérience, deviennent les parenthèses qui encadrent les nuances de gris. Devant un éclat de gris, si tu me le demandais, je répondrais que c’est le don rare de pouvoir exprimer des sentiments et de ne pas se laisser figer dans un seul et unique point de vue. Notre mantra pourrait être de vivre toute notre vie sans nous laisser engluer physiquement, émotionnellement, spirituellement…
Oh, papa, quelque chose de définitif s’est passé quand tu es mort. J’ai attrapé tes outils, un film qu’il fallait terminer. Quel sentiment étrange d’inconfort autour de ton absence. Nous avons travaillé dur, Julien Cloquet et moi, nous nous sentions tes gardiens, tu m’as donné l’occasion de rencontrer un ami très particulier et de partager avec lui notre amour pour toi, notre respect pour ta vigilance. Avant Cités de la Plaine, je travaillais sur mon premier film, Digital Blue, et tu m’as beaucoup aidée. Nous avons passé du temps dans la salle de montage du Fresnoy et tu m’expliquais comment le son transforme l’image, comment filmer, comment penser au film et le faire exister. Finalement, presque tout ce que tu m’as appris m’a servi pour finir ton film après ta mort.
Je crois que nous vivons actuellement une période étonnante de l’histoire. Les images n’ont jamais été aussi omniprésentes, au point de presque oublier de vivre notre vie. Comme cette histoire sur le célèbre film des frères Lumière, quand le train arrive dans la gare, qu’il aurait semé la panique avec son réalisme, nous sommes maintenant dévorés par cette idée et nous ne pouvons plus imaginer de détourner les yeux de cette puissante locomotive d’images : accros ! Et, papa, j’ai aussi ce sentiment bizarre sur notre façon différente de voir le monde à travers la caméra, le temps qui passe, de se sentir en vie. Petit à petit, à mesure que les machines à faire des images rapetissent et que l’œil rouge enregistre en permanence dans le vide et que nous nous demandons quoi faire de tous ces nouveaux outils, je pense que je discute avec toi, continuant le dialogue avec nos amis, avec les caméras. Tes films et tes écrits sont la continuité d’une réelle présence, sans corps.
Une même histoire a de multiples vies et de multiples points de vue. Donc, papa, ici et maintenant, nous aurions parlé des films et des pixels, et des caméras et du futur, et des sentiments… Tu connaissais mes photos, tu n’as jamais vu mes films, et j’en suis désolée. Travailler sur I’ll be your eyes, You’ll be mine était une façon d’être avec toi dans la splendeur de toutes les contradictions… c’était aussi ma relation au monde, une réflexion sur notre façon de travailler et d’adopter un point de vue, tenter d’être au monde à notre manière. J’ai rencontré un de nos amis merveilleux au cours de ce voyage, Steve Dwoskin. Je voulais te dire combien ce partage avec Steve a été important pour moi et comme c’était étonnant d’entrer avec lui dans l’agencement des « pièces et des morceaux ». Sentir cette grande connexion dans le travail… le monde de la métaphore et du symbolisme, sculpter des images, travailler les pixels comme du pigment, des extensions de la pensée s’infiltrant dans le canevas de l’ordinateur ; des esprits étonnants transperçant les limites. Comment exprimer à quel point je suis reconnaissante de faire cette marche, comme il a été (et sera toujours) doux de t’avoir connu et d’avoir bénéficié si totalement de ton cadeau merveilleux… Oh, papa, tu nous accordais tant de liberté, et qu’elle est rude cette responsabilité…
Keja
Texte initialement publié dans le n°17 de la Collection Théâtres au cinéma : Robert Kramer.
Photographie d’Erika et Robert Kramer prise par Keja Ho Kramer.