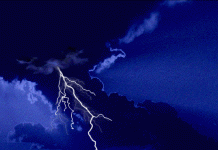EMPIRE, Noël 1972. Les avions des États-Unis tentent de bombarder Hanoï jusqu’à saturation, action aussi vindicative, aussi insensée, aussi mauvaise que toutes celles menées par l’agresseur dans ses tentatives brutales pour soumettre le peuple héroïque du Vietnam. L’impérialisme américain se montrait complètement à nu. « Voilà ce que je suis, disait-il au monde, au cas où vous n’auriez pas déjà saisi. » Cela prouvait le danger de la situation : car les États- Unis agissaient de cette façon au moment même où ils étaient obligés d’accepter leur plus grande défaite du siècle.
Nous deux, John et Robert, nous deux qui avons travaillé sur Milestones depuis le début jusqu’à la fin, nous avions travaillé pendant neuf mois avant Noël 1972 dans l’État du Vermont. Nous étions tous les deux les organisateurs d’un groupe d’agitation / propagande appelé « Vermont-Vietnam ». Notre travail consistait à aviver autant que possible l’opposition à la guerre du Vietnam et à faire davantage prendre conscience aux gens de l’oppression et de l’exploitation que nous subissons dans notre vie de tous les jours à l’intérieur des frontières de l’Empire, « ici même, chez nous ». Nous diffusions des tracts, nous collions des affiches, et nous avons produit une grande variété de matériaux de propagande sur la guerre. Et tous les jours nous allions dans les écoles, chez les gens, dans des centres communautaires, dans des centres commerciaux, dans les stations de radio et de T.V. qui voulaient bien de nous, et nous parlions et montrions des films sur la guerre, et nous essayions de convaincre le plus de monde possible.
C’est très difficile d’expliquer à quel point le Vietnam — le pays, le peuple et la grande lutte de libération — fut décisif pour des milliers et des milliers d’entre nous. En un sens, ce fut comme un sang neuf pour nous ici, enfermés au sein de la nation dominante. Nous avons appris sur la lutte pour l’autodétermination nationale et son application à la lutte des peuples de couleur à l’intérieur des frontières des États-Unis. Nous avons appris qu’on pouvait résister au pouvoir U.S. et le vaincre. De façon quotidienne nous avons essayé d’apprendre autant que possible de l’exemple des Vietnamiens. Et cela nous a donné du courage maintes et maintes fois : y compris maintenant, alors que nous écrivons et que les forces de libération encerclent Saigon.
Dans le Vermont, nous avons étudié et appris à être de meilleurs organisateurs contre la guerre, et à soutenir le Gouvernement Révolutionnaire Provisoire et les Nord-Vietnamiens. Nous avons appris des Vietnamiens eux-mêmes, en travaillant avec des militants exilés à Montréal, au Québec et avec l’Union des Vietnamiens aux États-Unis. Mais tous deux nous avons eu une chance exceptionnelle. En tant que représentants de Newsreel, une organisation de cinéma révolutionnaire, nous sommes allés au Nord-Vietnam en 1969. Nous avons voyagé à travers le pays, nous avons fait un film appelé La guerre du peuple. Le Vietnam devint une suite d’images vivantes et de sensations vivantes derrière nos yeux et nos oreilles et nos nez.
Et pour tous les deux, c’est resté une expérience à laquelle toutes les autres se mesurent : un sens de l’immédiat, d’une vie au présent, armés d’un grand projet et de clarté — le sens de la force de millions de gens unis dans une communauté de lutte riche et variée. Nous commencions à comprendre ce que signifiait vivre et travailler à l’intérieur d’un processus révolutionnaire en marche. Et voir cela de cette façon aiguisait notre vision du gâchis en vigueur, des souffrances et des douleurs inutiles dans la vie des gens, dans nos vies, à l’intérieur de ce que nous appelions par euphémisme : « notre pays ».
Mais une chose est de comprendre tout cela, même un peu, une autre de le vivre réellement, bien et fermement.
Quand arriva le bombardement de Noël sur Hanoï, nous, et des milliers d’activistes comme nous, étions démobilisés. Nous étions désespérés, divisés, et notre mouvement national était au creux de la vague. Pour le « Vermont-Vietnam », c’était le mélange des difficultés réelles de notre travail, la tâche énorme du combat anti-impérialiste des Blancs d’Amérique, la victoire écrasante de Nixon sur McGovern, et de nombreuses contradictions internes qui grandissaient à l’intérieur des communautés, au point que nous n’avions plus de projet unifié ni de bases réelles pour continuer le travail ensemble. D’un côté nous feignions de croire que la guerre « allait enfin se terminer », même si nos analyses nous montraient que ce n’était pas aussi simple, et de l’autre côté nous savions que nous avions besoin d’un meilleur moyen pour parler à notre peuple ici, mais nous ne savions pas lequel. Nous savions qu’il fallait élargir notre base, mais nous ne savions pas comment. Le sectarisme montait ; des luttes vives entre féminisme et anti-impérialisme. Beaucoup d’attaques et de contre-attaques. Cannibalisme.
Cela ressemblait à des temps très difficiles, et nous n’avions pas de perspective qui nous permettrait de voir comment l’avenir se préparait dans ce bouillonnement. À ce point, la plupart d’entre nous n’étaient pas dans la situation de s’asseoir, de réévaluer notre travail, de comprendre ses points forts et ses faiblesses, d’étudier et de se remettre en route. Nous étions sérieusement entravés par le manque d’organisation. Souvent nous étions sans camarades, sans unité, sans travail. Un creux de la vague dont nous avons déjà beaucoup appris. Et il y avait l’amertume, et plusieurs tentatives de fuir tout cela. Dans certains cas, il y avait un rejet pur et simple de la politique : « Je ne veux plus avoir ce genre de rapports aux choses désormais », « je veux avoir une vraie vie ». Le mouvement des femmes prit un tournant aigu vers le séparatisme. Le spiritualisme et diverses techniques de développement des « potentialités humaines » fleurirent. Il y avait beaucoup à apprendre de tout cela. Mais dans une large mesure nous avons tout simplement plongé là-dedans, essayant de nous en sortir sans y penser en termes d’instruments pour renforcer et approfondir la lutte.
Dans le Vermont, John pouvait travailler avec quelques personnes quand le bombardement de Noël eut lieu sur Hanoï. Ils firent une affiche, ils la placardèrent dans les églises de tout le Vermont, de sorte que, lorsque les familles y allèrent en ce dimanche matin neigeux, elles virent le travail sanglant qui avait été accompli en leur nom. Quand Robert entendit parler du bombardement, il était seul dans une chambre avec une télévision, dans une ville où il ne connaissait vraiment plus beaucoup de monde. Ce fut le sentiment d’impuissance et de frustration le plus total qu’il eût jamais ressenti. La colère s’épuisant en tristesse et en honte. Il n’y avait pas de mouvement de lutte. Il y avait le sentiment de nous être désarmés nous-mêmes, volontairement, d’être rentrés à la maison, d’avoir cessé d’être vigilants : et maintenant d’observer les fascistes tels que nous savions qu’ils étaient, faisant les choses dont nous savions qu’ils avaient le pouvoir de les faire. Et nous avions abandonné notre pouvoir, aussi petit fût-il.
Ce fut un moment critique. Quelques-uns parmi nous se retirèrent à l’intérieur d’eux-mêmes. Le pouvoir nu était étonnant et la guerre de résistance spectaculaire des Nord-Vietnamiens dépassait nos espoirs les plus grands. Comment pouvaient-ils continuer à combattre ? Et, ne comprenant pas entièrement la nature de leur détermination et de leur organisation, nos coeurs vacillaient. Nous perdions de vue le moindre effet que nos luttes avaient eu pendant des années. Le cynisme dévorait notre sens de nous-mêmes. L’ironie à l’égard des limites de notre force face à tant de pouvoir. Le plus souvent nous nous moquions les uns les autres de nos histoires politiques, nous prenions à la légère les sacrifices que nous et d’autres avaient faits, nous négligions l’amour et l’honnêteté des camarades — et il y avait beaucoup de bavardages sur « trouver quelque chose de plus utile et de plus intéressant à faire de ma vie… » Nous plongions. « Regardez ! disait la classe dirigeante des États-Unis, vous paierez un prix terrible pour votre libération. Vous paierez ce que nous pouvons vous faire payer. C’est un principe simple en affaires — pour que tous les autres comprennent les risques. » Cela s’adressait au Tiers-monde, mais nous écoutions aussi.
Pour la plupart, nous n’avions aucune communauté de parti, d’organisation, d’idéologie pour surmonter cette période difficile. Mais pour la plupart, nous ne savions même pas ce que nous perdions ! Assez sinistrement, l’occasion était favorable pour contourner la difficulté : le fait que le Traité de Paix allait être signé signifiait peut-être que nous n’aurions plus à y penser. « La bataille est terminée », comme on disait. La leçon que nous tirons de cela, c’est qu’une bataille particulière peut bien être terminée sans que la longue lutte le soit de longtemps. Plus de clarté quant aux buts, à la stratégie, et plus de résistance !
Robert reçut une lettre de Cuba de Barbara Stone :
« Être à Cuba le jour de la signature du Traité de Paix et de la fin des bombardements, eh bien ! probablement, peu de gens peuvent comprendre ce que cela signifie. Et j’ai perçu ce que tu as ressenti d’après ta lettre. Tôt, ce samedi matin du 27 janvier, vers 7 ou 8 heures, j’ai entendu une sirène continue dans toute l’île, je suis sortie en courant sur le balcon ; les cornes, les cloches et d’autres sirènes sonnaient comme des folles. Puis nous vîmes des gens — nous étions en haut — courant dans les rues à travers toute la ville — spontanément — seuls, en groupes, en voiture, courant. J’appelai une amie qui habite en face de l’ambassade du Nord-Vietnam, et elle me dit que le traité venait juste d’être signé à Paris. Nous courûmes vers l’ambassade — et le spectacle était fantastique, incroyable, et tellement plein de joie, il m’est impossible de le décrire sans pleurer — tout le personnel de l’ambassade du Vietnam du Nord était dans la cour, accueillant, étreignant et embrassant tout le monde et rayonnant de joie. Et il y avait des centaines et des milliers de personnes et nous deux, étouffées par elles. Je ne crois pas avoir jamais ressenti quelque chose de semblable auparavant. Nous sommes restées deux heures — et des gens sont venus toute la journée — des enfants, des écoles, des groupes, tout le monde. Il n’y a pas de peuple qui se soit senti aussi proche du Vietnam et qui ait compris sa lutte autant que les Cubains. Ce sentiment de solidarité a toujours existé entre les deux pays et ce sentiment jaillissait à ce moment — bon, comme on dit, c’est vraiment dur de bien le décrire. »
Robert et John en parlèrent. Ils savaient ce que la célébration avait dû être ! Ils ressentaient la joie de l’incroyable victoire ! Et ils portèrent cela en eux-mêmes, mais cela ne se traduisait pas facilement dans leur vie de tous les jours.
Il y eut quelques célébrations, mais peu. Les gens ne s’éprouvaient pas partie de la victoire et n’y trouvaient pas leur propre force. La confusion et les mauvaises idéologies étaient si rampantes que de bons camarades allèrent jusqu’à trouver que le Traité de Paix n’était pas une victoire mais une concession de la R.D.V.N. et du G.R.P. au pouvoir des États-Unis, ou pire, une liquidation.
Voilà la toile de fond de Milestones.
Si l’on est vraiment ensemble, l’obscurité du jour est le meilleur moment pour voir. Mais il faut être vraiment ensemble.
En fait, commençait pour nous une période d’errance. C’était nouveau et important à vivre. C’était différent pour chacun de nous deux, mais c’était également pareil. Tous les deux nous avions abandonné beaucoup d’étiquettes : nous ne vivions ni ne travaillions avec des groupes de gens ; l’un de nous n’était plus marié ; nous n’appartenions pas à des organisations politiques et nous n’étions pas cinéastes ; nous n’étions vraiment attachés à rien, nous n’avions pas de ligne particulière à suivre ni d’idée à vendre — nous étions seulement là en Amérique. À la dérive. Ou plutôt, dans une partie précise de l’Amérique, notre maison.
De la communauté spécifique d’activistes politiques, nous tombâmes dans une sous-classe blanche : jeunes, étudiants, artistes, ex-activistes, vétérans du Vietnam, artisans, communaux, jeunes travailleurs, professionnels spécialistes, rejetant l’idéologie dominante de leur profession.
C’est une sous-culture en partie lumpen, en partie d’intellectuels déclassés, en partie prolétarisée — et grandement façonnée mais pas limitée par les explosions culturelles des années 60. C’est une communauté cohérente qui s’étend à travers tous les États-Unis avec des pratiques et des attitudes communes, et une politique de gauche large et floue. À l’intérieur de cette communauté, partout, il y a comme principe un sens grandissant de la coopération et la frange dirigeante a fait beaucoup de progrès dans la lutte contre le sexisme.
Nous nous mouvions à l’intérieur de notre monde. Et c’était très différent de l’expérience que nous avions en tant qu’activistes politiques à plein-temps. Les choses avaient entre elles des rapports différents, de nouvelles proportions : tout semblait différent. Il était impossible de ne pas ressentir les contradictions tout le temps. Combien la base de notre vie de tous les jours, la base matérielle et la psychologie qui en émergeait, est rendue possible par la surexploitation du Tiers-monde et les surprofits qui en résultent et qui reviennent à l’Amérique blanche comme pot-de-vin pour continuer. Nous sentions comme notre vie était blanche. Maintenant que nous n’avions plus de contacts avec les Noirs et les peuples du Tiers-monde par notre travail, nous n’avions aucun lien à la base. Et il n’y avait pas de stimulant particulier dans ces communautés pour s’identifier à et soutenir les luttes des Noirs et du Tiers-monde. On glissait dans une sorte de racisme de facto, quelles qu’aient été par ailleurs nos idées. Et au même moment, il n’y avait pas moyen d’échapper à cette réalité. Ou bien c’étaient des gens essayant de se faire une idée de la façon de se soutenir, de parler aux voisins, en lisant les journaux ou en regardant la T.V. En fait, la réalité des forces sociales qui se construisaient autour de nous bouleversait chaque pièce dans laquelle nous nous asseyions. La révolte d’Attica et le massacre d’hommes sans armes par Rockefeller. Beaucoup parmi nous avaient des amis proches qui furent tués là-bas. Beaucoup d’entre nous avaient des amis dont les Américains natifs occupèrent les foyers à Wounded Knee. Les soldats de l’Armée de Libération noire furent pris, tués, vivaient pour se battre encore. Nous entendions parler des violations quotidiennes du traité de paix au Vietnam par un Thieu arrogant, croyant à la continuation de l’aide U.S. L’horreur du renversement d’Allende au Chili. La lutte montante du peuple palestinien au Moyen-Orient. Il y avait beaucoup de choses qui tournaient toujours autour des États-Unis.
En général tout cela avait été au centre de nos vies — nous vivions et dansions avec cette réalité, nous comprenions cela comme une série d’événements et de forces intimement liés composant une histoire dont nous faisions partie. Mais, d’une certaine manière, nous nous étions nous-mêmes éloignés de cette histoire — nous restions passifs, nous ne prenions pas de responsabilités, nous observions et attendions. Tous ces événements étaient comme des nuées d’orage à l’horizon, sinistres, menaçantes, mais n’affectant pas, pour la plus grande partie, les décisions quotidiennes de notre vie. Culpabilité. Incertitude. Impuissance. Passivité. Sur un certain plan, nous étions largués, et sur un autre nous étions des gens solides et honnêtes essayant de vivre en harmonie sans croyances.
John ni Robert ne comprenaient plus très bien ce qu’ils étaient. Étions-nous des artistes ? Comment cela pouvait-il être ? Nous avions toujours trouvé étrange de nous représenter ainsi. Étions-nous des errants ? Des contemplatifs ? Des pères ? Des aikidoïstes ? Des expérimentateurs ? Seulement des gens essayant de « faire aller ? » Beaucoup de confusions. Que faire, alors que nous avions perdu tout objectif clair ?
Nous avons décidé de faire un film, sans raison particulièrement valable. Et parce que c’était ce que nous savions faire, parce que c’est la seule façon que nous connaissons de réfléchir sur beaucoup de choses, nous avons fait ce film sur les morceaux de cette culture que nous connaissions bien, et sur le tempo et le rythme des vies autour de nous. Nos vies et celles des gens que nous aimions beaucoup — et les contradictions dans ces vies, et la douleur.
Pour le meilleur ou pour le pire, c’est cela le contexte historique et social de MiIestones.
Nous avons commencé avec un scénario complet. C’était bien, et cela nous fit parcourir une partie du chemin. Mais arrivés à un certain point, nous avons trouvé que cela nous limitait. Moins, d’ailleurs, dans le contenu que dans le style de travail que cela impliquait : trop rivés à un programme de tournage, avec trop de choses à faire en vraiment trop peu de temps. Nous avons adopté une approche plus ouverte. Comme si nous faisions une enquête sur ce dont nous voulions faire le sujet du film. Nous voulions suivre jusqu’au bout une série de pensées, puis commencer à écrire un autre élément de récit, et trouver les moyens pour les faire s’articuler. Ainsi, le fait d’être déconnectés d’un contexte politique et des urgences politiques quotidiennes présentait certains avantages spécifiques : nous pouvions nous accorder autant de temps que nous le voulions, nous pouvions laisser la forme évoluer, se dessiner elle-même et nous-mêmes la dessiner ; nous avions du champ pour expérimenter, pour espacer, découper très finement le film, laisser nos esprits dériver. Et, bien sûr, il y avait les inconvénients de cette déconnexion, de cet espace privilégié : l’absence de lutte collective autour des contradictions internes à ce film ; sa longueur, et certains aspects de son « obscurité », de sa « difficulté » ; les illusions perpétuées par notre style de travail, le déploiement nonchalant du matériau ; le fait de ne pas être lié à la classe ouvrière ou aux peuples du Tiers-monde ; son manque d’objectif en un sens et les limites réelles de son utilité en tant qu’instrument pour une prise de conscience.
La force du film réside dans le fait qu’il étudie une phase de notre histoire que des milliers, peut-être des millions d’entre nous ont vécue ou sont en train de vivre. Dans le fait qu’il fait lui-même partie de cette histoire ; que son objet, son contenu, sa forme, sont inséparables du processus dialectique, des luttes internes à cette histoire. C’est pourquoi il est si riche. si dense, pourquoi il est une forme ouverte qui requiert la participation active du spectateur à un très haut niveau. Les faiblesses de ce film sont les faiblesses de cette période de vacillement, notre difficulté à développer un point de vue autre que celui que nous vivions chaque jour à l’intérieur de nous-mêmes.
Pour nous, le processus de réalisation de ce film fut le processus de notre nouvelle mobilisation. Nous avons été obligés de nous lier à la réalité sociale : journellement, pendant le tournage du film, minute par minute, alors que nous le traversions encore et encore pendant le processus de montage. Nous avons vu clair à travers nos couches et nos couches de prétextes et de faux-fuyants. Nous voyions certains rêves pleins d’espoir se transformer en leur contraire, en une sorte de caricature sinistre de notre propre défaut à lutter, à nous affronter aux problèmes, à surmonter tout cela. Nous commencions à avancer dans la connaissance de ce que nous admirions et aimions dans les personnages et derrière eux, du contexte social réel et des luttes à l’écart desquelles nous continuions tous à nous tenir. Nous voyions beaucoup plus clairement en quoi nous sommes forts et continuerons à l’être plus. Tous les deux nous avons été jetés — ou nous nous sommes jetés — dans cela. Ce fut une collaboration efficace, merveilleuse, qui nous changea considérablement tous les deux. Le processus de réalisation du film fut le processus par lequel nous avons été mobilisés de nouveau.
Cela ne doit pas apparaître comme une coïncidence si le film a été fait pendant une accalmie. Un mois après la fin du montage négatif, l’étonnante offensive vietnamienne de 1975 commençait sur tous les fronts. Pendant que nous écrivons, le filet se resserre autour de Saigon. Tout autour dans le monde, il y a eu une accélération des luttes : indépendance de la Guinée-Bissau, du Mozambique et de l’Angola ; combats intensifiés au Zimbabwe et au Moyen-Orient ; pas de géant accomplis au Portugal. La nature expansionniste de l’impérialisme U.S. est démasquée partout. Ici même le coût de la crise qui va s’aggravant a donné une nouvelle impulsion au mouvement ouvrier. Les révélations du Watergate minent la confiance. De nouvelles formes politiques se développent, les luttes de masse repartent de nouveau.
Dans ce contexte, nous nous sentons heureux d’avoir fait Milestones.
Milestones : nous avons choisi ce titre à cause du sentiment que nous avons qu’il y a des tas de bornes dans la vie de chacun, de repères et de miroirs qui vous indiquent de combien vous avez avancé, et de combien vous devez encore avancer dans votre voyage. Et il y a aussi des jalons pour un peuple, et aussi pour tous les peuples, pour le peuple du monde.
Peut-être Ho Chi Minh pensait-il au marxisme-léninisme quand il a employé l’image de la borne : un corps de principes et de connaissances et de pratiques qui vous aident à tracer une voie juste. Ou peut-être pensait-il au parti qu’il faut fonder pour aider les peuples sur la longue route de la libération nationale et du socialisme. Ce sont là des idées très avancées. Déjà, quand Ho écrivait son poème, la lutte des Vietnamiens était très avancée. Nous commençons seulement à comprendre maintenant, à reconnaître l’importance et la justesse de ces idées.
Pour nous, les bornes ont été tous les moments forts de notre histoire. Les moments où nous avons opposé une résistance réelle à la grande mort qu’est l’impérialisme U.S. Tous les moments où nous avons apporté une aide matérielle aux autres acteurs de ce combat. Tous les moments où les amis et les peuples que nous ne connaissions pas ont conservé les valeurs révolutionnaires, les valeurs humaines, face à des forces supérieures, à de grandes terreurs, à de grands sacrifices. Et ces bornes ont été de petites victoires : enfants nés de nos familles élargies, un jour de bonne discussion, la découverte de la cascade après de longs jours dans le désert, la reconnaissance de tournants erronés. Le poème de Ho enveloppe tout cela. La lutte du peuple vietnamien enveloppe tout cela. Nos luttes ici, à l’intérieur des États-Unis, se renforceront pour envelopper tout cela.
Le processus de réalisation de Milestones a été le processus de notre nouvelle mobilisation. D’autres arrivent par des routes différentes. Des millions de gens nouveaux arrivent. Nous avons raconté un petit fragment des histoires de nos amis dans Milestones, et de cela nous nous sentons heureux.
Traduit de l’américain par Jean Narboni et Dominique Vilain et paru initialement dans les Cahiers du Cinéma n°258, 259 juillet-août 1975