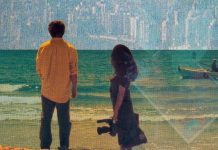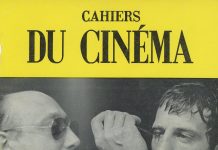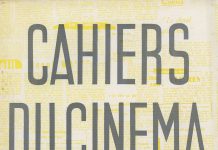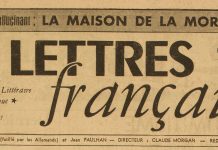Qui est là ? Une réponse négative constituait la prémisse du geste colonial pour Gilles Deleuze: « il n’y a jamais eu de peuple ici » déclarent inlassablement « le maître, le colonisateur ». Affirmer qu’au contraire il y a bien quelqu’un, là, était la tâche que Tariq Teguia attribuait au cinéma à venir dans le film aussi court que percutant réalisé pour Venice 70 Future Reloaded (2013). Quelqu’un, quelques-uns, une multitude. L’interrogation revient sans arrêt dans le Rire et le couteau (2025) de Pedro Pinho, sur la crête qui réunit politique et existentiel. Je suis là. Je ne suis pas tout à fait là. J’y suis vraiment. Je suis là et ailleurs. Et toi, tu es ici ? Tu es où ? Qui est là : personne, tout le monde ? Là, c’est la Guinée Bissau contemporaine, c’est un brouhaha de présences parallèles et emmêlées1. Là, il y a des villages qui transmettent des modes de subsistance traditionnels, à l’écart du monde industriel capitaliste. Puis il y a les ONG occidentales qui se réjouissent de leur apporter le progrès en octroyant de précieuses latrines. Il y a aussi une petillante communauté queer et ses lieux de fête nocturne. Il y a les européens débarqués dans l’arrière-pays pour coordonner les grands chantiers de modernisation. Il y a les chinois – deus ex machina discret – à la conquête de l’Afrique subsaharienne à coup d’investissements et infrastructures. Il y a des chinoises qui gèrent des bordels improbables au milieu du désert. Il y a les jeunes qui partent à la capitale pour étudier. Il y a des femmes âgées qui se souviennent du mouvement de libération national. Il y a les brésiliens, plus subordonnés des portugais et moins des guinéens. Il y a les riches élites locales qui jouent le jeu de la modernité et de l’argent sans être dupes des rapports de forces post-coloniaux. Il y a des travailleurs locaux exploités pour la réalisation des grandes routes. Il y a des habitants tout aussi locaux qui s’opposent aux grandes routes. Il y a des lusophones, des anglophones, des francophones et aussi de nombreuses langues autochtones. Il y a le désert, le marais, les îles, la grande ville. Ici est innombrable, métisse, contradictoire. L’écologie de cet ici est remplie de différence.
Qu’est-ce que nous aurait raconté l’anthropologue Anna Tsing à propos de cet ici ? Si elle s’était rendue en Guinée Bissau pour étudier l’écheveau de « frictions » que la globalisation produit dans chaque territoire, plutôt qu’essayer de comprendre les rapports complexes entre extractions et environnementalismes depuis Borneo ?2 Elle n’y est pas, mais il y a plutôt Sergio qui nous y emmène. Il est un ingénieur environnemental venu du Portugal pour effectuer une étude qui permettra de débloquer un grand projet infrastructurel, promesse de progrès C’est lui qui s’aventure dans ce territoire de simultanéités vertigineuses. Du bilan environnemental – l’objectif de sa présence dans l’Afrique Occidentale qui attire les pressions et les convoitises (les investisseurs, les institutions, les ONG…) – nous ne saurons pas grand-chose : un dossier est remis sur un comptoir lors d’une scène rapide qui ne donne lieu à aucun rebond narratif.
L’ingénierie demeure à la périphérie du film. C’est la vie tout autour de l’ingénierie qui concentre l’attention de Le rire et le couteau. Et les péripéties de cette vie se situent aux antipodes des missions professionnelles de Sergio (l’évaluation, la mesure, la maitrise verticale). Elles sont denses : d’appétits, de curiosités, de confusions. Une autre sorte d’enquête s’égrène sous nos yeux et nos oreilles. L’enquête traverse les milieux sociaux et culturels de la Guinée Bissau contemporaine moins guidée par une méthode que par les rencontres, les attraits et les malentendus.
Cette enquête incarnée reflète le tâtonnement d’un branco qui doute de ses appuis et de sa justice, qui découvre sans cesse la distance qui le sépare de gens qu’il désire, qui essaie de trouver une horizontalité peu compatible avec l’histoire qui surplombe les individus. Sommet de la hiérarchie géopolitique et acteur récalcitrant d’une certaine machine néocoloniale, l’ingénieur-européen-blanc-Sergio fait l’expérience d’une difficulté laborieuse à obtenir la place à laquelle il aspire (amicale, amoureuse, intellectuelle). Il est confronté à l’incompréhension, l’obstruction, le décalage. Son corps blanc, sa blanchité est un passe-partout et un passe-nulle-part, à la fois : il lui permet d’avoir des choses qu’il est de moins en moins sûr de vouloir. Il obtient facilement la reconnaissance de ceux qui guident le développement néocolonial qu’il refuse. En revanche, il n’arrive pas à satisfaire son besoin de reconnaissance de la part des personnes et des communautés qui l’attirent, physiquement et moralement. Des écarts s’y immiscent souvent, sa fierté s’étiole, son sens éthique tremble aussi. Lorsqu’il refuse le pot de vin des premiers, les deuxièmes ne lui adressent aucune déclaration d’admiration pour son intégrité. Au contraire, Diara accuse virulemment le privilège et le confort matériel qui lui permettent cette moralité. La bonne foi n’est pas une garantie magique et transparente. L’universalité de valeurs apparemment indiscutables s’effrite face à des prises de position situées.
La situation se prête à l’humilité de l’écoute et à l’attention, à apprendre plutôt que prendre. Sergio observe et entend, plus qu’il n’agit ou s’exprime. Le rejet n’est pas absolu. Des complicités fleurissent. Souvent charnelles, souvent opaques, elles passent par les fêtes nocturnes et la sexualité. C’est aussi au cœur de ces nuits festives que la philosophie se manifeste. Aux comptoirs – dans les lumières stroboscopiques, une musique dansant en arrière-fond, une bière à la main – on spécule : là remontent les interrogations visqueuses de la réalité vécue par les personnages du film, Sergio tout d’abord. C’est précisément dans les soirées festives que les questions autour de la présence et des identités refont incessamment surface. Es-tu là, Sergio ? Es-tu moins preto que lui, Guilherme ? Dans cette non-coïncidence avec soi-même et ses aspirations surgissent « le rire » et le « couteau » : l’ironie joyeuse et les dilemmes douloureux, l’entente et la mélancolie. Les liens sont splendides et indécis.
L’importance des attirances corporelles, l’exploration des plis sombres de la modernisation à l’œuvre dans les paysages, la vitalité et la tendresse non dépourvues de tensions dramatiques, l’approche inquiet d’une altérité désirée et inappropriable : quelque chose de pasolinien – de son oscuro scandalo della coscienza, de son essere con te e contro te – semble circuler dans les veines du film3. La structure même du scenario organisé autour d’un long repérage justifié pour des missions professionnelles pourrait reconduire au protocole des sopralluoghi qui avait caractérisé les films de notes réalisés par Pasolini sur les territoires de la décolonisation (Palestine, Inde, Afrique subsaharienne). Au-delà des spéculations critiques, le corps-à-corps documentaire du cinéaste avec ces territoires de l’Ouest africain demeure une certitude attestée dans sa filmographie : Bab Sebta (2008), As Cidades e as Trocas (2014). Au-delà des filiations chronologiques, le travail de Pedro Pinho trouve son contexte dans l’originalité de la scène portugaise contemporaine qui su raconter par des singularités puissantes les tensions de notre présent (questions decoloniales, questions de genre…) : Pedro Costa, Miguel Gomes, Joao Pedro Rodrigues…
Petit pays lusophone sur l’Océan Atlantique, ces dernières années la Guinée Bissau est devenue un lieu important de la réflexion cinématographique autour l’héritage de la colonisation et des luttes de libération. Le travail de la cinéaste portugaise Filipa Cesar, épaulée depuis longtemps par le milieu festivalier et productif français, constitue un laboratoire essentiel pour cette réflexion. Depuis une dizaine d’années Spectre a accompagné ses essais filmiques en dialogue avec l’histoire et le territoire guinéens : Transmission from the Liberated Land (2016) Spell Reel (2017, avec Flora Gomes et Sana na N’hada), Quantum Créole (2020) et Mangrove School (2022, avec Sónia Vaz Borges). La société d’Olivier Marboeuf a également produit le récent long-métrage Nome (2023) du cinéaste guinéen Sana na N’hada, formé pendant le conflit contre le Portugal.

Chez Filipa Cesar l’enregistrement du documentaire et la spéculation théorique de l’essai sont associés à une nécessité d’implication performative du travail artistique, une action collective qui teste une légitimité. Il faut que quelque chose se passe, là. Il faut que les rencontres et les solidarités (cine-kins) à l’origine des réalisations cinématographiques se concrétisent activement, productivement, sur le terrain. Le discours, l’art ne suffisent pas. Il y a des archives argentiques de la lutte de libération jugées irrécupérables et negligeables : grâce à des moyens allemands, ces lambeaux d’archives sont resuscités numériquement et alimentent des gestes itinérants de programmation et diffusion qui réunissent européen·nes et guinéen·nes autour de l’héritage inachevé d’une mémoire decoloniale : Spell Reel. La Mediateca Onshore – un espace de rencontre et de mobilisation communautaire, mais aussi un lieu d’archivage et de création– est le cœur de Resonance spiral (2024) de Filipa Cesar et Marinho de Pina où la tentative de s’accorder et vibrer ensemble dans un même engagement passe surtout par le son (chants, documents sonores). Accorder les temps passés et présents, les arts et les économies, les communautés locales et les activistes d’Europe. Au centre de ce film, une longue conversation-rêverie entre Filipa et Marinho explore les résonances et les dissonances : la tension. On parle de ce qui réunit les deux mondes (un même néolibéralisme, capitaliste et individualiste, et sa « corruption du commun »), on parle également de ce qui les sépare.
Perchés sur la mangrove au début, les deux cinéastes descendent lentement dans le marais boueux. En même temps iels s’immergent dans l’ambiguïté de chaque monde et dans la friction de leur rencontre. La Guinée libérée a coupé les arbres que les portugais avaient plantés méthodiquement à cause du trafic de bois orchestré par ses dirigeants. Mémoire impure et contradictoire : « Quand on partage de photos de Bissau et on est fier de comment la ville était belle et propre, mais ce sont des photos de la période coloniale. C’est confus. ». C’est Marinho qui réfléchit, puis il poursuit : « Qu’est-ce que tu cherches Filipa ? Quel rachat ? ». Et elle répond : « Peut-être de rester en constante relation avec la différence. Je suis fatiguée, mais je veux rester là embourbé dans le conflit, dans l’échec incessant de la lutte pour l’horizontal. Dans cet enchevêtrement où j’arrête d’être significative et je deviens part de l’insignifiance des choses. Je ne peux pas commettre le suicide da ma classe, quoi que j’en dise. Malgré tout le privilège que je mets au service de notre lutte ici, l’incohérence est insoluble. Ma capacité d’action – cette capacité de procurer à la Mediateca des moyens d’existence entre bulle artificielle et appropriation attentive de la communauté – demeure contaminée par la contradiction… ». Marinho confirme, mais il précise : « La contradiction ne cesse jamais. Il faut réduire l’incohérence au minimum possible. C’est important d’en être conscient, à mon avis. Mais cette conscience, est-elle tout ce dont on a besoin pour rendre nos actions légitimes ? On vient de loin, on rentre dans la boue. Ici dans le désordre. ».
Staying with the trouble. Faire encore des liens dans le trouble decolonial. Le faire humblement.
Jacopo Rasmi
1 Lionel Rouffel, Brouhaha. Les mondes du contemporain, Lagrasse, Verdier, 2016.
2 Anna L. Tsing, Frictions. Délires et faux-semblants de la globalité, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2020.
3 À savoir :« scandale obscur de la conscience », « être avec toi et contre toi » . Voir : Pier Paolo Pasolini,Les cendres de Gramsci, Paris, Ypsilon, 2025.