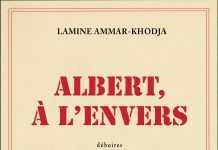Pour commencer, il n’y a pas de cinéma algérien. Comme il n’y a pas de cinéma français ou brésilien. Il y a le cinéma. Point.
Quand je regardais les films de Pasolini sur mon petit écran
(grande parenthèse) c’est probablement un truc de ma génération, mais pas uniquement… Je me suis mis à regarder maladivement tout ce qui me tombait sous les yeux durant mes années d’études, dans une chambre universitaire, à Paris… Je vivais alors avec 400 euros par mois… Autant dire juste de quoi payer la chambre, manger et boire un verre de temps en temps… Je ne suis devenu un assidu des salles obscures que par la générosité d’un groupe d’amis bienveillants qui m’a offert un passe pour la Cinémathèque… Et si aujourd’hui je veux faire des films, c’est probablement par leur faute !
Bref, les films de Pasolini sur mon petit écran me faisaient un effet étrange : Pasolini aurait pu être Algérien. J’ai mis du temps à comprendre que je plaquais mon référentiel de pensée, mon vécu (de plus j’étais en terre étrangère, ce qui n’a fait que grandir ma confusion), sur ce que racontait ce cinéaste italien. Voilà comment dans un 12m2, Pasolini devenait Algérien malgré lui. De même, je crois que lorsqu’on projette un film de Welles au Japon, Welles devient Japonais, et on peut continuer : Teguia Italien, Ozu Iranien, etc. Ce qui prouve bien que le cinéma est d’abord une histoire de voyage. Et son territoire, l’imaginaire, un vaste espace riche en relief. Pourtant, il suffit d’y planter un drapeau pour que ce territoire devienne aussi plat que la Belgique, soit un espace quasiment sans intérêt (que mes amis Belges m’excusent cette image…je n’ai pas d’amis Belges…)
Si le cinéaste est un voyageur et l’imaginaire un espace à explorer, alors pourquoi lui poser une limite, voire une frontière (…) ?
LA RABBIA OU LA PROSTITUTION
On pourrait aussi se demander pourquoi écrire des choses que les gens intelligents savent déjà ?
Passé : dans les années 70’s, l’Algérie (alors jeune tulipe tiers-mondiste) a formé des « cinéastes officiels » qui ont donné des films imbuvables pour des yeux qui aiment le cinéma et sa complexité. Deux cinéastes ont tenté de sortir de ce carcan (Zinet, Beloufa) pour pondre un Ovni chacun avant d’être remerciés (l’un est devenu aliéné, l’autre s’est exilé physiquement et mentalement). Je ne parle pas de Merzak Allouache, car au vu de ce qu’il a fait depuis Omar Gatlato, on peut penser que ce film est une erreur de parcours…
Présent : je constate qu’il y a toute une génération de jeunes cinéastes prêts à porter l’étendard national pour faire des films algériens, comme ils disent. Naturellement, ils ne sont pas jeunes. Être jeune, c’est d’abord remettre en cause le legs des anciens. Mais comment remettre en cause un legs qu’ils ne connaissent pas ? Ce sont ces mêmes cinéastes étendards qui sans avoir vu les films de leurs pères, en rentrant chez eux, se ruent sur les films de Truffaut, Pialat ou Kubrick…
La vérité (et ils le savent très bien ces petits malins), c’est que lever le drapeau revient à secouer la machine-à-sous côté Ministère de la culture. C’est ce qu’on appelle le plus vieux métier du monde. C’est aussi ce qui divise la nouvelle génération de cinéastes en deux parties : les nouveaux cinéastes officiels, ceux qui touchent la thune de l’État. Et les indépendants, ceux qui galèrent.
Pour ma part, je crois que le deuxième groupe est beaucoup plus intéressant pour plusieurs raisons : d’abord parce qu’il n’hésite pas à couper le cordon ombilical sans ménagement (ce geste si vital dans une société patriarcale où le père écrase toute arrogance du petit), ensuite le manque de moyens oblige à chercher des systèmes D pour effectuer un tournage. Cette recherche est synonyme d’inventivité et donc d’originalité. Voici une de mes citations favorites : si tu trouves c’est que tu n’as pas bien cherché.
Pour embrayer sur la faim et ses moyens, le fait que l’argent ne soit distribué que d’un seul côté, celui de la prostitution, crée un sentiment d’injustice chez les galériens qu’on peut appeler la rabbia. Cette rage, je le dis par conviction, est saine pour la création. Elle malmène l’égo du cinéaste et la seule chose qui peut le rassasier de cette injustice est de montrer qu’il a quelque chose dans le ventre. Pour ça, il faut d’abord lutter contre tout ressentiment. Le meilleur discours, la meilleure réponse à la crétinerie et à la suffisance, c’est le talent. Concentrons-nous donc sur notre travail. Point.
LA FAIM
Tourner sans argent ne date pas d’aujourd’hui. La jetée de Chris Marker a été tourné avec un simple appareil photo et une caméra empruntée pour quelques heures. Barravento, premier film de Glauber Rocha (lui qui disait : « une idée en tête, une caméra à la main ») a couté 9000 dollars, autant dire juste de quoi payer la pellicule. Nanni Moretti a tourné son premier long métrage en Super 8 (le format amateur de l’époque). Plus récemment, Avi Mograbi a accouché de Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel, son premier long métrage avec une petite caméra DV. Je n’oublie pas Pedro Costa, Rabah Ameur-Zaïmeche, ni même Denis Gheerbrant qui vient de terminer La République Marseille, monument vivant de 7 films sur la ville en question. Et que dire de Wang Bing et Zaho Lang (à eux seuls, c’est deux là sont entrain de porter la Chine à bout de documentaires, tournés par la force de la volonté). Plus proche de nous, Tariq Teguia (indéniablement notre cinéaste – pas que le nôtre d’ailleurs -, le plus important aujourd’hui) qui a mis sept ans à faire son premier film (après écriture du scénario et recherche d’un producteur) et a tourné Roma wala n’touma (Rome plutôt que vous) avec une petite caméra DV empruntée au Centre Culturel Français. J’ai vu l’objet en question, et ça ressemble plus à un jouet qu’à une caméra. Il a cependant compris une chose essentielle concernant la production indépendante : il est plus facile d’avoir de l’argent avec des images déjà en boîte. En ce sens, il nous a montré un chemin à explorer. Je dis un chemin car il y a autant de méthodes que de cinéastes. Le plus important est que les films existent. Et le manque de moyen est tout sauf un prétexte. Rappelons-nous que la Nouvelle Vague n’est rien d’autre qu’une bande de cinéastes qui a fait des films pas chers. Avant d’en faire, ils avaient quasiment pris le maquis culturel (par les Cahiers) pour descendre le cinéma de leurs pères. Encore une autre méthode. De tout temps, les cinéastes les plus intéressants ce sont démerdés pour accoucher de leurs bébés contre vents et marées. Le cinéma officiel n’a jamais créé de tournant, il a prolongé l’existant. Le cinéma est né de la contrainte, son histoire le prouve.
BILLY
Je dis ça alors que je viens seulement de voir Pat Garett et Billy the Kid de Sam Peckinpah. Je note que Pat se range du côté de la loi (il devient shérif) car il est vieux et il joue la carte de l’assurance. Rongé par la peur, il va aller jusqu’à traquer son ancien camarade hors-la-loi : Billy, dit le Kid. Billy, lui est jeune et ne veut pas mourir de l’intérieur. Il a la vie devant lui et continue à traîner avec ses vieux amis, des Mexicains. Pour lui, pas question de devenir un gringo. À la fin, tout le monde connaît l’histoire, Pat Garett tue Billy the Kid, mais en faisant ça il tire sur sa propre image. Pat Garett et Billy the Kid faisaient partie du même bateau. Chacun a suivi sa route. Non, il ne s’agit pas de morale mais d’éthique.