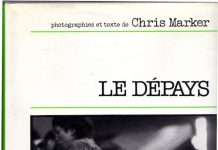Car il se trouve qu’Alexandre Ivanovitch a été mon ami, et que j’ai même eu la chance déjouer un rôle dans sa redécouverte. Cet homme exemplaire était à peu près inconnu aux années 60. Son nom ne figure même pas dans le dictionnaire de Sadoul. C’est le hasard d’une projection du Bonheur à la Cinémathèque de Bruxelles (une main anonyme avait joint la copie à un lot de films plus classiques, comme une bouteille à la mer) qui m’a mis sur sa piste. C’est le hasard d’une rencontre au Festival de Leipzig en 1968 qui m’a mis face à face avec un homme que je croyais mort et enterré. C’est l’air du temps qui a permis à cette rencontre de se concrétiser dans un petit film, Le train en marche, où pour la première fois il racontait une expérience unique, et complètement oubliée, datant de 1932 : Le Kinopoezd, le Ciné-Train.
Un train. Un train-cinéma, transportant sur ses boggies du matériel de tournage, un laboratoire, des salles de montage, une imprimerie, un camion et un « chameau de remontrance ». L’équipe arrivait dans une usine, dans un kolkhoze, interrogeait les gens « qu’est-ce qui ne va pas ? ». On les filmait. Les rushes étaient tirés dans la nuit, montés dans la journée. Le lendemain soir, le film était montré, et la discussion repartait, basée sur « cet événement émouvant » disait Medvedkine « de se voir soi-même à l’écran ». Il avait inventé le reality-show avec 60 ans d’avance, et une approche un peu différente.
On imagine qu’une expérience de cinéma aussi libre, échappant totalement au contrôle du pouvoir central – même si elle était nourrie de l’idéologie productiviste de l’époque – ne pouvait pas durer longtemps. Medvedkine rappelé au studio allait mener une étrange carrière de dissident malgré lui. A chaque film, il se proposait sincèrement d’illustrer la ligne du parti. A l’arrivée, comme par un fait exprès, le film se retrouvait au placard, sous les accusations les plus saugrenues, comme le boukharinisme du Bonheur. Il concluait vertueusement une comédie surréaliste sur la reconstruction de Moscou, Novaia Moskva, par un hommage à Staline sans-qui-tout-ça-n’aurail-pas-été- possible, et le film était interdit « parce qu’il ne donnait pas une image sérieuse des architectes ». Il écrivait un scénario, Cette sacrée force, l’histoire d’un soldat mort qui jetait la pagaille successivement au Ciel et en Enfer pour illustrer l’esprit d’initiative socialiste, et le tournage était interrompu dès le premier jour. Quelques commandes officielles, puis la guerre, lui permettraient de survivre jusqu’à une époque où son talent, bridé, entravé, ne jaillirait plus que par éclairs d’une production plus terne. C’est à ce moment-là que j’ai rencontré et que j’ai bricolé à la hâte le petit film sur le Train, qui, dans mon esprit n’était que le film-annonce de celui que je ferais un jour un jour – qui me paraissait bien lointain. Tant de choses devaient se passer en Union Soviétique pour qu’il devienne possible…
Et bien des choses se sont passées, et même beaucoup plus que nous n’imaginons. Et ce film rêvé est devenu possible. J’ai retrouvé des témoins, des amis, sa fille Chongara qui maintenant peut dire comment son père lui avouait que, petite fille, pendant qu’elle dormait, il guettait les pas des flics dans l’escalier et poussait un soupir de soulagement quand ils dépassaient son étage. J’ai retrouvé Viktor Diomen, le premier à avoir déniché une copie du Bonheur, totalement oublié, et ameutant tous ses amis au téléphone « Venez voir ce que je viens de voir… » Et j’ai rencontré des étudiants du VGIK pour qui ce film avait complètement transformé la perception des années 30. J’ai retrouvé Vladimir Dimitriev, l’homme de la « bouteille-à-la-mer », celui qui avait pris sur lui d’ajouter une copie du Bonheur aux colis destinés aux cinémathèques étrangères, dans l’espoir qu’un jour quelqu’un ferait quelque chose… J’ai rencontré Marina Goldovskaia, l’auteur de l’admirable film Solovki Power, la dernière à avoir interviewé Medvedkine, et dont le témoignage est particulièrement précieux, car de son statut inattaquable d’historienne du Goulag, elle refuse de juger le communiste Medvedkine « ses films ont été utilisés par une idéologie, qui me dit que les miens ne le seront pas par une autre ? » (Elle se souvient aussi de Dziga Vertov, « un petit homme triste et amer, qui n’avait pas d’amis »). Et en contrepoint tragique à l’épopée de la cavalerie rouge, le témoignage de la veuve de Babel, Antonina Nikolaievna Pirojkova, parcourt la même zone de temps sous le signe de l’horreur et du mensonge, puisque n’ayant cessé de chercher à avoir de ses nouvelles et d’intercéder pour lui, ce n’est qu’en 1955 qu’elle apprendra qu’il avait été fusillé en 1940.
Et puis Nikolai Isvolov : lui, étudiant au VGIK, se passionne pour l’expérience du ciné-train, et alors que tout le monde, à commencer par Medvedkine lui-même, était sûr que tout ce matériel encombrant avait disparu, il retrouve les films. Je dois dire que leur vision aujourd’hui est saisissante : la vie quotidienne des mineurs du Donbass, dans la boue et la misère, montée en parallèle avec la tablée des activistes qui parlent et parlent… Et cette question lancinante qui revient sous forme de carton (un carton qu’ils utilisaient dans presque tous les films du train) « Camarades, comment acceptez-vous de vivre ainsi ? » On imagine la tête des bureaucrates.
Je dispose donc de ces films totalement inédits, de même que les longs métrages ultérieurs de Medvedkine, y compris les plus contestables (mais aussi révélateurs historiquement) de l’après-guerre et de sa période « chinoise », quand il se spécialisait dans la dénonciation du maoïsme (dénonciation codée, disait-il : il fallait y voir le stalinisme) avec en contrepoint un témoignage inédit de Mikhaïl Romm sur la façon dont Khroutchev leur expliquait sa rupture avec Pékin survenue dans une piscine… mais je ne vais tout de même pas tout vous raconter maintenant. Je dispose de documents rares sur les années 20, des témoignages précédemment cités et de beaucoup d’autres. J’ai filmé Yves Montand venant présenter L’aveu à Moscou, et là encore deux cycles d’amitié et d’histoire se croisent (je n’ai aucun état d’âme à inscrire ma propre histoire dans l’Histoire : elle est la nôtre, cette tragédie-là nous a tous marqués). J’ai filmé Moscou à l’heure de la perestroïka, les bouches qui s’ouvrent, les discussions sur les trottoirs. Et comme il ne s’agit surtout pas d’un film archéologique, et que je tiens à enraciner cette aventure dans l’actualité, mon ami Andrei Pachkevitch joue pour moi le rôle d’antenne moscovite et me constitue mon petit CNN personnel. J’ai ainsi de lui un tournage inédit du putsch, des manifs également délirantes, également éloignées dans le temps, et dans un sens également pathétiques, tsaristes et staliniennes, le jour de l’anniversaire d’Octobre, et les duretés de la vie quotidienne à Moscou en 1992. C’est donc de ce point d’achèvement que sera embrassée, enroulée comme un drapeau rouge autour de la vie d’Alexandre Ivanovitch, l’aventure de ce siècle.
Malraux ne disait-il pas que la mort transforme la vie en destin ?
Texte paru dans la revue Images Documentaire n°15, 1993