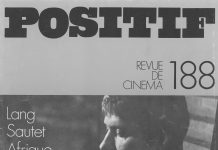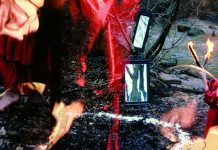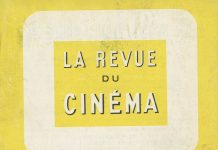Les films de Béla Tarr m’ont beaucoup marqué, et après avoir revisionné ses trois derniers, Damnation, Satantango et Les Harmonies Werckmeister, je me prends à essayer de reconsidérer la grammaire cinématographique et l’effet que l’Histoire a eu sur elle, le cinéma étant né pendant la révolution industrielle. C’est ainsi que je vois les choses. Le cinéma a commencé par des compositions scéniques filmées en un plan unique sur toute leur durée et qui ressemblaient au théâtre, le seul point de référence qu’il avait trouvé pour favoriser sa commercialisation. Au cours des vingt années suivantes, un vocabulaire nouveau s’imposa. Le gros plan, le montage, les récits parallèles vinrent fragmenter la continuité des images auparavant filmées selon un seul cadrage statique et comme enchâssé dans un proscenium. Des fragments indépendants étaient désormais assemblés pour créer du sens, et le réalisateur pouvait jouer avec le temps et l’espace cinématographique. C’était passionnant. Était-ce une direction absolument incontournable ou juste une voie parmi d’autres que le cinéma avait choisi de prendre?
Je crois que ces inventions cinématographiques ont flatté l’industrie et donné naissance à un vocabulaire industriel. Le réalisateur pouvait à présent vous indiquer comment il fallait percevoir les scènes par la manière dont il jouait avec les éléments distincts. Il pouvait être maître de ses personnages, du temps et de l’histoire, et de vous. C’est devenu un divertissement que le réalisateur et ses investisseurs de l’industrie pouvaient contrôler. On a réduit tant qu’on a pu le cinéma à un simple produit, dont on pouvait envisager de façon plus fiable la fabrication de masse. Délaissés, le dispositif théâtral et le cadre statique sont complètement tombés en désuétude.
A présent les choses étaient modernes, plus faciles. C’était comme pour la lessive : il y avait désormais une machine qui la faisait pour vous. Le cinéma moderne se transformait en une invention capable de penser à votre place — vous n’aviez plus à le faire vous-même comme c’était encore le cas au théâtre.
Le cinéma de l’industrie s’est transformé en méga-industrie et en méga-cinéma tout en restant parfaitement le même : le vocabulaire cinématographique d’une série télé de 2001 telle qu’Ally McBeal est quasi identique à celui de Naissance d’une nation. Il n’est pas étonnant que Citizen Kane ait été considéré comme le plus grand film de tous les temps, un film où il était question de se laisser porter au gré du courant avec le cuivre, le charbon et le bois, tout en regrettant avec nostalgie une ère victorienne disparue, et les bases originales du vocabulaire cinématographique, un Rosebud qui avait été abandonné dans un autre siècle.
Ici, dans les films de Béla, se trouve un Rosebud perdu, une des voies peut-être nombreuses que le cinéma aurait pu emprunter avant que nous ne nous laissions aller au fil du courant. Son travail me fait l’effet d’une authentique et fructueuse nouvelle direction, d’un cinéma radicalement différent recommençant à son point de départ. Et ce cinéma ne pouvait naître qu’en dehors de notre culture occidentale.
J’ai le sentiment que les films de Béla ont pour influence des vues en plan fixe de machines à vapeur du XIXe siècle entrant en gare, qui poussaient les spectateurs debout dans la galerie à se précipiter vers la sortie pour ne pas être heurter par le train. Je ne sais pas comment il s’y est pris, mais il s’est transporté là-bas psychiquement et à tout réappris comme si le cinéma moderne n’avait jamais existé. Une foule déchaînée s’avance dans une rue pour incendier l’hôpital, dans Les Harmonies Werckmeister, plan qui dure à peu près cinq minutes. Quand, après une projection, on lui a demandé pourquoi ce plan de la foule durait si longtemps, Béla a répondu : « Parce qu’il y avait une grande distance à parcourir. » La question était sincère : pourquoi un public nourri au cinéma industriel postmoderne devrait-il supporter de voir s’avancer pendant un temps si long une foule en furie, alors qu’il s’est habitué à des plans ne durant que quelques secondes (même dix ou quinze seraient déjà excessives) ? Mais la réponse, malgré l’humour, est tout aussi sincère : la distance était suffisamment grande pour que le fait de nous la montrer pendant cinq minutes affecte notre manière d’appréhender l’évènement, la foule et sa progression, l’hôpital. Sans les raccourcis ni le morcellement chers au vocabulaire industriel, mais en accentuant le lyrisme et la poésie, en nous faisant partager des pensées au lieu de juste nous dire une seule chose, du genre : la foule approche ; plutôt, les manifestants s’avançaient et grimaçaient et levaient haut leurs torches, certains marchaient d’un pas synchronisé et d’autres non, ils progressaient, devaient parfois reculer, et une fois arrivés ils avaient parcouru un long chemin.
Hitchcock a déclaré, en réponse à une question de François Truffaut, que de grands changements stylistiques, au cinéma, pouvaient s’opérer par le biais du personnage ; peut-être, mais ici il s’en produit un majeur par le biais des idées.
Les oeuvre de Béla ont une démarche organique et contemplative plutôt que tronquée et contemporaine. Elles s’avèrent contempler la vie d’une manière qu’il est presque impossible de retrouver dans un film moderne ordinaire. Elles sont tellement plus proches des vrais rythmes de la vie qu’il nous semble assister à la naissance d’un nouveau cinéma. Béla Tarr est l’un des rares cinéastes réellement visionnaires.
(Traduit de l’anglais par Jean-Luc Mengus)
* Ecrit à l’occasion d’une rétrospective Béla Tarr au musée d’Art moderne de New-York en octobre 2001, ce texte figure dans le catalogue publié alors par Filmunio Hungary, Budapest.
Texte paru dans la revue Trafic, n° 50, « Qu’est-ce que le cinéma ? », Eté 2004, p. 497-499.