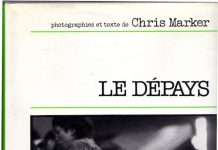C’était un drôle d’objet. Une petite boîte de métal aux coins irrégulièrement arrondis, avec une ouverture rectangulaire au milieu et en face d’elle une minuscule lentille, de la taille d’un euro. On devait glisser par le haut un morceau de film – du vrai film, avec perforations – que pressait une roulette de caoutchouc, et en tournant un bouton relié à la roulette le film se déroulait image par image. A vrai dire chaque image représentait une scène différente, de sorte que le spectacle s’apparentait plus à une lecture de diapositives qu’à du home cinema, mais ces scènes étaient des plans, magnifiquement reproduits, de films célèbres, Chaplin, Ben Hur, le Napoléon d’Abel Gance… Si on était riche on pouvait introduire la petite boîte dans une espèce de lanterne magique et projeter sur le mur (ou sur un écran, si on était très riche). Je devais me satisfaire de la version minimale: appuyer l’œil sur la lentille, et regarder. Ce bidule aujourd’hui oublié s’appelait Pathéorama. On pouvait le lire en lettres dorées sur fond noir, avec le légendaire coq Pathé qui chantait devant un soleil levant.
La joie égotiste de pouvoir regarder pour moi seul des images qui appartenaient à l’inaccessible royaume du Cinéma eut tôt fait de générer un sous-produit dialectique. Alors que je ne pouvais même pas imaginer avoir quoi que ce soit en commun avec l’art de filmer (dont les principes de base étaient naturellement bien au-delà de ma compréhension), voilà que quelque chose du film lui-même était à ma portée, un morceau de celluloïd pas tellement différent de la pellicule des négatifs photos quand ils revenaient du laboratoire. Quelque chose que je pouvais sentir et toucher, quelque chose du monde réel. Et pourquoi alors (insinuait dialectiquement mon propre Jiminy Cricket) ne pourrais-je à mon tour faire quelque chose du même genre? Il suffisait d’avoir une matière translucide, et les bonnes dimensions. (Les perfos étaient là pour faire joli, la roulette les ignorait). Ainsi, avec des ciseaux, de la colle et du papier cristal, je confectionnai une copie fidèle de la vraie bobine Pathéorama. Après quoi, cadre par cadre, je commençai à dessiner une suite de poses de mon chat (qui d’autre?) en insérant quelques cartons de commentaire. Et d’un seul coup, le chat se mettait à appartenir au même univers que les personnages de Ben Hur ou de Napoléon. J’étais passé de l’autre côté du miroir.
De mes camarades d’école, Jonathan était le plus prestigieux. Il avait le don de la mécanique et le caractère inventif, il fabriquait des maquettes de théâtres avec rideaux mobiles, lumières clignotantes, et un orchestre miniature émergeait de la fosse pendant qu’un Gramophone à manivelle jouait une marche triomphale. Il était donc naturel qu’il fût le premier à qui montrer mon chef d’œuvre. J’étais assez fier du résultat, et en lui déroulant les aventures du chat Riri je lui annonçai « mon film » (my Movie). Jonathan me ramena rapidement à la sobriété. « Mais, idiot, le cinéma c’est des images qui bougent » dit-il. « On ne peut pas faire un film avec des images fixes. »
Trente ans passèrent. Puis je réalisai La Jetée.
Texte paru dans le livret du DVD La Jetée – Sans Soleil, 2003