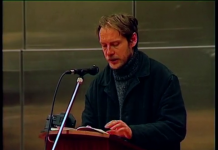Contacts : faidosonore.net et lesvoixdetraverse.com
Texte de Robert Bonamy, 2025
Nulle imagerie pour cette pièce sonore composée en plein terrain. Si Ce qui passe par la Terre ne relève pas du field recording, le documentaire coréalisé par Benoit Bories et Aurélien Caillaux se distingue tout autant des invariants d’émissions avec pieds qu’il faudrait avoir sur Terre, grâce à un en deçà du dit, non sans pudeur ni quelque humour, et un par-delà des choses transmises, qui n’a rien à voir avec les faux étonnements courants et souvent un peu trop limpides.
Plutôt des battements, donc, selon les oscillations des expériences du terrain et de la fréquentation des paysannes et des paysans nouveaux et anciens, dès la première séquence avec la sensation et les évocations des vents des Corbières, pour de véritables rencontres de formes de vies, souvent au travail, qui ne cherchent pas à faire les intéressantes : un terrain d’écoute ne peut se résumer à des concessions pour un terrain d’entente.
La version stéréophonique-binaurale ici proposée n’est pas seule ; la pièce a pu et continue d’être jouée, à l’instar d’un concert, en son spatialisé (selon une installation avec 14 enceintes). Il faudrait à cet égard trouver un adjectif préférable à celui d’immersif, à notre sens quelque peu suspect. Mais les équivalents à l’immersion pour la terre relèveraient trop de l’enfouissement, voire de l’ensevelissement. Plus qu’un enfoncement, la pièce propose plutôt de singuliers passages entre dessus et dessous ou, différemment, entre le vivace et ses envers, voire quelques passages temporels et historiques.
Le territoire existe avec concrétude. La provenance documentaire des sons reste sensible, y compris lorsqu’ils sont déployés, retravaillés, dans des tentatives d’explorations acoustiques aux confins du musical. Les sons enregistrés sont passés ou imprégnés par le terrain et son arpentage. Leur transfiguration ne consiste pas en une décorrélation électroacoustique hors sol, ex nihilo, ne les menant nulle part ; encore moins en une détérioration. Le geste de l’écriture sonore devient un approfondissement esthétique, c’est à dire une pensée de la perception en relation avec des affects afin de faire monde – en l’occurrence poétiquement.
L’une des premières écoutes publiques, sous la forme d’une installation multicanale, appelée “concert documentaire spatialisé”, autour des auditeur·ices fut proposée in situ, dans un champ à proximité d’un village des Hautes-Corbières directement concerné par le présent documentaire sonore. Pour autant, déjà beaucoup des itinéraires sonores et de l’écriture de Ce qui passe par la Terre traverse la version “radiophonique” ici confiée par les deux réalisateurs.