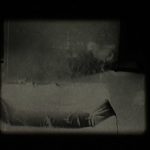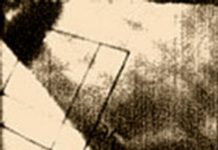Texte de Catherine Bareau, 2002
Paris

Et alors, cette ligne qui paraît être d’erre, par là haut,
aboutit à une étoile située derrière une murette.
Fernand Deligny
D’où sommes-nous ?
Je ne sais pas du tout, dans l’air, dans le feu, partout.
Nos corps, où ?
Nos corps, de l’air ! Le mouvement ? Si lent !
Quelle lenteur, les souvenirs, vagues ! Et puis ?
Tout sombre, tout vit, tout bouge, tout revient, rien n’est passé.
Claudio Parmiggiani
J’avais déjà filmé ces lieux, les Jardins de la Fontaine de Nîmes, en
1988. En 1999, j’y suis retournée après avoir vu La Vallée close de
Jean-Claude Rousseau.
Je place ma caméra en pleine ville sur le passage des femmes, des
hommes, des enfants. Les voir, eux, qui ne (me) (se) regardent pas.
J’y reviens autant de fois qu’il le faut. Errer là, réceptive à ce qui
se présente. « Ce lieu que nous apercevons comme en un rêve et
que nous sommes incapables de distinguer nettement » (Platon).
Ralentir. Je suis dans un décalage du temps, dans la tentative de
créer de la présence au milieu de l’inexistence et de l’inattention du
quotidien. Faire durer, maintenir ce qui se dérobe, ce réel qui nous
échappe, parce qu’on y est comme des poissons dans l’eau. Le réel
se regarde. Comme inaccessible, invisible, enfermé en chacun. Les
portes s’ouvrent ou se ferment, les enfants jouent près de l’eau ou
courent dans les ruines, leurs ombres les devancent sur les marches
d’escaliers.
Être dans le recul du temps. Je suis sur une crête d’où je scrute le
fond des eaux, leur rythme. J’essaie de capter le flux des histoires.
La mienne, la nôtre, la vôtre…
Le drap du lit, la nuit dans la rue, les ruines des jardins, l’enseigne
clignotante d’un cinéma… Chaque image émise par la boîte noire
est la matière d’une pensée qui ne s’échappera pas, comme un mot
gravé définitivement sur une pierre.
C’est seulement à la vision du film développé que des lettres
m’apparaissent soudain sur une devanture abandonnée : un prénom
enfoui se découvre. Des passants, curieux, se retournent sur ce que
je filme, sans rien voir.
Il n’y a pas de scénario, ni de déroulement prévu à l’avance, simplement
une sorte de vacance, d’écoute. Les séquences naissent au
moment du tournage, improvisées, documents sur ma perception
des lieux. Quand je découvre les rushes, le film se met à me regarder.
Je suis sur la ligne de partage, surface sensible, grêlée.
Pièces d’un puzzle dont j’ignore encore l’agencement.
Tel un masque antique, un visage peint en négatif évoque le lieu
d’un drame.
L’eau qui bouillonne semble écarter les bords du cadre, écartèlement,
déchirement de l’écran. Écart tellement.
Ces colonnes et cette eau sont les paupières du temps.
Ne pas trahir ces signes lumineux, ces images élémentaires, en les manipulant
au montage. Laisser le film venir. Je l’accueille, il me cueille.
Les bobines se succèdent : noir et blanc, couleur, négatif, fixant un
état. Les images viennent par petites touches, comme des esquisses
tracées au crayon, dans un visage peint sur un mur, dans l’arrondi
d’un bassin, dans la boucle d’une hirondelle…
Le monde se crée (secret) dans cette alternance du creux et du
plein. En projection, le film apparaît comme une sculpture, debout,
oscillant dans le noir.
1988. En 1999, j’y suis retournée après avoir vu La Vallée close de
Jean-Claude Rousseau.
Je place ma caméra en pleine ville sur le passage des femmes, des
hommes, des enfants. Les voir, eux, qui ne (me) (se) regardent pas.
J’y reviens autant de fois qu’il le faut. Errer là, réceptive à ce qui
se présente. « Ce lieu que nous apercevons comme en un rêve et
que nous sommes incapables de distinguer nettement » (Platon).
Ralentir. Je suis dans un décalage du temps, dans la tentative de
créer de la présence au milieu de l’inexistence et de l’inattention du
quotidien. Faire durer, maintenir ce qui se dérobe, ce réel qui nous
échappe, parce qu’on y est comme des poissons dans l’eau. Le réel
se regarde. Comme inaccessible, invisible, enfermé en chacun. Les
portes s’ouvrent ou se ferment, les enfants jouent près de l’eau ou
courent dans les ruines, leurs ombres les devancent sur les marches
d’escaliers.
Être dans le recul du temps. Je suis sur une crête d’où je scrute le
fond des eaux, leur rythme. J’essaie de capter le flux des histoires.
La mienne, la nôtre, la vôtre…
Le drap du lit, la nuit dans la rue, les ruines des jardins, l’enseigne
clignotante d’un cinéma… Chaque image émise par la boîte noire
est la matière d’une pensée qui ne s’échappera pas, comme un mot
gravé définitivement sur une pierre.
C’est seulement à la vision du film développé que des lettres
m’apparaissent soudain sur une devanture abandonnée : un prénom
enfoui se découvre. Des passants, curieux, se retournent sur ce que
je filme, sans rien voir.
Il n’y a pas de scénario, ni de déroulement prévu à l’avance, simplement
une sorte de vacance, d’écoute. Les séquences naissent au
moment du tournage, improvisées, documents sur ma perception
des lieux. Quand je découvre les rushes, le film se met à me regarder.
Je suis sur la ligne de partage, surface sensible, grêlée.
Pièces d’un puzzle dont j’ignore encore l’agencement.
Tel un masque antique, un visage peint en négatif évoque le lieu
d’un drame.
L’eau qui bouillonne semble écarter les bords du cadre, écartèlement,
déchirement de l’écran. Écart tellement.
Ces colonnes et cette eau sont les paupières du temps.
Ne pas trahir ces signes lumineux, ces images élémentaires, en les manipulant
au montage. Laisser le film venir. Je l’accueille, il me cueille.
Les bobines se succèdent : noir et blanc, couleur, négatif, fixant un
état. Les images viennent par petites touches, comme des esquisses
tracées au crayon, dans un visage peint sur un mur, dans l’arrondi
d’un bassin, dans la boucle d’une hirondelle…
Le monde se crée (secret) dans cette alternance du creux et du
plein. En projection, le film apparaît comme une sculpture, debout,
oscillant dans le noir.
Aujourd’hui je n’ai pas regardé les bobines
Je ne les ai pas reliées
Je reste sous les draps même si le feu brûle dehors.
Il faut une unité de mesure.
Un retrait nécessaire pour que l’image s’offre.
Poser sa caméra à la mesure.
Me défaire.