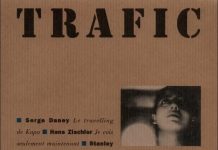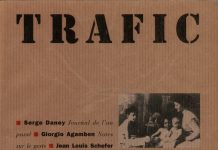Comme tout bateau qui vient de comprendre qu’il peut couler, la télévision devient intéressante et de vraies questions se profilent enfin à l’horizon de notre cathode exaltée. Certaines de ces questions sont carrément massives. Par exemple, à quelles conditions les chaînes, afin de produire leurs maillons de demain (vous, moi, mais dans des versions plus dociles, moins râleuses), travaillent-elles dès aujourd’hui aux nouvelles formes du gardiennage social ? Quel rôle aura joué la télévision dans la grande affaire qui agite les pays ultramodernes, à savoir la mise sur pied d’un vrai marché de l’individu (qui n’est peut-être qu’un sympathique marché d’esclaves) ?
Car si la télévision a commencé par conquérir le marché, il serait naïf de penser que cette conquête suffisait à produire la marchandise adaptée au marché, c’est-à-dire l’individu « professionnel » d’aujourd’hui. Depuis longtemps déjà, nous assistons au formatage de ce nouveau « héros » de notre temps : de plus en plus personnalisé, badgé, épinglé, c’est-à-dire réduit au folklore criard de sa petite différence.
Personne, évidemment, n’a pensé ce processus mais il a été possible, depuis quelques années, d’en suivre quelques épisodes. L’auteur de ces lignes, par exemple, s’est souvent senti bien seul à assurer ce suivi-là.
Ne revenons pas trop sur les épisodes connus : la refonte du personnel communiquant dans le sens d’une dé-légitimation progressive de ses membres. Les anciennes raisons qui assuraient un certain droit à intervenir dans l’espace public (passion, pédagogie, compétence, talent, beauté, rareté) ont dû céder la place aux mauvaises manières d’un mercenariat vide mais sympathique et sans chichis. Il est devenu gênant d’être « M. Je-Sais-Tout » dans un médium qui édifie son pouvoir sur le partage équitable de l’ignorance et de l’indifférence moyennes.
Cette dé-légitimation a durement touché les hommes politiques, êtres naïfs qui n’ont pas vu qu’à force de se voir si beaux dans leurs « heures de vérité », ils alimentaient rien moins que le national-lepénisme, et lui seul. D’où d’âpres débats : démocratisation ou consensus ? Consensus ou démagogie ? Démagogie ou fascisation (molle) ? Toujours est-il que cette dé-légitimation n’a épargné aucun secteur de la « représentation sociale », journalistes compris.
En gros, la société bourgeoise a cessé de payer des griots de bonne volonté afin de se représenter ses propres valeurs, préférant au vieux théâtre du dissensus sonore les images en boucle du silence consensuel. Cela ne peut que laisser rêveur quiconque a vécu la crise de l’idée de représentation, théoriquement malmenée dans les années soixante et carrément lacérée en 1968. Aurions-nous exagéré ? Qui repensera tout cela ?
La télévision a été le lieu récent de ce basculement. Il a fallu la politique capricieuse et nulle des socialistes français pour que le bon peuple comprenne enfin que la télé était en train d’échapper aux notables, aux requins et aux éducateurs et pouvait devenir enfin sa chose à lui, c’est-à-dire aussi frivole et démunie que lui. C’est tout le sens du soutien à La Cinq, devenue quelque chose entre Justine et la Sainte Cinq depuis qu’elle a été vue, soudain très humaine, en train d’informer sur elle-même et de gémir (avec raison) sur ses malheurs et les infortunes de sa vertu.
La télé enfin rendue au peuple ? Pourquoi pas ? C’est, du moins, ce qu’on dit du côté des jeunes loups de Sygma-TV. Pourtant il ne faut pas croire, là non plus, qu’une telle opération puisse se faire toute seule. La télé ne sera rendue au peuple que si le peuple devient en même temps un « télé-peuple » et il faudra, là comme ailleurs, des techniciens pour travailler à (et profiter de) cette mutation. Car il s’agit d’un gros morceau : le re-formatage dudit peuple, à qui il est demandé de jouer son rôle, mais plus seulement sous forme de masse inerte, d’audimat justicier, de candidats couillons ou de bétail applaudissant, mais bel et bien de héros personnalisés.
D’où des émissions comme la Nuit des héros ou Perdu de vue, titres où se lit bien l’idée d’émergence au grand jour ou de retour à la lumière. Car il ne s’agit évidemment pas dans ces émissions de n’importe quel type d’héroïsme (il en est de très paradoxaux), mais uniquement de petits faits divers qui vont dans le sens unique (et familial) d’une mythologie du rachat et de la seconde naissance. A l’époque du new age, il faut accepter l’idée qu’un tel mythe puisse être, en dernière analyse, le seul horizon d’une télévision qui a, d’autre part, renoncé à presque tout.
Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Il est sûr, en tout cas, que le résultat n’est esthétiquement « pas regardable ». Aussi est-il probable que si ça marche si fort, c’est que ça n’intéresse pas le regard (car il y a dans le regard une possibilité de recul critique, de sursaut éthique ou de verdict esthétique) mais bien autre chose. Rien moins que l’apprentissage collectif des gestes par lesquels une grande masse d’exclus apprendra à jouer son rôle dans les scénarios « personnalisés » dont on l’assure qu’ils sont – enfin ! – les siens. Pourquoi pas ?
S’il en est ainsi, il est certain que cette mutation met en crise d’autres mythologies, celle de l’artiste, bien sûr, mais celle de l’acteur aussi bien. Car qu’est-ce qu’un acteur sinon l’homme d’une passion immémoriale, cette passion d’être un autre qui pré(dis)pose certains d’entre nous à « prendre sur eux », pour la rejouer, l’expérience des autres ?
C’est évidemment le sens des attaques de Patrick Sébastien contre la Nuit des héros. Au moment où nous sommes tous invités par avance à être un par un les héros de nos propres vies (des vies que désormais nous « possédons » et dont nous finirons bien par savoir vendre le copyright), comment l’acteur-imitateur professionnel ne se sentirait-il pas menacé dans son être ? Il lui vient, en effet, un terrible soupçon : son talent particulier intéresserait beaucoup moins son public que le non-talent (voire la nullité désolante) de ces « héros » sortis de la nuit et qui, warholiennement, y retournent !
La « passion d’être soi-même » remplacera-t-elle, à terme, la « passion d’être un autre » ? S’agit-il d’un moment – médiocrissime mais provisoire – de la grande histoire de l’émancipation humaine qui, même en dents de scie, sécularise les croyances et individualise les hommes depuis des siècles ? Suffit-il à chaque fois de redessiner les frontières entre le marché profane et l’humain profané, c’est-à-dire la part de sacré et d’inégociable (appelons ça autre) qui demeure(ra) toujours au cœur de l’animal humain ? On peut le penser, certes, mais d’une pensée elle-même sans joie.
Car dans cette histoire de marché de l’individu, dont les « reality shows » américains sont le dernier symptôme en date, on voit bien ce qui doit être perdu et le prix qui doit être payé. Perdue de vue, définitivement, l’idée d’expérience humaine. C’est comme si la télévision avait assis d’un coup tout un peuple sur le divan d’un psychanalyste qui travaillerait « à la chaîne » (sic) et qui, au lieu d’écouter sans un mot les trop belles élucubrations du « moi » légendaire, applaudirait son client dès la première séance en lui disant : vous êtes sublime, ce que vous avez raconté est exactement ce que vous avez vécu, rejouez-le dans notre télé-style maison (qui est, d’ailleurs, votre maison) et vous serez guéri.
Peut-on jeter aussi vite le bébé de l’expérience humaine avec les eaux (certes usées) de quelques siècles récents ? Cela ne paraît pas raisonnable. Jusqu’à une date très récente, celui qui, par goût ou par métier, posait des questions à ses semblables savait que rien n’est moins facilement communicable qu’une expérience. C’est même à cette difficulté qu’on reconnaît qu’il s’agit d’une expérience. « C’est allé très vite, je n’ai rien senti (rien compris, rien vu…). C’est après que… C’est très difficile à expliquer… Aujourd’hui encore… » sont les phrases que des millions de magnétophones et des tonnes de caméras ont enregistré pendant des lustres.
Et c’est bien parce que l’expérience échappe – dès qu’elle est forte – qu’il y eut si longtemps des médiateurs (allant du saint au charlatan et de l’ami au traître) pour aider à trouver « les mots pour le dire ». Et des acteurs pour y prêter leur corps, des artistes pour s’y casser le nez et des écrivains pour conclure tristement, comme Virginia Woolf : « Les expériences de la vie sont incommunicables, et c’est ce qui cause toute la solitude. »
Toute expérience qui se réduit facilement au « show » de sa « réalité » n’est pas une expérience. Ou plutôt, ce n’est pas celle du sujet qui dit qu’il l’a vécue, mais celle du groupe en panne d’idéal, qui préférera toujours le spectacle rectifié et imitable du re-jouable à l’ami-spectacle intime du déjà-joué. Il y va de la possibilité même du « lien social » et il ne faut pas croire que, du temps de sa splendeur, Hollywood ait procédé à autre chose (il suffit de revoir les films de Sirk).
Il est donc possible que le grand marché de l’individu à base de héros jetables et de scénarios comme il faut ait décidé de passer, avec l’accord des intéressés, à la contre- offensive. C’est pourquoi l’idée de vérité subjective « saute » un peu partout à la télévision ou apparaît comme luxe élitaire et définitivement insupportable. Possible même que la cathode trouve enfin une mission à la mesure des intérêts politico-mythologiques du groupe France : celui du catéchisme.
Pourquoi « catéchisme » ? Parce qu’il s’agit d’une chose sérieuse, pas tellement cynique et qui, comme la pub, a à voir avec le Bien. Bien dont les futurs acteurs de la guerre économique, une fois évaporé l’empire (communiste) du Mal, auront bien besoin pour croire au sens de ce qu’ils font. Cela dit, le catéchisme n’est ni la foi du charbonnier ni la science du théologien, c’est un ensemble concret de procédures bébêtes qui transforme ses ouailles en marionnettes acceptables d’une croyance dont elles n’ont plus, depuis belle lurette, à faire l’expérience.
En ce sens, le catéchisme de la Nuit des héros ou de Perdu de vue est l’application bien-pensante et pantelante d’émotion de ce dont le cinéma pornographique des années soixante-dix fut la bande annonce un peu vide. D’un côté, en effet, les films X butaient presque toujours sur le « rendu » de l’expérience sexuelle (croyant, les stupides, qu’il suffisait de surveiller les organes en direct et de guetter le petit oiseau). Mais de l’autre, il est vrai que ces films reconstituaient pour leur public le spectacle idéalisé et rassurant d’une baise continue qui avait la netteté du fantasme et l’inaltérable et mâle monotonie du mythe.
De même, les « reality shows » de la télévision américaine (car n’oublions jamais qu’il n’existe de télévision qu’américaine) remplacent l’expérience lacunaire et l’indicible de ce qui fut par le show lisse et continu de ce qui aura été. « Ce qui aura été » est le résumé esthétique et le catéchisme humanitaire dont aura besoin tout « marché de l’individu ». Ce futur antérieur (qui est, je crois, le temps propre à l’audiovisuel) est à la fois rectification du réel et visualisation du réel rectifié.
C’est ainsi que nos héros vont enfin voir et savoir à quoi il faudrait qu’ils aient ressemblé quand ils viennent évoquer à la télé des bouts de leur biographie. Et nous aussi, hélas ! nous avons vu : il faut qu’ils ressemblent à de la mauvaise télé, à du mauvais cinéma, à du mauvais théâtre. Le prix, semble-t-il, est lourd : pour être du côté du Bien collectif (car le groupe veut communier chez lui, à domicile, avec sa télé), il faut qu’ils soient très mauvais (mais terriblement humbles).
On dira que le catéchisme n’est pas la grand-messe et qu’il n’exige ni crainte, ni tremblement, ni même « retour du religieux ». Il veut seulement que, clones prévendus déguisés en individus uniques, nous renoncions à jamais au souvenir d’avoir vécu quoi que ce soit que Pascale Breugnot ne pourrait pas nous faire revivre, en nous tenant un peu la main. C’est-à-dire très mal, quoique sous nos yeux embués de gratitude (qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour être aimés !).
Finalement, derrière la poudre aux yeux de la télé rendue au peuple et de l’individu tiré de sa nuit, il s’agit quand même de la façon dont, en France aussi, le village exige son dû.
Texte initialement paru dans le journal Libération du lundi 20 janvier 1992