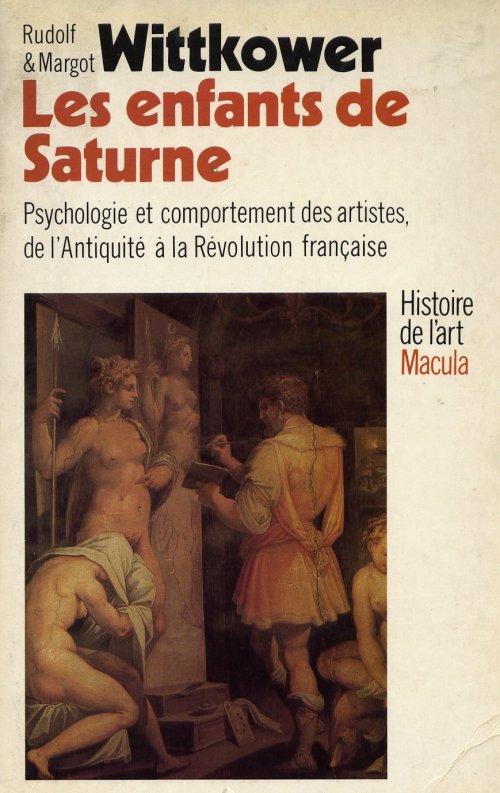
DE L’ART
Psychologie et comportement des artistes.
LES EDITIONS MACULA ONT PUBLIÉ EN TRADUCTION FRANÇAISE LE CÉLÈBRE LIVRE DE MARGOT ET RUDOLF WITTKOWER. LES ENFANTS DE SATURNE. CE LIVRE A ÉTÉ ÉCRIT AU DÉBUT DES ANNÉES 50. RUDOLF WITTKOWER (BERLIN 1901/USA 1971) FUT L’UN DES MEMBRES DU WARBURG INSTITUTE.
L’histoire de l’art existe-t-elle ?
C’est la question que l’on se pose en refermant ce livre passionnant. Et la réponse est «non»! Car ce livre écrit contre les universaux psychanalytiques n’a rien de même calibre à leur opposer. La sociologie, la linguistique, l’ethnologie, la psychologie se sont forgés divers outils d’enquête et de traitement des données. L’histoire de l’art n’a jamais su trouver son style. L’histoire de l’art reste à inventer. Se dire historien d’art équivaut à affirmer que l’on sait qu’il y a des sources et que sur une image quelconque, on peut réunir un certain nombre d’informations. Partant de là, les Wittkower appliquent ce qu’ils appellent la psychologie aux artistes du XVIe et XVIIe siècles. Cette psychologie est l’ensemble des lieux communs normatifs de leur époque sur les mœurs. Ce qui les différencie donc du grand public, c’est leur connaissance historique du sujet. Tout le monde croit que les artistes sont, et ont toujours été, égocentriques, caractériels, névrosés, indisciplinés, instables, débauchés, extravagants, qu’ils sont obsédés par leur œuvre et extrêmement difficiles à vivre. Les Wittkower vont répondre en trois cent cinquante pages que les artistes, ça n’existe pas. Que si un tel était névrosé, tel autre était un excellent homme d’affaires. Bref, si les artistes n’existent pas, je ne vois pas pourquoi l’histoire de l’art existerait !
La théorie existe-t-elle ?
Non répondent les Wittkower puisqu’un déséquilibré peut créer de l’équilibré et vice-versa. La psychanalyse ne nous apprend rien car lorsqu’on vérifie… Leur seule allusion au marxisme, à travers une critique de F. Antal, est de la même eau. Il s’est trompé. Leur statisme descriptif les surprend eux-mêmes : Au fur et à mesure que s’accumulaient nos documents, nous avons constaté, non sans surprise, qu’ils commençaient, d’eux-mêmes, à s’organiser en catégories nettement distinctes… Le combat, lieux communs anhistoriques contre lieux communs cultivés, peut commencer ! Rapide survol du monde antique, négation banale du Moyen-Age et, cette régression médiévale faite, on arrive à l’Age d’Or. C’est la Renaissance et la lutte pour l’émancipation de l’homme. Brunelleschi refuse de payer sa cotisation à la guilde. Et apparait cet humanisme qui guide encore nos professeurs en cette fin du XXe siècle. Le défi lancé par Brunelleschi aux lois corporatives a une importance gui dépasse son cas personnel : il en sortit vainqueur et il établit le droit qu’avait un homme libre de veiller à ses propres intérêts et d’agir selon sa propre conscience. Plus c’est creux, plus c’est beau… Est-ce un rêve ? C’est ce qui explique leur contre-sens (p. 28) sur une phrase de Diderot. Pour eux, Diderot affirmait encore que seuls les enfants de familles pauvres avaient le droit de devenir artistes alors que Diderot ne fait que constater: …nos plus grands artistes sont sortis des plus basses conditions. Si on pense à Chardin, son père fabriquait des billards pour le roi, était artisan, n’était pas pauvre au sens où l’entendent les Wittkower. Ce ménage collectionne des anecdotes. L’exceptionnel tombe facilement dans le plat et le répétitif, c’est-à-dire dans le journalistique.
La vie existe-t-elle ?
Non. Il existe des peintres, des sculpteurs, des architectes, des historiens d’art mais pas de vie. Adopter le temps de travail comme étalon de richesse, c’est fonder celle-ci sur la pauvreté; c’est vouloir que le loisir n’existe que dans et par l’opposition au temps de surtravail; c’est réduire le temps tout entier au temps de travail et dégrader l’individu au rôle exclusif d’ouvrier, d’instrument de travail (Karl Marx). Et qu’est d’autre un peintre qu’un ouvrier plus ou moins à son compte ? Pourquoi est-ce au XVe et au XVIe siècles que l’image de l’artiste perd ses connotations joyeuses et légères ? A Florence et à Gand, les classes moyennes apparaissent au XIVe. L’art devient une marchandise. Quand ça colle, ça colle et quand ça ne colle pas, ça ne colle pas. On retrouve Pontormo ou Vinci dans leurs œuvres. On ne retrouve pas Giovan Andréa Donducci, le Carrache ou le Dominiquin dans les leurs. Comme c’est étrange! Marcel Marnât, dans son Michel-Ange (1974), fait encore plus fort. Non seulement il parle de l’intérieur de la tête du Florentin mais en plus il le schize avec grossièreté: … le vrai Michel-Ange réapparaît donc entre 1530 et 1532… Incroyable ! Nous œuvrons pour être ensuite jugés par des jean-foutres qui eux savent quand nous fûmes vrais et quand nous fûmes faux. Bon, il est clair que les Wittkower s’élèvent bien au-dessus de cette littérature de concierges. Ils ont une vision pénétrante du spiritualisme des artistes, de l’aspect antiéconomique de leurs activités, du ludisme et de l’anti-utilitarisme de leurs aspirations à la connaissance et à la liberté. Tout artiste digne de ce nom incarne la dépense !
Les artistes existent-ils ?
Non ! Car ce pluriel n’est que le masque d’une insuffisance de vie à l’intérieur de l’histoire de l’art. Il existe des guerres entre artistes. Il n’existe pas d’artiste. L’obsession artistique suscite une indifférence à tout ce qui ne la concerne pas directement. Un député au parlement bernois ne saurait en aucun cas être un artiste. Etre un artiste demande depuis cinq siècles un courage et une abnégation invraisemblables. Un artiste travaille avec son esprit, donc, par définition il doit en avoir un. Il a besoin de temps, de paresse et d’hyperactivité. Cela le rend automatiquement, face au gaspillage capitaliste, marginal, hautain et solitaire. Il est toujours en examen et dans une tension inouïe, juge et jugé. Toute vie autre que la sienne lui paraît esclavage car il est le seul à savoir négativiser sa souffrance. Il est lui, je, moi je, wam, celui qui défie les dieux. Il est le seul à être chaud et froid. Restons calme !
Le Wittkower est un puissant stimulant à la pensée. Ils perdent leur combat contre la théorie, pour eux, réification, parce qu’eux ne sont pas porteurs d’espoir. Ils le perdent aussi parce qu’à les lire on est pris d’une frénésie théorisante. Ils nous apprennent qu ‘on peut être autre chose que ce que l’on fait, que l’on peut faire autre chose que ce que l’on est et idem à l’envers. Ils ne nous apprennent rien mais nous donnent énormément à penser. Leur théorie creuse — Tout ce que nous pouvons constater, c’est qu ‘au long des siècles, les habitudes sexuelles des artistes ont eu tendance à changer au même rythme que le climat moral de leur société leur permet de garnir leurs galeries d’une multitude de merveilleuses historiettes.
Chattes de bonne race.
Il va de soi que cet article feu follet ne s’adresse pas aux loosers qui peignent encore aujourd’hui. A chacun son blues. Qu’ils se gardent le leur ! A la fin du XVIe et tout au long du XVIIe siècle, il existait à Rome un nombre considérable d’artistes sans emploi ou, à tout le moins, sous-employés. Ils menaient une vie difficile et les tentations étaient nombreuses. On voit, en conséquence, se développer un réseau souterrain de voleurs et de receleurs qui fournissent le marché de l’art avec des produits dérobés. Ceci ne s’adresse pas non plus aux petites-bourgeoises dont les yeux verts s’amertument. L’insouciance est la marque de l’artiste. Il est un roi banni qui n’est jaloux que des artistes plus riches, plus doués, sensibles, intelligents, etc. …les chattes de bonne race chassent mieux lorsqu’elles sont grasses que lorsqu’elles crèvent la faim…, remarque avec pertinence Benvenuto Cellini. Giotto était usurier et beaucoup plus riche que la plupart de ses contemporains. Le Titien ne travaillait que sur commande. Michel-Ange aussi. Quelle joie par rapport à la bassesse de nos artistes actuels qui, avec leurs œuvres, ne font que s’encombrer eux-mêmes. Le Pérugin avait toujours à l’esprit la terreur de la pauvreté. Les Wittkower ont peut-être raison lorsqu’ils relativisent le statut des bâtards dans l’Histoire. Freud est au tapis. Mais leur cécité à l’œuvre, leur incapacité à recréer en partant du créé ne font jamais d’eux que des philatélistes et des adeptes de la vie contemplative.
Les enfants de Saturne de Margot et Rudolf Wittkower, Editions Macula, Paris, 1985.

Jean-Jacques Langendorf : « La guerre est un art ».
J.-J. LANGENDORF (1938) HISTORIEN MILITAIRE SUISSE., AUTEUR DU GENIAL L’ELOGE FUNÈBRE DU GÉNÉRAL A.-W. VON LIGNITZ ET FONDATEUR, EN 1979, DE LA MAISON D’ÉDITION KAROLINGER VERLAG, VIENT DE PUBLIER DEUX OUVRAGES. LE PREMIER, AUX EDITIONS RENÉ COECKELBERGHS, RETRACE AVEC LIMPIDITÉ. LA VIE DE GUILLAUME HENRI DUFOUR (OU LA PASSION DU JUSTE MILIEU). LE SECOND, «AIMEZ-MOI COMME JE VOUS AIME», ED. KAROLINGER, COMPLÉMENTAIRE DU PREMIER, DONNE CENT NONANTE LETTRES DE G.H. DUFOUR À ADOLPHE PICTET. NOTRE ENTRETIEN PORTE SUR LA MONOGRAPHIE DUFOUR ET SUR LA CORRESPONDANCE ET SES CENT QUINZE PAGES DE PRÉFACE, CES FUSÉES DANS LE CIEL DE L’AMITIÉ, DUES À LA PLUME SI PRÉCISE DE J.-J, LANGENDORF.
• Peut-on dater de 1818, année de l’introduction du Règlement militaire général pour la Confédération suisse, l’unification de l’armée suisse ?
C’est un beau règlement, un règlement remarquable. Il a d’ailleurs en partie été dicté par l’étranger. Les Prussiens s’étaient beaucoup occupés de la rédaction de ce règlement puisqu’ils avaient le même type d’armée. C’était les deux seules armées de conscription en Europe, à l’époque. Mais un règlement, c’est du papier. La réalité de l’armée fédérale, depuis 1818 jusque bien après le Sonderbund (1847), est une triste réalité. C’est le cantonalisme, l’amateurisme. Il y a des histoires incroyables. Des types qui perdent leur drapeau en manœuvre, des officiers qui refusent de sortir des tentes parce qu’il pleut… Enfin, c’est vingt-deux armées différentes, pas coordonnées, locales, etc..
• Pourriez- vous nous décrire le rapport entre la pratique et la théorie chez Dufour ?
Ça, c’est une bonne question et une question compliquée en plus. Le problème, chez Dufour, et il faut le souligner, je l’ai un peu fait dans un article du Journal de Genève (4.9.87), c’est qu’il a quand même eu une vie bourrée d’anomalies. Ce Genevois naît sur les terres du Saint Empire romain germani¬que dont il ne parlera jamais la langue, l’allemand. Il devient français sans le vouloir par l’annexion de Genève à la France. Il se retrouve sans trop savoir ce qu’il veut faire à l’Ecole polytechnique de Paris qui, contrairement à ce que disent souvent les hagiographies, était devenue une institution de quatrième rang. Napoléon l’avait militarisée. Les professeurs, à part une ou deux exceptions, étaient mauvais. C’était le niveau le plus bas de l’époque. Dufour est un pragmatique. Il lit et se débrouille très bien tout seul. Ensuite, il est envoyé sur un front complètement excentrique, Corfou, les îles ioniennes. De l’autre côté, c’est l’islam. Tous ses camarades genevois, Rilliet qui sera son divisionnaire pendant le Sonderbund, Rieu Sabon, eux, ont fait la grande guerre, les campagnes napoléo-niennes en Russie, en Allemagne : ils ont vu de très grands combats. Certains ont été à Waterloo. Tandis que Dufour est vraiment sur une voie de garage dans cette île de Corfou qui est complètement assiégée par la croisière anglaise. Autre anomalie : le général de l’armée la plus terrestre, l’armée suisse, sa seule blessure, son seul combat sera naval. Il se fait bombarder par des chaloupes anglaises alors qu’il est sur une chaloupe française. Il sera grièvement blessé. Il se jettera à l’eau parce que son uniforme a pris feu. Donc, il y a toutes sortes d’anomalies comme ça. Comme ingénieur, Dufour est un homme de génie, constructions, fortifications, etc. Là, il aura une très bonne pratique. A Corfou, il sera constructeur et topographe. Il fera le plan de la citadelle. II travaillera sous Marie-Etienne Baudran. Il sera initié un peu au commandement. Mais enfin, ça s’arrête là. En 1815, il construit les fortifications de Lyon et c’est fini. Ensuite, il rentre en Suisse et alors, la pratique guerrière, l’expérience du feu, les combats, ça s’arrête là. Il n’y en aura pas d’autres. Le Sonderbund, c’est le haut état-major qui est relativement loin, comme il se doit d’ailleurs, des combats. Au fond, ce qui va lui servir de pratique, c’est cette espèce de déses¬poir devant l’armée fédérale, son triste état. II arrive là, venant de l’armée napoléonienne, une grande tradition, et il va être consterné par ce qu’il va trouver. Il va commencer petitement par essayer d’organiser un corps de génie à Genève. Ensuite, il va prendre du grade dans les instances fédérales. Et il va très vite devenir l’homme-orchestre de cette école de Thoune, fondée en 1819 par une décision de la Dicte.
Il a des fois des phrases qui sont inexactes. Il a toujours dit, dans ses autobiographies: «C’est moi qui ai fondé l’école de Thoune». Ce n’est pas lui. Il a plaidé pour ça avec beaucoup d’autres officiers. Il y avait un courant à la Diète qui était absolument d’accord de fonder l’école de Thoune, à condition que ça ne coûte pas trop cher. Il n’en est pas le fondateur. Là, sa pratique va être double. Il va tout enseigner, la fortification, la tactique, la stratégie, l’histoire militaire. Il est l’homme à tout faire. Et, en même temps, il y a un aspect moral. Il va essayer de donner un peu de conscience suisse à ses officiers, de leur dire: «Vous n’êtes pas bernois, vaudoise, genevois. Vous êtes avant tout des Suisses». Il va essayer de surmonter les différences sociales. Il dit: «Il y a beaucoup d’aristocrates mais aussi beaucoup de roturiers. Vous appartenez tous à la même armée et c’est une armée démocratique». Ça, c’est la pratique de Dufour, mais quand on passe à l’un de ses écrits, le Cours de Tactique, il puise dans les grands exemples français. Il est resté imprégné par l’école française. Le fait qu’il ne lise pas l’allemand l’a peut-être handicapé.
• Il lit Clausewitz en traduction ?
Oui. Probablement. Il y a de fortes chances parce qu’il était abonné au Spectateur militaire. C’était son ami Pelet qui dirigeait cette revue dont deux numéros ont été consacrés à Clausewitz. Il y a même eu un tiré à part de ces numéros. Et puis, il ne faut pas oublier qu’à Genève, il y avait des tas de gens qui avaient des contacts très étroits avec l’Allemagne, qui étaient des amis de Dufour, qui lui racontaient ce qu’ils y avaient vu.
• Et Jomini ?
C’est intéressant : il le lit et il le déteste.
• Parce que Jomini est anti-napoléonien ?
Oui. Pour Dufour, il reste le déserteur. C’est le type qui, au milieu du champ de bataille, passe chez les Russes. Napoléon a absous Jomini en disant : «Il est suisse. Il ne m’a pas trahi». Mais ça, Dufour n’a jamais pu l’encaisser. J’ai demandé à Olivier Reverdin, son arrière-petit-fils, et il a confirmé ma théorie. J’ai retrouvé, aux archives de Lausanne, des lettres adressées au colonel Lecomte, chancelier de l’Etat de Vaud vers 1860. Ce colonel avait fait, comme observateur, toute la guerre de Sécession avec les Nordistes. Il est le premier biographe de Jomini. C’est un hagiographe : tout ce que fait Jomini est parfait. Il y a une correspondance entre lui et Dufour qui est extrêmement intéressante. Il y a une lettre de Jomini à Lecomte, autour d’un truc très drôle. Vers 1860, un général Dufour meurt. C’est un Valaisan qui était général au service du Pape. Tout le monde croit que c’est Dufour. Il y a des articles dans les journaux et les lettres de condoléances affluent. Et là, il y a une lettre de Jomini qui dit : «Ah, il est mort. Ce n’est pas moi qui vais verser des larmes après tout le mal qu’il m’a fait. Mais enfin, je vais bientôt le suivre et maintenant, je lui pardonne». Il y avait une animosité ! Il y a une autre lettre où il dit qu’il se rend à Genève et qu’en fait, il veut aller voir Dufour. Quand il arrive du côté des Tranchées, de la villa à Contamines, il dit : «Je n’ai pas le courage». Il ordonne à son cocher de repartir sur Lausanne. Bon ! Jomini est un… il faut nuancer le mot… est un dingue. Il y a des centaines de lettres à Lecomte où on a à faire à un cas de paranoïa développée. Si une lettre arrive avec un jour de retard, il dit : «C’est la censure qui l’a ouverte. Ma bonne m’espionne, mon facteur m’espionne, mon chien m’espionne… » C’est terrifiant. Il est d’une incroyable méchanceté. Et il a été ce que Dufour n’a jamais été : un grand menteur. Tous les épisodes pas très glorieux de sa carrière… Il s’est fait refaire sa biographie à la fin de sa vie.
• Il était créatif.
Oui ! C’est une œuvre monstrueuse. L’œuvre militaire de Dufour est restreinte. Jomini, c’est le grand systématicien. Toujours cette prétention, n’est-ce pas, de réduire la guerre à des formulations mathématiques. La guerre est un art, on ne peut pas…
• Dufour, en général, prend les choses qui lui préexistent et les simplifie. C’est un rationaliste.
Exactement.
• L’ingénieur type du XIXe siècle.
C’est un pédagogue. Un ingénieur et un pédagogue. Pour son cours de tactique, il butine dans tous les coins. Il laisse tomber Jomini parce qu’il dit: «C’est trop compliqué. Il faut être savant, mathématicien. Ce n’est pas nos officiers de milice qui vont commencer à lire du Jomini. C’est un casse-tête chinois». Il laisse aussi tomber Clausewitz parce que c’est la philosophie de la guerre. Il prend vraiment ce qui est utile. C’est très curieux. Son cours de tactique est excellent par sa clarté, sa simplicité: faire toujours ce qui est possible, l’art du possible, ne pas aller trop loin, etc. En tout, il joue pianissimo. On a une petite armée, un petit pays, peu d’argent, donc, il faut faire tout ce qui est possible avec de très petits moyens. Au fond, ce n’est pas dicté par une prati¬que parce qu’il n’a pas eu la pratique de la guerre. C’est dicté par un énorme bon sens et c’est plein de bon sens.
• Typiquement suisse.
Ah oui ! Absolument…
• Comment s’articulent la francophilie de Dufour et son nationalisme ?
A l’époque, c’était moins divisé que maintenant. Il y a cette francophilie totale, cette admiration pour Napoléon, puis pour Napoléon III. Il va être complètement aveugle. Il va être littéralement amoureux de Napoléon III. Et de tout ce qu’il fera, le coup d’état, n’importe quoi.
• Il pleure après Sedan.
Oui, il pleure, il fait une dépression. Il ne comprend pas. Il dit : «C’est horrible». Il est complètement acquis à la maison Napoléon. Il est invité d’honneur à Paris. Il a ses appartements à Saint-Cloud. Il a le Grand Cordon de la Légion d’honneur. En même temps, il conserve des amis dans l’armée française. Il fait des choses…, sa correspondance avec des généraux français, actuellement, le rendrait redevable du conseil de guerre, de la cour martiale. A l’époque, les choses n’étaient pas du tout comme ça.
• Mais la genèse de son nationalisme ?
Ça vient peut-être d’une autre chose. Là, il y a aussi une contradiction. Il est républicain, d’un milieu de vieux républicains. Son père était révolutionnaire. Il a été chassé de Genève au moment de la contre-révolution de 1782. Il se réfugie en Allemagne. Dans ce milieu, on adore Rousseau, Voltaire, les Encyclopédistes. Dufour y est né. Puis, il devient bonapartiste. Il voit Bonaparte en la continuation de la république. C’est une première contradiction. Ensuite, il devient un admirateur passionné de l’empereur. Et puis, il revient quand même dans une République de Genève restaurée, dans un pays qui se dit – à tort ou à raison, mais ça, c’est un autre problème – républicain. Il a donc le sentiment d’être dans une république. Genève est devenue suisse donc, par rapport à Genève, il s’intègre à la Suisse. Mais il reste très attaché à la France. Il a toujours mal au cœur quand il doit mobiliser contre elle, en 1831, en 1838. Il n’est pas chef d’armée mais chef d’état-major. Il est consterné. C’est ses amis français. D’ailleurs, il leur écrit pour leur dire : «Attention». Il a une haine totale, durable, des Autrichiens. C’est une contradiction pour nous mais ce n’est pas une contradiction pour lui. Le sentiment national n’était pas aussi développé que maintenant. Il y a peut-être aussi une autre motivation plus profonde. Il y a quand même une Suisse qui existe, qui se forme organiquement à partir du XIVe siècle, ou même du XIIIe siècle. Genève est alliée, dès le XVIe siècle, à cet ensemble. Tous les cantons sont des républiques, ça les lie et c’est important. Tous ont un statut démocratique qui peut être oligarchique, etc, mais républicain. Ce sont les seules républiques du centre de l’Europe. Venise a disparu…
• Dufour admire la noblesse.
Oui, en vieillissant. Effectivement, il fait un peu des ronds de jambe. Il est impressionné par l’aristocratie genevoise qui n’est d’ailleurs pas une vraie aristocratie. Pictet, il l’adore parce que c’est le fils de Charles Pictet de Rochemont. Il est invité au château de Laney… Il a un côté comme ça. Dufour est sorti de rien. Mère brodeuse, père horloger, guillocheur, plus ou moins chômeur, d’où cette fascination.
• Dufour est uniquement nationaliste.
Oui. Tout le problème social lui passe complètement par-dessus la tête. Napoléon III, contrairement à lui, s’est énormément intéressé au problème, à l’extinction du paupérisme. Dufour a une vision d’ingénieur. C’est unifier la Suisse par la carte, les routes, les chemins de fer, les tunnels. Il y a des gens qui travaillent : ils sont l’instrument de ce plan.
• Dufour incarne l’ingénieur type du XIXe siècle.
Oui ! Moi, il me fait de plus en plus penser à un personnage de Jules Verne. La technique dominera tous les problèmes !
• Dufour est-il un personnage d’envergure ou une anecdote nationale II y a eu des ingénieurs beaucoup plus performants et beaucoup plus inventifs.
Oui, bien sûr. C’est un homme de terrain, un grand vulgarisateur. Enfin, je le dis à un moment donné : il n’est pas Gauss ou Lobatchevski. Il n’est pas Navier. Il n’y a pas de recherche fondamentale chez lui. Mais il est pratique. Pour lui, la Suisse ne peut pas se permettre des recherches théoriques. Il faut faire vite, construire des ponts, improviser. Il ne faut pas pousser quand même trop loin le Dufour dans les orties. Où il est créateur, c’est la carte de la Suisse. Il devient Dufour par un hasard de circonstances mais il a le génie de la situation. Au Sonderbund, il a fait ce qu’il fallait faire.
• S’il n’était pas dans l’histoire suisse, ce personnage vous aurait-il intéressé ?
Très bonne question que je ne me suis jamais posée. Il m’intéressait déjà gamin pour une autre raison. J’habitais au Bourg-de-Four, donc à deux mètres de sa statue, et je me suis toujours intéressé à l’armée, à la guerre, etc. Donc, déjà gosse, il était dans mon univers, si bien que je ne peux pas répondre à la question. Je suis trop imprégné.
• Ce n’est pas un ouvrage de commande ?
Absolument pas. Le livre est fait depuis quatre ans déjà. Je ne l’ai pas du tout fait pour la circonstance. René Cockelberghs voulait lancer cette collection Grands Suisses, il y a quatre ans. Il m’a demandé si je voulais faire un Dufour. A l’époque, il avait des difficultés financières. A présent, à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Dufour, il a relancé la chose. Vite. Si bien que je n’ai pas pu écrire les légendes qui contiennent des erreurs. Dans la bibliographie, ils ont mélangé des titres. Je ne suis responsable que du texte, c’est tout.
• Votre éditeur vous avait-il donné des critères ?
Un critère qu’il m’a donné et qui est embêtant : pas de notes. Ça me gêne. J’ai l’habitude des notes. Dans la correspondance, il y en a mille. J’ai pu me défouler. Mille notes, l’orgasme ! Bibliographie, ce que je voulais, les trucs importants y sont. Et ne pas dépasser les cent quarante pages de ce type d’impression. Et puis, en plus, faire ça vite et être pédagogique.
• On vous a demandé d’être simple ?
Ah oui, absolument.
• De ce point de vue, c’est une réussite.
Et que cela se lise bien. J’ai dû éliminer des tas de trucs. Moi, j’aurais fait trois cents pages et j’aurais tout mis. Surtout ses relations avec la politique fédérale. Bon… La Suisse a fait une enquête. Devant le monument de Dufour, ils ont interrogé une cinquantaine de personnes. Le résultat était plus que drôle. Certaines ont dit que c’était Napoléon… En plus, j’avais un autre impératif : il a dû être fait en deux mois. A l’époque, il voulait le sortir immédiatement. Je connaissais bien Dufour parce que je m’étais occupé de lui sur l’affaire de Neuchâtel avec la Prusse.
• Pour vous, Dufour était militaire dans l’âme et non pas «une sorte de Civil en uniforme, fleurant le patchouli pacifiste, et résigné à
n’exercer qu’un bien vilain métier»?
Il y a maintenant une tendance depuis quelques années quand on parle de Dufour, chez des gens dont je ne donnerais pas les noms, à dire : «Nous, ce qu’on aime chez Dufour, c’est qu’il détestait la guerre». Alors, c’est plus que Dufour-la-Croix-Rouge, Dufour-la-philanthropie, Dufour faisant, à la fin de sa vie, des quêtes pour les inondations dans le Valais. Non ! Il est militaire, de formation militaire et il aime son métier. S’il y a une guerre à faire, il la fait. Le tragique, c’est que la seule qu’il a dû faire, c’est celle contre ses compatriotes. Ça a été évidemment son problème. Avec ce courant pacifiste, maintenant, tout le monde marche à côté de ses pompes. Ils font une exposition : Dufour, homme de paix. Je leur ai dit : «Vous ne pouvez pas ! Il n’a pas été un homme de paix». Je ne sais pas si vous connaissez les thèses de Baudrillard sur les simulacres. C’est parfaitement ça. D’un général, on fait un homme de paix. Il n’y a plus de putain, maintenant. Il n’y a plus que des conseillères érotiques. Un colonel français, au Tchad, à qui on demandait: «Quel est votre métier ?», répond : «Moi, je vends de la sécurité».
• Capilliculteur pour coiffeur.
Oui, c’est exactement ça! Il n’y a plus de concierge, ce sont des gardiens d’immeubles. Plus d’instituteurs ; tout le monde est professeur, maintenant. Et ainsi de suite. Il n’y a plus de combats, de guerre du Golfe. Il n’y a plus que des affronte¬ments. C’est contre cela que je réagis.
• Dufour est un professionnel efficace et moderne, répugnant à guerroyer co-tre les civils ?
Oui. Il n’a pas la conception de la guerre qui va devenir fatalement totale. Il est encore un homme du XVIIIe siècle.
• Cela explique sa participation à la fondation de la Croix-Rouge ?
Attention ! Il y a deux choses. Il y avait un cinglé qui s’appelait de Sellon et qui était l’oncle de Cavour. Il avait créé une Société de la Paix dans les années 1828-29 et Dufour avait refusé d’y adhérer dans une lettre extrêmement sèche. Pour la Croix-Rouge, il dit bien qu’elle ne supprimera pas la guerre. Il faut simplement que le statut des prisonniers soit mieux garanti.
• Il trouve Dunant hystérique ?
C’est un cinglé : en plein Bourg-de-Four, il s’agenouille devant Dieu. Mais il le soutient parce qu’à Genève, tout le monde se connaît, s’entraide, etc. En même temps, il y a la relation Pictet-Dufour, l’affaire des fusées, que je soulève le premier. Pictet vend à l’Autriche ses fusées et est soutenu par Dufour. Là aussi, il ne ressent pas de contradiction.
• C’est un ingénieur.
Oui et très compartimenté.
• Le pont de la rivière Kwaï !
C’est ça ! Très juste ! Je n’avais pas pensé à ça. C’est une excellente comparaison. C’est le type qui construit un pont même pour les Japonais.
• Pourquoi votre admiration pour le Dufour topographe ?
C’est difficile. C’est très technique comme question. En deux mots… La Suisse arrive tard dans les grands travaux topographiques. La plupart, en Europe, sont déjà faits ou presque terminés. En Prusse, en France où il y a une remarquable école de topographie. La Suisse est en retard parce qu’il n’y a pas d’argent…
• Et les Alpes…
Exactement. Les Alpes terrorisent encore au XIXe siècle. C’est effrayant. On n’y va pas. C’est presque inextricable. Il a fait une œuvre mathématique de base. Si vous regardez ses œuvres mathématiques, c’est souvent un peu cul-cul. Maintenant, avant le bac, un type résoud des problèmes qui paraissaient relativement compliqués à Dufour. Mais, dans les calculs des bases, la base d’Alberg, la vérification de la hauteur du Chasserai, du méridien de Berne, enfin les points fixes qu’il a dû prendre… Il ne faut pas du tout le voir sur le terrain. Il a été l’administrateur de la chose. C’est lui l’ingénieur : il commande et envoie des hommes. Ils sont mal payés et l’un d’eux a été frappé par la foudre.
• Il a une conception d’ensemble.
Oui et il sait tout à fait ce qu’il veut faire. Son chef-d’œuvre, c’est d’être arrivé à rendre la plasticité des Alpes. Il choisit un éclairage rasant qui vient du nord-ouest, donc mythique. A l’époque, il sera d’ailleurs très critiqué pour ça mais finalement, cela donne une carte incroyablement plastique. Il la voyait comme un tableau et disait : «Ne faites pas du cadastre mais du relief».
• D’autres exécutent ses solutions plastiques ?
Il avait des dessinateurs et avait fait venir d’Italie un graveur florentin.
• Il a choisi un certain type de hachures ?
Pour l’éclairage, un versant de montagne est hachuré et l’autre pas, ce qui donne une impres¬sion de relief, ce qui est très précis.
• Est-ce que vos travaux sur la pensée militaire allemande vont bientôt paraître ?
J’en suis à la deux millième page du deuxième volume. Ça continue joyeusement. Je pense que ça va paraître dans deux-trois ans.
• Vous écrivez que dans les guerres «… seule une conduite des opérations aussi brutale que possible, requerrant pour une longue période toutes les énergies nationales et exigeant des sacrifices incommensura¬bles, permet d’arracher la victoire».
Oui, c’est ça. Pensez à ce que vont devenir les guerres. C’est Clausewitz qui dit : «La guerre va toujours vers son paroxysme». Je suis convaincu que s’il y avait, comme disent les Américains, un first strike nucléaire avec une arme tactique, on irait très vite vers le point culminant. On irait jusqu’au bout. Au revoir, Messieurs-Dames. La représentation terrestre est terminée.
• N’esthétisez-vous pas la guerre ?
C’est une question qu’on m’a souvent posée. C’est bien possible, oui. La guerre n’est pas jolie ou belle, elle est un moment de l’histoire, de l’évolution de l’humanité, un langage, un moment de passage. Un homme qui a admirablement écrit sur la guerre, c’est quand même Marx, ainsi que son acolyte Engels. A propos d’Engels, un texte de lui sur Dufour a paru dans la Gazette rhénane où il dit que Dufour est le premier orateur de Suisse. Engels est à Berne en 1848 et il entend Dufour député. Des autres, il dit : «De Dieu! C’est pas possible. Ils ne savent pas causer. Arrive alors ce petit vieillard qui ressemble d’ailleurs à un ingénieur, pas à un militaire, et brusquement, c’est la langue française, la pureté française, la clarté française, etc». Dufour a des côtés comme ça. A Genève, une servante est condamnée à mort. Elle avait mis le feu à la maison de ses patrons. On requiert sa grâce devant le Grand Conseil qui la refuse. Dufour se lève, plaide pendant plus d’une heure et dit : «De toutes façons, cette femme est folle, elle n’est pas redevable de la justice. On devrait la mettre dans un hôpital». Une vision déjà très moderne. Il obtient sa grâce et la peine capitale est commuée en détention à vie.
• Avez-vous pratiqué le Journal d’Amiel ?
Oui.
• Pouvez-vous comparer le Journal de Dufour à celui d’Amiel ?
Oui, oui. A propos, un détail : Dufour a été le professeur de fortifications d’Amiel, lequel raconte qu’il suit le général avec un double-mètre et des chaînes pour prendre des mesures. Et, quand le Cours de tactique paraît, il le lit. Bon, il lisait tout, systématiquement. Amiel écrit aussi le plus beau texte qu’on ait écrit sur Pictet qui est un personnage extraordinaire. Le Genevois extraordinaire du XIXe siècle, à mes yeux, ce n’est pas Dufour, c’est Pictet. Dans le Journal de Dufour, il n’y a pas d’introspection. C’est plutôt un journal de bord, dans le sens de celui d’un navire : j’ai mis l’ancre là, j’ai fait ceci, j’ai fait cela, il fait froid, il fait chaud, j’ai mangé, je dois trente francs à un tel…
• Je ne pense pas qu’Amie! soit représentatif du Suisse romand. Et encore moins du littérateur romand. Dufour n’est-il pas plus représentatif ? C’est une hypothèse.
Ça me paraît hardi… Je ne sais pas. Je pense, comme vous, qu’Amiel est atypique. Il a, comme Pictet, cette culture germanique. Il vient d’un autre monde. Dufour, lui, est beaucoup plus typique.
Pouvez-vous nous parler de votre édition de la correspondance Dufour-Pictet ?
Un truc quand même original aussi chez Dufour, c’est cette idée de suspension des ponts par en dessous.
• Pour des raisons esthétiques !
C’est très curieux aussi cette idée d’esthétisme, de faire joli… Alors, la correspondance. Elle est inédite. Elle se trouvait au Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque publique universitaire. C’est cent nonante lettres, billets, diplômes que Dufour adresse à Pictet. Sans les réponses ! Elles ont disparu, à part quatre ou cinq. C’est comme les cahiers de correspondance de Beethoven : comme il est sourd, le type lui écrit mais on ne connaît pas les réponses. Pictet, c’est le dessus du panier genevois : il est le dernier fils de Pictet de Rochemont lequel est le grand homme de la Genève de l’époque. Il est mis dans un pensionnat de Suisse allemande où il apprend le grec, l’allemand, etc. Il dominera entre cent cinquante et deux cents langues à la fin de sa vie. C’est le grand linguiste de l’époque. Il va avoir une influence décisive, sur de Saussure dont il corrigera et lira les premiers essais. Il est le fondateur de la science celtique. Il part en Angleterre en 1820 et c’est le premier qui montre que les Celtes se rattachent au groupe indo-européen et qui montre que les Basques, par contre, n’en font pas partie. C’est le premier qui publie les grands textes bardiques, celtiques, bretons, etc. Il s’intéresse à la philosophie. Il est l’ami de Schelling, il va voir Goethe, Schleiermacher. Il fait ses études à Berlin.
• Il suit les cours d’Hegel.
Oui. Il y a dix-sept lettres sur Berlin qui relatent de grandes conversations avec Hegel. Il rencontre Schlegel qui lui dit : «Mais faites du sanscrit». Il va en faire et devenir l’un des deux ou trois premiers sanscritistes de son temps. Il est compositeur. On a un recueil de la philosophie de l’esthétique de lui. Et puis, il est officier fédéral d’artillerie et il met au point ses fameuses fusées. Elles apparaissent dans toute la correspondance.
• C’est la base de leur amitié ?
Ils s’adoraient. C’est une amitié incroyable. Au bout d’un moment, Pictet est complètement ruiné. Dufour le soutient financièrement, lui garde des actions, lui paie des voyages. C’est des fusées «à la Congrève». On mettait une fusée sur un chevalet et on mettait un boulet ou de la mitraille au bout. On avait quand même des tirs jusqu’à 6000 mètres. Après, il invente un autre type de fusées, des obus percutants. On visse un truc dans l’obus pour le faire détoner à un certain moment, quand on veut. Il se ruine dans ces histoires. C’est épouvantable. C’est intéressant parce que vous avez cinquante ans de correspondance. Ça commence en 1828 et ils meu¬rent tous les deux en 1875. Il y en a plusieurs de Dufour chaque année, certaines même très importantes. Il y en a une sur le Sonderbund, une sur l’occupa¬tion de Neuchâtel, sur toutes les visites à Napoléon III, etc. C’est vraiment Dufour en pantoufles, en robe de chambre, qui se déboutonne complètement. C’est le Dufour bon garçon. Pictet a été un grand ami de George Sand, Marie d’Agoult et de Franz Liszt. George Sand a fait une fameuse caricature de lui. Elle écrit un texte, Lettre d’un voyageur, en 1836, dans lequel elle se moque de lui, le traite de douanier en capote, de pédant et lui devient complètement tapé et répond par Une course à Chamonix. C’est un ouvrage qu’on pourrait rééditer. Il a conservé une alacrité, une fraîcheur, une virulence formidables.
• Avez-vous fait partie du Groupe d’Olten ?
Non, jamais. J’ai eu deux nouvelles dans leur recueil parce qu’ils me les avaient demandées. Je ne sais pas pourquoi.
• Quels rapports avez-vous avec la Suisse ?
Très peu, maintenant. Je viens une fois par année, aux mois d’août et septembre parce qu’il fait trop chaud à Chypre. Paradoxalement, je travaille beaucoup sur des choses suisses. Mon rapport, ce sont les études que je fais. Je prépare un livre sur les fusées en Suisse. C’est ma nouvelle marotte. Fusées de guerre uniquement ! Autrement, ici, j’ai encore de vieux amis. Curieusement, ce sont des amis du temps du collège ou de l’école.
• Après Un débat au Kurdistan, qu’avez-vous fait ?
J’ai écrit Eloge funèbre du général A. W. von Lignitz, des nouvelles, Neuschwanstein-sur-Mer et un grand roman érotique, La comtesse Graziani ou les triomphes du proxénétisme. C’est une pochade qui se passe au XIXe siècle en Italie, dans un monde complètement délirant. C’est un livre qui coûte la peau des fesses, extrêmement cher. Ça a été publié en Allemagne où je publie de plus en plus. L’histoire m’intéresse davantage de jour en jour. On ne peut pas faire trente-six mille choses à la fois.
• Aucun rapport avec le milieu littéraire local ?
Aucun. Aucun… Benozoglio est bien. Il vient d’un horizon complètement baroque, différent, tonitruant, tonique. Comme je pense le plus grand bien de Cendrars, si vous voulez. Je ne vous dirai pas le mal que je pense des autres parce qu’il faudrait citer des noms. Il faut toujours être gentil ! Une autre chose qui me relie à la Suisse, c’est que je fais pratiquement cinquante à soixante émissions à la radio chaque année, à Espace 2. Ce qui est formidable pour moi parce que je peux vraiment faire ce que je veux. C’est une demi-heure. J’ai fait tout ce qui m’est passé par la tête jusqu’à maintenant. Bon, toujours en relation avec la musique ou des sujets historiques.
• Pour Dufour, les Genevois sont des gens que seul l’argent intéresse.
Absolument.
Il se sent artiste par rapport à eux.
L’ingénieur-artiste. Ce qui ne l’a pas empêché de faire fructifier très bien le magot. Moi, chaque fois que j’arrive à Genève, surtout venant d’un pays ultra-pauvre, je débarque à Cointrin et j’ai l’impression de sentir l’odeur de l’argent qui me monte aux narines. Ça dégouline. Ça suinte. C’est à la limite du dégueulasse.
• Qu’y a-t-il dans votre ouvrage sur la stratégie prussienne ?
Là, c’est évidemment la chose qui me préoccupe le plus. C’est devenu une énorme étude. J’essaie de montrer comment toute la pensée militaire, prus-sienne essentiellement, parce que c’est elle qui soutient tout, évolue des théories éclairées, mécaniques, etc, du XVIIIe siècle jusqu’aux conceptions modernes de la guerre. Je m’arrête avant Clausewitz. On a toujours cette idée qu’il est le seul alors qu’il est préparé par tout un courant. Surtout par ce Rûhle von Lilienstern sur lequel j’ai déjà publié pas mal et qui est véritablement le préparateur de la chose, le type qui comprend ce que va être la guerre de l’avenir. Cela sera deux énormes volumes qui s’arrêteront en 1820. Et je suis en train de finir l’histoire d’Homère Lea qui est à la fois un écrivain américain, un général chinois et un prophète des guerres de l’avenir. Il est mort en 1912. C’était un nain bossu d’un mètre vingt. Il s’est improvisé général. C’est très, très rare. Il était plutôt homme de lettres. Il a laissé des bouquins tout à fait extraordinaires.
• Au départ, vous étiez historien ?
Non, j’ai fait de la philo. Après, j’ai passé à l’archéologie. J’ai été longtemps au Proche-Orient comme archéologue et comme c’était l’archéologie des châteaux-forts, des Croisades, je suis passé à la pensée militaire.
L’éloge funèbre…, c’est entre deux ?
C’est un faux, oui. Ça a été marrant. J’ai des types qui m’ont écrit pour me demander des conférences sur ce général von Lignitz. Jean-Edern Hallier est le fils d’un général, mort maintenant. J’ai eu une correspondance épique avec lui ! Au moins dix lettres pour lui faire comprendre que le type n’existait pas. Il ne comprenait pas, il disait : «Vous citez des noms, des trucs, des faits que je trouve pas dans le dictionnaire. J’ai regardé dans les dictionnaires militaires les plus gros, il n’est pas dedans. Comment ça se fait ? »
• Vous avez créé une maison d’édition ?
Il y a longtemps. Dix ans. J’habitais à Vienne et à Florence. Avec un associé, on avait envie de faire autre chose. On avait de l’argent. On a créé cette maison. O miracle, elle est florissante.
• Qu’y a-t-il dans votre catalogue ?
On a surtout des biographies ou des ouvrages de sciences politiques. Il n’y a pas de fiction, pas de roman. Nous avons même un ouvrage qui a fait notre fortune en tant qu’éditeurs. On en a vendu trente mille, plus les droits à droite et à gauche. C’est un sociologue viennois quia fait un énorme bouquin sur la prostitution à Vienne, actuelle, évidemment, le côté voyeur des gens… C’est parti comme des petits pains. Et ça nous permet de faire à peu près ce qu’on veut. On a une soixantaine de titres maintenant. On en fait sept ou huit par année. Moi, j’ai vraiment la bonne part. Mon associé, qui est juriste, adore tout ce qui me fait horreur, la correspondance, les contrats, le travail administratif. Il est à Vienne. Et moi, depuis Chypre, je lis, je fais du lectorat comme disent les Allemands, je lis les manuscrits, je les mets en forme. Je travaille avec ma femme. Ça, c’est la bonne part du boulot.
• Pourquoi habitez-vous à Chypre ?
Il y a plusieurs raisons. D’abord une raison liée à l’histoire militaire. Le gouvernement local m’a demandé de faire l’histoire de l’intervention turque en 1974. Ça a été la plus grande opération militaire de l’après-guerre, en Méditerranée. En plus, entre deux pays faisant partie de la même coalition, de l’OTAN. C’est très curieux. Sous les yeux d’un troisième, l’Angleterre, qui a des bases militaires là-bas. Rien n’avait été fait jusqu’à maintenant. J’ai donc été voir et le coin m’a tellement plu que j’ai dit «OK». J’ai toujours vécu à la campagne, sauf à Vienne. Je n’aime pas la ville. On s’est acheté une maison. Ça coûte un morceau de pain. Et on s’est installé là-bas.
• Vous lisez le turc ?
Oui, je lis le turc. J’en ai fait systématiquement. Je commence à le parler aussi. Presque toutes les archives sont en turc. J’ai bouclé la boucle parce que j’ai passé toute ma jeunesse dans le coin à étudier ces monuments croisés. Chypre, c’est le nid par excellence de l’architecture croisée. Les plus belles choses sont là-bas. Et, comme par hasard – ils ne l’ont pas fait exprès – tous les monuments croisés sont du côté turc. Côté grec, il n’y en a qu’un.
• Faites-vous des jeux stratégiques ?
Non, ça me casse les pieds. Ah si ! j’en ai fait un. Le vrai Kriegspiel qui se fait en temps réel, mis en place en une semaine, des formations, bataille en trois jours, avec le rideau, enfin tout. Ça demande un temps extraordinaire. Il faut vraiment être là, à disposition. A Vienne, on a eu une époque comme ça. Après, j’ai acheté un billard et alors, je n’ai plus fait que du billard. Cette passion m’est restée.
• Vous êtes un spécialiste des XVIIIe et XIXe siècles. Les batailles suisses…
…C’est avant ! Toutes les guerres de Bourgogne, les guerres autrichiennes, les guerres inter-suisses. L’utilisation de l’infanterie, l’invention de la hallebarde. Enfin, ça, c’est relativement bien étudié. Ce n’est pas du tout mon époque.
• Les Helvètes sont-ils de bons stratèges ?
Oui, il y a des choses intéressantes en Suisse. Très curieusement, ça s’arrête après 1870, complètement. Ça se tarit. Peut-être que c’est parce qu’on se tourne vers le vainqueur, l’exemple allemand. Ça, c’est clair. A l’époque de Dufour, vous avez des gens tout à fait intéressants. Johanes Vicland qui écrit un Traité de tactique à l’usage des milices et qui est beaucoup moins français que Dufour. Il fait la part de la guérilla, la levée du peuple en armes, etc. Et puis, il y a toute une école romantique en Suisse, von Tavel qui dit: «Plus d’armée mais le peuple en armes, qu’il se débrouille, se lève quand il faut, bouche les vallées, fasse péter les ponts, etc». Il y a Lecomte, biographe de Jomini. Il y a von Elgger, chef d’état-major du Sonderbund, bon, la référence n’est pas très brillante. C’est un peu comme ces généraux français qui nous écrivent des traités de tactique et de stratégie alors qu’en 1940, en Indochine ou en Algérie, on les a vus à l’œuvre. Il faut aussi se méfier. On ne devrait lire les traités de tactique que des vainqueurs. (Rires).
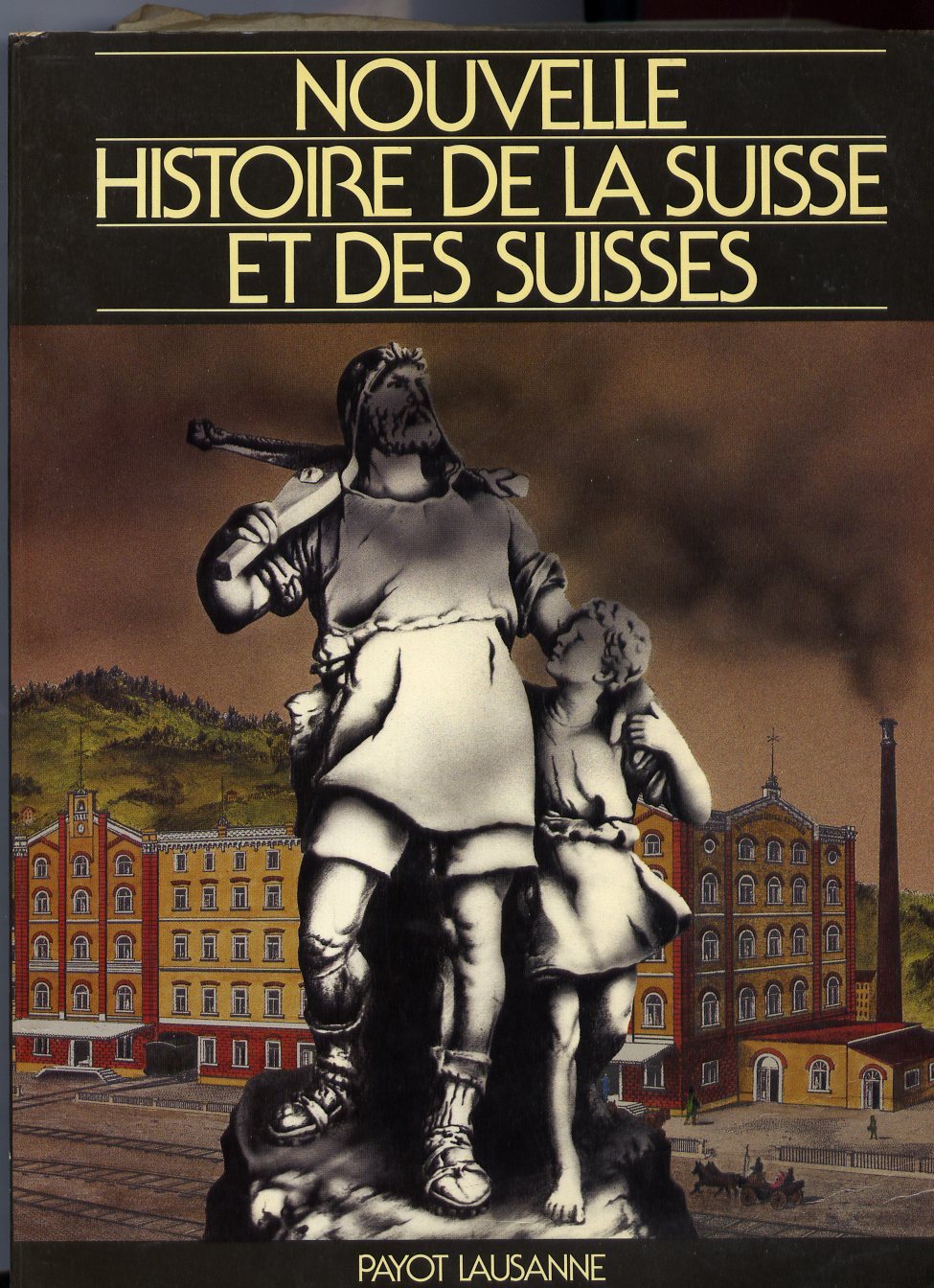
Guillaume Tell n’a pas existé : les statistiques le prouvent.
L’HISTOIRE DE CE PAYS EST PASSIONNANTE. LA SUISSE EST L’UNE DES PLUS VIEILLES DÉMOCRATIES DU MONDE. UN GROUPE D’HISTORIENS RENOUVELLE L’APPROCHE GLOBALE DE CE PASSÉ EN SE SERVANT DE L’ECONOMIE, DE LA SOCIOLOGIE, DE LA DÉMOGRAPHIE ET D’AUTRES APPROCHES CHIFFRÉES. APRÈS LE SUCCÈS DE CE LIVRE DANS SA VERSION EN TROIS VOLUMES, VOICI L’ÉDITION INTÉGRALE PARUE CHEZ PAYOT EN UN SEUL VOLUME, REVUE ET AUGMENTÉE, ENRICHIE DE J TROIS INDEX, EN 1008 PAGES.
La préhistoire et l’histoire (de l’an 0 à 1394)
Vers 1800 av. J-C, les longues rapières de bronze apportent la supériorité militaire à leurs possesseurs. A l’âge suivant, arrivent au nord des Alpes le tour de potier, la charrue au soc de fer, la monnaie et le cheval domestique. Au 1er siècle av. J-C, les Helvètes regorgent d’or qu’ils trouvent dans des cours d’eau. Ils l’échangent, ainsi que des armes, avec les étrangers contre de la nourriture et des objets d’art. En 22 av. J-C, la Suisse fait partie de la Belgique qui est une province romaine regroupant une quinzaine de peuples gaulois dont les Helvètes. De l’an 0 à 260, la Suisse, pendant la paix impériale, se développe économiquement et socialement pour la première fois. Les Romains la dotent de villes et d’installations thermales publi¬ques. Ils nomment des notables locaux. Hélas, dès la fin de l’Antiquité, les indigènes retournent à leur saleté usuelle. Les limites des petits Etats suisses, dépendants ou non, futurs cantons ou non, tracent des frontières qui ne sont jamais ethniques ou linguistiques. Ça brasse. Au début du moyen âge, les gens quittent les villes et retournent à la campagne. C’est l’époque de la villa. Seuls les propriétaires fonciers ont encore le droit de porter des armes. La masse est une masse de serfs. Au XIIIe siècle, le mou-vement s’inverse et 64 villes sont fondées. Les citadins sont des affranchis. La monnaie se remet à circuler. On sort de l’économie de subsistance. Les villes font du commerce et les commerçants font des pactes (le plus ancien conservé: 1243) de ville à ville: de ces pactes naîtra la Suisse. Le pacte de 1291 est un pacte comme les autres. C’est au XIXe siècle que l’on va gonfler son importance. Guillaume Tell n’a pas existé et toutes les histoires nationales sont fausses. Nos pays datent tous du XIXe siècle. Ce qui est particulier à la Suisse c’est qu’aucun contractant n’est jamais arrivé à prendre le pouvoir sur les autres. Le Valais central se distingue par «une volonté d’indépendance enraci¬née dans une vigoureuse cons¬cience de soi». En 1386, à Sempach, la bourgeoisie urbaine et la paysannerie montagnarde – elle exporte de la viande, ce qui lui permet de se racheter – triomphent par les armes de la chevalerie féodale. L’opposition centrale va devenir ville contre campagne.
La Confédération montante (1394-1536)
La Suisse de 1300 à 1350 a environ 800 000 habitants, celle de 1400, environ 600 000 et celle de 1500, 900 000 habitants. Dès le XIVe siècle, l’agriculture de montagne se spécialise et exporte. Les premiers gros éle¬veurs sont les religieux des monastères. En 1550, il n’y a plus de culture de blé dans l’arc alpin. Tout pour le bétail ! Genève et Bâle, en 1450, sont les plus peuplées des villes, 10 000 à 12 000 habitants. A l’époque, Paris a 200 000 habitants. N. Morard croit à une avarice traditionnelle des Suisses «où l’aisance du marché monétaire semble remonter fort haut et contraster avec une certaine crispation du geste gracieux, qu’il s’agisse de la création artistique ou d’autres domaines de la générosité». Boire en Suisse est donc civique. La Suisse est un lieu de passage… Se faire passer dessus est anxiogène. Peuvent venir y travailler aussi bien un Juif cordouan qu’un Polonais de Cracovie. Nos auteurs ne sont pas marxistes. Ce sont des économistes. «Il serait faux de se figurer notre passé national comme agité seulement d’un combat obstiné pour la liberté, mené contre les prétentions des Habsbourg à la domination souveraine… L’enjeu n’était pas seulement politique et les parties prenantes ne se réduisaient pas à une poignée d’indigènes hirsutes – de bons sauvages en somme, selon la mythologie vaguement rousseauiste de nos manuels scolaires – unanimement dressés contre les méchants princes étrangers. En vérité, comme toujours et partout, les intérêts des uns et des autres finissaient par se démarquer selon des clivages qu’il faut bien appeler, faute d’un meilleur terme, socio-économiques… L’histoire de la Confédération suisse, tant s’en faut, ne se laisse pas réduire à une lutte de classes, mais…» Tous les groupes qui arrivent au pouvoir, quelle que soit leur origine sociale, se muent en oligarchie privilégiée. Le corporatisme devient rapidement réactionnaire. Les guerres paysannes en Suisse sont moins paroxystiques qu’ailleurs. Les seigneurs ont des goûts de luxe, ils empruntent aux Juifs et aux Lombards de quoi payer leur rançon quand ils se font enlever, ce qui est fréquent. Les sobres bourgeois attendent la ruine de leurs adversaires. La Suisse s’étend, davantage que par les armes, par des achats de territoires au comptant ou par des prêts hypothécaires. «Les florins d’or bon poids, amassés grâce à l’esprit d’épargne et d’industrie, très bourgeois, des villes suisses, ont pesé dans la balance du destin national aussi lourd que les piques et les halle-bardes…» La naissance de la Suisse ressemble à une partie de Monopoly ou de Business. On pourrait d’ailleurs facilement en tirer un jeu du même type : Zurich rachète le comté de Kybourg à Cunégonde de Toggenbourg pendant que Berne s’allie avec Fribourg pour dévorer la Gruyère et que Lucerne rachète aux Aarberg-Valangin, la seigneurie de Willisau. Le jeu pourrait s’enrichir de ceci : «Une fois acquise la base territoriale indispensable à l’autonomie, la politique des deux cités visait, à long terme, non d’abord à posséder plus mais à s’emparer de fortes positions en des points précis, garanties d’avantages futurs entrevus très clairement. Parmi ces expectatives, le contrôle des routes et du trafic faisait miroiter l’attrait des plus grands profits». Entre 1403 et 1408, les montagnards et les paysans rossent deux armées et rasent ou prennent 67 forteresses. Ils organisent des communes rurales. Il fallut leur opposer la Ligue des Chevaliers de Saint-Georges pour arrêter leur expansion. Le 30 août 1444, Frédéric III, allié des Zurichois, appelle les princes d’Empire à assister son frère, le duc Albert, contre les Schwyzois et leurs Confédérés. «Toute la société aristocratique du sud de l’Allemagne, de l’Arlberg à la Souabe et à la Franconie, fut alors possédée par l’esprit d’un véritable Ku Klux Klan chevaleresque, dont l’idéologie seule, peut expliquer l’agressivité. C’est l’esprit communal qu’elle poursuivait de sa haine, incarné tant par le paysan que par le bourgeois…» Le 28 décembre 1478, 700 Suisses battent 10 000 Milanais à Giornico. En 1499, les Suisses se battent contre Maximilien qui s’étonne de ce que les Suisses n’exploitent pas leurs victoires, attaquent puis se retirent, rentrent chez eux. Les Suisses sur les champs de bataille ne font pas de prisonniers et ne restituent pas les cadavres. Parfois, ils se disputent entre cantons et certains s’en vont pendant que d’autres restent. Les 13 et 14 septembre à Marignan, 20 000 Suisses combattent contre 30 000 français. Les fantassins suisses sont défaits par la cavalerie et l’artillerie française, 12 000 y laissent leur peau.
La Réforme (1515-1648)
La première chronique d’histoire suisse imprimée date de 1507. Le XVIe siècle est humaniste, le XVIIe siècle recloisonne les confessions, les cantons, les groupes sociaux. Vers le milieu du XVIe, l’expansion territoriale de la Suisse est achevée. L’agriculture, décidément, se spécialise: élevage en zone préalpine, céréales sur le plateau suisse, vigne partout où il fait chaud, fromage à pâte dure à l’ouest du Gothard, chanvre et lin en Suisse orientale. Une famine tue de 1585 à 1595 14% des Genevois et 15% des Zuri¬chois. 400 000 Suisses s’enrôlent dans des armées étrangères au XVIe et XVIIe siècles. C’était bien payé. Jusqu’au XVIIe siècle, la classe politique suisse siège sur des bancs sans dossier. Dès 1600, les villes bloquent toute possibilité de naturalisation. Contre l’absolutisme des oligarchies locales, les soulèvements populaires sont motivés par le rétablissement de l’ancien droit coutumier. Les paysans deviennent conservateurs. Par contre, certains protestants veulent reconstituer la communauté chrétienne primitive en faisant l’économie de l’Etat «institution d’un monde corrompu». Les anabaptistes sont condamnés à la noyade, Michel Servet est brûlé à Genève et Gentilis décapité à Berne. Les Juifs sont chassés de partout. Protestants et catholiques brûlent les sorcières. C’est dans le Pays de Vaud que les allumettes sont les moins chères. «Furent condamnés pour sorcellerie, contrairement à ce qui s’observe au XVe siècle, surtout des femmes (58-95%), des personnes âgées (âge médian 60-65 ans), des indigents, des estropiés et des marginaux solitaires». En Suisse, il n’y a pas de cour princière, donc ni sciences ni arts. En 1597 paraît le premier journal mensuel, en 1610 le premier hebdomadaire. Vers 1620, les protestants genevois et zurichois interdisent le théâtre et le port des culottes de soie ornées de dentelle. Néanmoins, «les innovations stylistiques se sont toujours imposées en Suisse avec un certain retard ». Le sens du compromis suisse fait mer¬veille dans les guerres de reli-gion : consensus sur le maintien de l’ordre. Vis-à-vis de l’extérieur, la neutralité «apparaît de plus en plus comme la condition de l’existence même de la Confédération».
L’Ancien Régime (1648-1815)
Le XVIIIe siècle est éclairé, le XIXe siècle est nationaliste. C’est au XVIIIe que l’histoire devient critique de l’histoire. On dépoussière les mythes et, à Zurich, sort une encyclopédie en 26 volumes sur la Suisse (1747-1797). V. Freudenberger et G.-E. Haller publient en allemand et en français, Guillaume Tell, fable danoise (1760). Uri proteste. L’ouvrage est interdit et brûlé. Au XIXe siècle apparaît l’indigène suisse, l’historiographie se vulgarise. Au XVIIIe siècle, 500 000 Suisses servent encore dans les armées étrangères. Les patrons de bistrot propagent les idéaux révolutionnaires. Le paupérisme est tel qu’en temps de crise, le nombre des personnes assistées peut dépasser la moitié de la population. Les Juifs ne sont tolérés que dans deux villages argoviens. La monnaie zurichoise est alignée sur celle de l’Allemagne du Sud et la monnaie bernoise sur la française. «Les discussions à la Diète autour de la création d’une monnaie commune ont duré trois cents ans -sans résultats ; finalement on y a renoncé, voyant que les intérêts ne pouvaient pas être coordonnés». Au XVIIIe, il y a encore dans les frontières suisses des territoires à statuts originaux: jusqu’en 1798, la République de Gersau est indépendante. A Genève, il y a quatre classes politiques : les Bourgeois, les Citoyens, les Habitants et les Natifs. Les deux dernières classes n’ont aucun droit politique. En 1781, l’Edit bienfaisant élargit la base constitutionnelle. Berne et la France interviennent militairement. L’ordre rétabli efface cent ans de luttes sociales.
L’enseignement supérieur, en Suisse, est axé sur la théologie. Les sciences, la philosophie se développent en dehors de lui. La première branche qui fait une percée à l’intérieur des académies est le droit. Ce n’est qu’au XVIIIe qu’apparaissent en Suisse des artistes professionnels. Pour un Suisse, la littérature, les arts et les sciences apportent bien moins de prestige qu’un rôle politique ou économique important. «Un point commun de la littérature et de la pensée helvétique serait peut-être le bon sens qui, pour beaucoup d’auteurs, remplaçait la notion de raison. Esprits réalistes, les auteurs suisses évoquent de préférence la vie pratique. » De janvier à mars 1798, les soulèvements intérieurs permettent de faire le ménage avant l’arrivée de l’invité : partout où les Français iront, on aura détruit l’Ancien Régime avant leur arrivée. «La foi dans la perfectibilité de l’homme et la conviction que tout homme éclairé doit raisonnablement accepter les postulats de la Révolution donnaient toute priorité au développement des écoles». La République helvétique abolit les privilèges des corporations et proclame la liberté du commerce et de l’industrie. «Elle prépare le monde du XIXe siècle fondé uniquement sur la puissance de l’argent et du savoir, les deux éléments qui remplaceront les privilèges de l’Ancien Régime».
L’Etat (1798-1848) et la politique (1848-1914).
La Suisse c’est l’art du compromis. En deux générations, elle vit plus de changements constitutionnels que pendant les deux siècles précédents. La dictature de l’économie commence. La religion des marchandises s’intéresse à la démographie, compte les vies et les morts des porteurs de marchandises. La population de l’Angleterre double de 1800 à 1850. Les législations cantonales restrictives en matière d’établissement et de mariage mixte (interconfessionnels) vont sauter. De nombreux étrangers veulent s’installer en Suisse parce que c’est un pays propre, mais plus nombreux encore sont les Suisses qui doivent s’expatrier. Certains fondent des villes dans le Nouveau Monde, comme Nova Friburgo (Brésil) ou New Glaris et New Helvetia (USA). 50 000 soldats suisses disparaissent «dans la tour¬mente des campagnes napoléoniennes».
Pour les économistes, le monde a connu deux ères : l’ère pré statistique et l’ère statistique. La deuxième est celle qu’ils dominent. Ils l’ont divisée en trois secteurs : le primaire, le secondaire et le tertiaire. Ils appellent la campagne «fiscalité rurale». La Suisse économique n’existe pas avant 1848. «…la multiplicité des barrières cantonales, qu’il s’agisse de douanes ou de péages, de monnaies ou de poids et mesures, entrave et alourdit à tel point les échanges que, pour acheminer leurs envois de Saint-Gall à Genève, certains expéditeurs les font transiter par l’Allemagne et la France». L’épopée de l’économie, son époque héroïque: l’industrialisation. Sa culture : le pouvoir, l’avoir et le savoir. Ses problèmes internes: révolte d’esclaves, massacres écologiques. Sa contradiction : l’usage. Le 22 novembre 1832 à Uster (Zurich), une grande fabrique est incendiée. Ce vandalisme fait grand bruit. «Son retentissement tient moins aux dégâts matériels causés qu’à l’atteinte portée à la morale du travail, très stricte déjà dans notre pays». L’industrialisation supprime les fêtes et encourage l’alcoolisme. L’avènement des libertés individuelles est l’ouverture du marché de l’homme à l’homme. Les auteurs décrivent le village comme conformiste et les bagarreurs comme des gens sans instruction. «Malgré les idées nouvelles sur la liberté et l’épanouissement de l’individu, les masses restent sous l’emprise encore grande du fatalisme et de la superstition». Masse toi-même ! Ton économie, tes gadgets, ta femme et ta pensée que sont-elles d’autre que fatalisme et superstitions ? Crois-tu vraiment que les Missions protestantes représentent «l’un des aspects les plus positifs de l’apport suisse au monde ? » En Suisse, c’est l’artisan qui reste attaché à la pièce unique. L’artiste produit des paysages à la chaîne.
«La neutralité vis-à-vis de moi est un mot vide de sens », déclare Napoléon. Mulhouse devient française. C’est avec facilité que la France occupe la Suisse en 1798. Cette dernière lui fait acte d’allégeance en 1803. En 1830, la révolution parisienne de juillet soulève encore de l’enthousiasme en Suisse. Les révolutions et les contre-révolutions se succèdent, la classe politique reste en place. En Valais, c’est le népotisme total et, partout, les fonctionnaires s’avèrent inusables. Pour Tocqueville, la Suisse est un archaïsme, «une sorte de débilité sénile» due à la paralysie mutuelle des cantons. En Suisse, le passage à la «démocratie» est pacifique. D’après nos auteurs, les masses suisses pensent : «Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ». L’hostilité foncière au changement serait devenue l’idéologie nationale. «En arrivant à Berne, on nous apprit qu’il y avait une grande révolution dans la ville ; j’avais beau regarder, les rues étaient désertes, le silence régnait, la terrible révolution s’accomplissait sans parler, à la paisible fumée d’une pipe au fond de quelque estaminet. » écrit Chateaubriand en septembre 1832. Juillet 1830 marque le début du système de représentation dans lequel nous vivons encore. Le ciel des idées s’étoile de l’habeas corpus, de la liberté de croyance, de la presse, du commerce et de l’industrie, de l’établissement et du droit d’association, de réunion et de propriété. Le dernier terme est le mieux ancré à terre. L’heure de la soumission volontaire est arrivée.
Dans les années 1880, le Conseil fédéral commence à mener une politique culturelle active. L’Etat devient mécène. Mais, dès la fin de la Première Guerre mondiale, ça tourne au vinaigre. N’est pas Hodler qui veut ! «Otto von Greyerz, l’un des représentants de la nouvelle école régionaliste et traditionaliste, déplore de voir, dans les villes, la culture dominée par «une génération de littérateurs apatrides, d’intellectuels purs, sans racines, parmi lesquels l’éternelle juiverie littéraire se trouve particulièrement à l’aise».
La Confédération, avec ses subventions culturelles, pourrait bien être responsable. Les meilleurs artistes s’éloignent de l’Etat et donc de la société. Ramuz, en 1937, doute de l’existence d’un peuple suisse et voit l’ensemble des Helvètes en portiers d’hôtel. La masse est ailleurs. Elle danse devant la radio ou se frotte les yeux au cinéma. «Le succès commercial de cette culture de divertissement contribue d’ailleurs à financer la culture traditionnelle : la ville de Berne, par exemple, subventionne son théâtre déficitaire par des taxes sur les billets de cinéma (environ 200 000 francs par année). C’est ainsi que les couches inférieures de la population ont soutenu la culture bourgeoise en crise». Fondée en 1938, Pro Helvetia commence à fonctionner en 1949. Ce ministère suisse de la culture est censé n’être pas sous la tutelle de l’Etat. Elle est bien bonne celle-là, non ?
A partir de 1848 un Suisse peut changer de canton sans perdre ses droits. Le Vorort et l’USAM ont le pouvoir et le gardent. Les partis politiques et leurs votations font de la figuration. C’est inintéressant au possible. «Si l’on applique à cette haute bourgeoisie helvétique la loi des trois pouvoirs dégagée par J. Lhomme, la priorité qu’elle accorde d’abord au pouvoir politique (20% des sièges dans le premier parlement) s’efface au profit de l’influence écono¬mique, le prestige social ne comptant guère».
L’écureuil en acier chromé, (1914-1945).
« J’ai vu une seule fois un film suisse. Absence totale de virtuosité photographique. Pas de trucs, pas d’effets de luxe ni de toilette. Une histoire policière sans intrigue amoureuse, où ne figuraient que des hommes grands, laids, larges d’épaules. Problème posé et se résolvant peu à peu avec une logique si simple que le plaisir de comprendre finissait par l’emporter sur le manque d’attrait visuel choquant au début», écrit déjà Gabrielle Buffet en 1917. Le politicien suisse moyen ne comprend plus rien. Cela limite les capacités d’adaptation du système. La Suisse joue à Monsieur Bons Offices. Les partis politiques au pouvoir sont conservateurs et se défendent âprement contre la gauche et la bourgeoisie libérale moderniste. «Cette polarisation et l’influence croissante de pouvoirs extra-parlementaires, comme ceux des associations économiques et des clubs de notabilités, restreignent encore l’exercice de la démocratie. Les parlementaires deviennent toujours plus ouvertement des représentants de groupes d’intérêts ; c’est à cette époque qu’on commence à parler de l’emprise de l’économie sur la politique». Et en parler ne mène pas loin… Faut-il rappeler qu’aujourd’hui, 151 parlementaires suisses sur 284 sont directement ou indirectement appointés, notamment au sein des conseils d’administration, par des grandes firmes de la chimie, de la banque, des assurances ? Dès 1935, devant la menace fasciste, les socialistes se replient sur la nation. Comme ils sont sages, en 1943, ils reçoivent un siège au Conseil fédéral. Ils vont enfin pouvoir s’asseoir. En 1938, H. Rothmund, chef de la police des étrangers, déclare : « Nous avons pris une position nette dès le début de l’existence de la police des étrangers. Les Juifs ainsi que les autres étrangers sont considérés comme un danger quant à la surpopulation étrangère (Uberfremdung). Par des mesures systématiques et circonspectes, nous avons réussi à éviter un enjuivement (Verjudung) de la Suisse». Imaginons un instant que la Suisse ait accueilli tous les juifs germanophones et tous les Tziganes… Quel pays extraordinaire ce serait à présent !
En 14-18, la Suisse vend aux uns et aux autres ce qu’eux-mêmes produisent mais ne se vendent plus. Ça c’est moderne ! En 1936, Gottlieb Duttweiler crée l’Alliance des Indépendants. Le Fùhrer de la marchandise aurait fait un dictateur formidable. Après avoir interdit la vente d’alcool dans ses magasins, il aurait pu rationaliser à l’extrême le reste. Hélas, la marchandise n’avait pas besoin de Führer et, le 19 juillet 1937, K. Ilg et E. Dùbi signent un accord, la Paix du travail, entre les hommes de bonne volonté. La marchandise est satisfaite : ses porteurs sont réconciliés. «En 194-42, on estime que 60% de l’industrie d’armement, 50% de l’industrie optique et 40% de l’industrie des machines travaillaient pour le Reich». Entre 1939 et 1945, un fabricant d’armes passe d’une fortune imposable de 8,5 à 170 millions. Ah, la conjoncture… Même après un protocole de rupture, suite à des pressions américaines, en février 1945, la Suisse continue ses relations avec le Reich et, en particulier sur le marché de l’or. Je résume : l’or, oui, les Juifs, non !
Le capitalisme (1945-1985).
Le XXe siècle est mondial, le XXIe siècle sera tribal. «L’histoire de l’après-guerre est, dans une large mesure, l’histoire d’un succès sans précédent de l’économie capitaliste». Le capital s’étend de façon soutenue et dynamique sans rencontrer d’opposition majeure. Il n’y a plus que deux espaces mondiaux : le monde «libre» et l’univers «socialiste». Chacun étend son pouvoir sur sa part de gâteau. Le sol suisse devient le plus cher du monde. «Une mentalité inflationniste se manifeste dans des cercles de plus en plus larges, l’endettement devenant plus attractif que l’épargne». L’Europe vieillit et disserte sur les avantages et les désavantages d’une vie purement végétative. Les gens qui pratiquent le tennis deux fois par semaine sont appelés «cadres» et considérés comme plus dynamiques que ceux qui jouent au jass. La con-sommation de masse remplace allègrement une liberté qui n’existait pas. Les syndicalistes protègent des patrons que personne ne menace. Petit à petit, ils sont remplacés par des voitures blindées et des talkies walkies. Les seuls agités que l’on peut encore apercevoir de temps en temps sont tous journalistes : ils désinforment jour et nuit. L’Etat se drogue, les jeunes se renforcent. En 1956, le peuple suisse observe trois minutes de silence pour entendre le bruit des chars écrasant la révolte hongroise. En 1968, les jeunes déclarent qu’ils ne veu-lent pas vivre comme leurs parents. Aux dernières nouvel-les, l’atavisme a gagné la partie.
On s’adapte à ce qui existe, on se replie sur les cuisines, on grossit. La Confédération se charge d’une enquête sur les maladies cardio-vasculaires. Faut-il interdire les produits qui ont plus de 12% de matière grasse ? Les artistes tachistes sont contre. Chappaz et Chessex crient au viol des traditions régionales. Tinguely explore le vide du mouvement perpétuel. Le jazz perd ses cheveux et le rock ses dents. Personne ne remarque les punks, car ce mouvement se glisse sans problème dans la viscosité habituelle d’une fin d’adolescence helvétique : No futur ! Le Touring-club devient un groupe de pression important. Entre 1929 et 1982, trois référendums passent. Bonjour le spectacle ! Le désintérêt pour la chose politique devient tel qu’à partir de 1971, même les femmes sont autorisées à voter. On aura tout vu. La Suisse est le premier pays du monde en entreprises multinationales par tête de bétail. Elle cache subtilement cela derrière une croix rouge bourrée de fonctionnaires dépressifs. Sous toutes les maisons, il y a un abri anti-atomique, les coffres des banques ayant été jugés trop beaux pour servir à cet effet.
Unbesetzung macht frei !
Beaucoup de discussions entre spécialistes. Pas de vulgarisation. Parfois c’est pelant. Comme ce livre est dirigé contre l’histoire officielle et que celle-ci est un bulldozer, ici on doute beaucoup : «.. .nous ne pouvons dire à quelle époque et, par suite, dans quel contexte il convient de situer leur genèse. Ce qui rend, sur ce point, la discussion difficile, c’est qu’elle interfère avec celle que nous avons mentionnée concernant les origines de la liberté (…) …les historiens ne s’accordent pas… la solidité des arguments avancés en ce sens a été à son tour mise en question… On peut certes être sceptique… (…) Il est douteux qu’on puisse parvenir à des connaissances plus sûres, vu l’état fâcheux de nos sources (…) Cela peut troubler ou décevoir mais…» (P. 148). Il y a de la timidité dans l’air. Ce sont des dévots de l’économie. Lorsque quelque chose ne se ramène pas facilement à elle, ils nomment cela «la politique» et deviennent suspicieux. Ils détruisent systématiquement les mythes nationaux, c’est-à-dire qu’ils remplacent d’anciennes beautés par de nouvelles laideurs. A part l’économie, ils utilisent un autre truc pseudo objectif : le juridisme. Ils présupposent beaucoup trop souvent que nous savons de quoi ils parlent. Par exemple : «L’épisode est trop connu pour qu’on y revienne en détail» (P. 280). Connu par qui ?
Pour eux, les manuels scolaires d’histoire suisse sont un tissu de sottises. Nous abondons dans leur sens. Nous sommes plus réservés devant leur apport. Ils tombent parfois dans des vulgarités progressistes tout à fait hors de propos, titres de sous-chapitres de style journalistique (la «french connection»… au XVe siècle!) ou propos moralisateurs (des morts inutiles…) Et leur culte de l’économie est une croyance en une nouvelle théologie des nombres. Cette idéologie dominante s’appuie sur la démographie et le salariat, contre la culture entendue au sens large. La peste, la variole et la pénurie de blé sont leurs concepts. Histoire et géographie quantitatives sont bien de notre époque, les objets se comptent et se recomptent entre eux.











